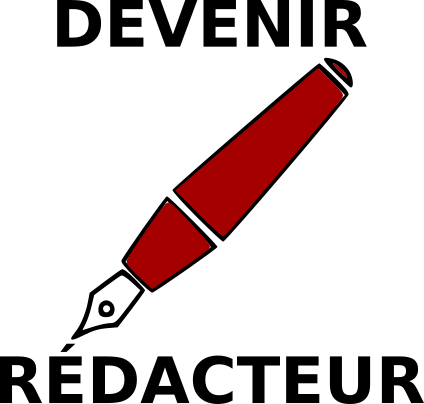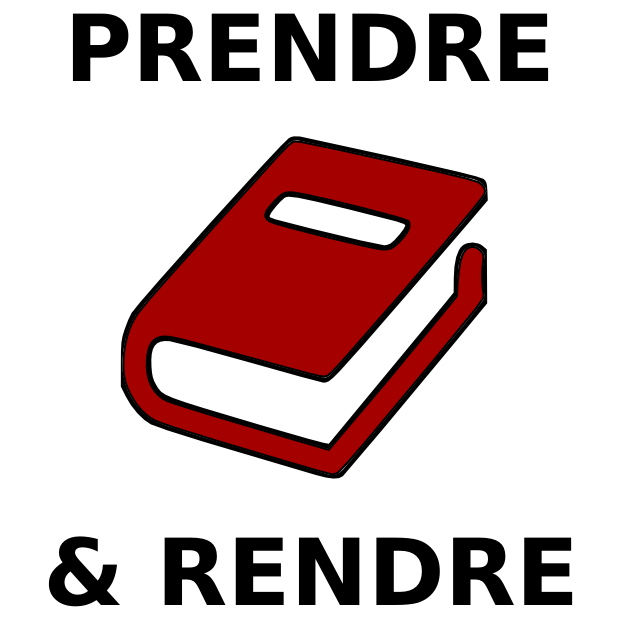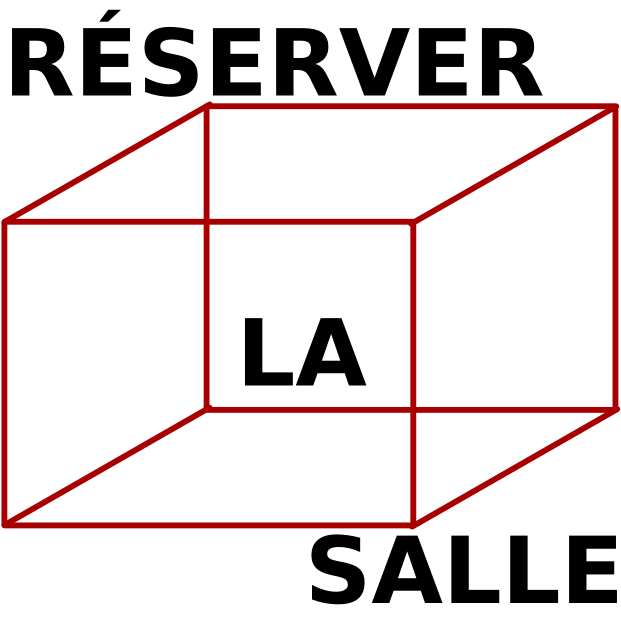Bonsoir à toutes et à tous,
Et c’est reparti pour une nouvelle année que nous vous souhaitons
offensive et passionnante car les temps ne se prêtent plus guère à
souhaiter une année heureuse ou joyeuse puisque l’on sait tous qu’elle
a peu de chance de l’être sauf par intermittence.
Nous souhaitons tous bien sûr qu’il y ait de grandes luttes se déployant
sur tous les terrains vitaux de l’emploi, du pouvoir d’achat, des
services publics et de l’environnement. Encore faudrait-il que ces
luttes ne soient pas disjointes, émiettées, dévoyées, livrées à
l’isolement comme ce fut largement le cas l’année dernière.
2009 aura été une année de luttes importantes et nombreuses que ce soit
en Guadeloupe et en Martinique mais aussi en France métropolitaine où
des grèves et des actions longues et tenaces se sont produites dans de
nombreux secteurs et sur de nombreux sites.
Les salariés du secteur privé dont depuis des années les syndicalistes
et militants de gauche combatifs déploraient l’absence dans les
manifestations et mobilisations sont revenus en force sur le terrain de
la lutte. Cela fut patent au cours des manifestations de janvier et mars
2009. Cela fut confirmé à l’évidence au cours des centaines de grèves
locales pour sauver les emplois et à défaut pour obtenir des indemnités
de licenciement les plus importantes possibles.
Les incantations à la grève générale ne changeront rien. Il est plus
utile de créer dès maintenant des liens directs entre les acteurs des
luttes. Mais même cela ne prendra corps que si la combativité et le
volontarisme s’accompagnent d’une lucidité commune sur les obstacles,
sur l’état d’ensemble de la société et sur une aspiration à d’autres
rapports économiques et sociaux. Là est la difficulté fondamentale à
surmonter individuellement et collectivement. C’est un enjeu de
civilisation ou si l’on préfère politique, à condition de ne pas donner
à ce mot une acception mesquine, desséchée et manipulatoire.
Nous savons tous que l’air pur se raréfie de même que l’eau potable.
Mais on a parfois aussi la désagréable impression que l’espace et le
temps de réflexion sont en train de s’atrophier, de se lézarder sous les
coups de boutoirs gouvernementaux et marchands qui détruisent le contenu
même de l’enseignement, de la recherche et de la culture. Ne pas lâcher
prise sur ce terrain-là, vivifier notre curiosité et notre esprit
critique en toute occasion et par tous les moyens possibles, c’est un
beau programme à notre portée, non ?
En route pour l’enfer
Sur le fil de la vie
Camus l’irrécupérable
Le temps d’en rire
Cantora
EN ROUTE POUR L’ENFER
En 1904 dans une lettre à un ami, le jeune Kafka exprimait sa haute
conception de la littérature : « Un livre doit être la hache qui brise
la mer gelée en nous. » Kafka est resté jusqu’au bout fidèle à cette
haute exigence. Il mériterait d’être enfin lu et pas seulement invoqué à
propos de situations absurdes (« C’est kafkaïen », « Bonjour chez Kafka »...).
Le roman du japonais Kobayashi Takiji, « Le Bateau-usine » est de cet
ordre, comme écrit à la hache avec une précision implacable (éditions
Yago, octobre 2009, paru au Japon pour la première fois en 1929).
Il est un de ces récits qui se gravent définitivement dans notre mémoire
à l’instar de « La Jungle » d’Upton Sinclair sur l’exploitation dans les
abattoirs de Chicago (1905) ou « La Révolte des pendus » de B.Traven sur
l’exploitations des Indiens du Mexique dans les plantations de
caoutchouc (1936).
Kobayashi Takiji est absolument sans pitié avec le lecteur pour lui
faire sentir jusqu’à la nausée ce qu’était l’exploitation sur un
bateau-usine dans l’entre-deux guerres où les travailleurs embarqués
pêchent et conditionnent les crabes entre le nord du Japon et les côtes
de la Russie soviétique. La lecture fait monter chez le lecteur un
sentiment de révolte irrépressible. Au détour de l’évocation du parcours
antérieur de ces damnés de la mer, on en apprend beaucoup sur les
conditions de travail dans les mines, sur les ports et dans les
campagnes du Japon capitaliste. Rien n’est enjolivé ou édulcoré. Il n’y
a pas de ces héros exemplaires qui fleuriront plus tard dans les romans
staliniens. La postface de la traductrice Évelyne Lesigne-Audoly apporte
des éléments très importants à la fois sur ce roman et sur son jeune
auteur très lié au mouvement communiste de son pays et qui est mort
torturé par la police en 1933 à l’âge de 29 ans. Après avoir été diffusé
clandestinement jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale,
« Le Bateau-usine » connut ensuite un succès d’estime et fut considéré
comme une œuvre phare du courant de la littérature prolétarienne illustré
en France par des écrivains comme Louis Guilloux et Henry Poulaille.
L’histoire aurait pu en rester là mais ce roman connaît depuis 2008 un
succès fulgurant au Japon dans le contexte de la crise sociale qui
frappe également ce pays. Des versions en bande-dessinée de ce roman ont
atteint également des records de vente. Le phénomène n’a rien de
superficiel. Ce sont avant tout des jeunes et en particulier des jeunes
précaires d’aujourd’hui qui se sont emparés de ce roman et en ont
débattu. Telle est la force d’une œuvre qui ayant frappé juste en son
temps a gardé toute son actualité.
SUR LE FIL DE LA VIE
L’écrivain d’origine irlandaise Colum McCann avait déjà écrit en 1998 un
roman situé à New York « Les Saisons de la nuit » qui était un coup de
maître, une traversée du XXe siècle dans cette ville où des travailleurs
creusaient le métro ou bâtissaient des gratte-ciel dans des conditions
infernales et où d’autres quelques décennies plus tard se retrouvaient
sans-abri dans cette même ville.
Avec le roman « Et que le vaste monde poursuive sa course folle » (éd
Belfond), Colum McCann nous replonge dans New York, cette fois au cours
des années soixante-dix. Une journée particulière constitue le pivot de
la narration. Le 7 août 1974 un jeune funambule français, Philippe
Petit, a marché, sautillé, dansé sur un câble entre les deux tours du
World Trade Center. Cet exploit d’un panache inouï a sidéré et
émerveillé tous ceux qui en dessous partaient à leur travail. Bien que
le romancier n’y fasse pas du tout allusion, il est évidemment
impossible de ne pas songer à un autre événement sidérant, au même
endroit, mais celui-ci barbare, survenu le 11 septembre 2001.
L’intelligence de Colum McCann est de montrer un New York des années
soixante-dix qui n’a rien d’idyllique par rapport à celui d’aujourd’hui.
Il est autre et semblable. La tentation de l’effet de nostalgie est
réduite d’emblée à néant. 1974 semble clore une période où les
mouvements divers de contestation et d’innovation ouvraient un horizon
meilleur.
La guerre du Vietnam bat son plein. Un groupe de mères dont les fils
sont morts dans cette guerre se retrouvent pour se soutenir le moral.
Certains quartiers du Bronx ou de Harlem sombrent dans la drogue et la
prostitution. Un jeune prêtre irlandais en déshérence atterri dans un
cloaque infernal du Bronx tandis qu’à un autre bout de la ville une
infirmière guatémaltèque travaille d’arrache-pied pour éduquer ses deux
filles.
En s’engageant dans la lecture de ce roman reposant sur une
documentation considérable sans être apparente, on n’est pas sûr d’avoir
le courage et la motivation d’aller jusqu’au bout en s’enfonçant dans
une réalité sociale sordide et des itinéraires personnels douloureux.
Mais Colum McCam fait partie de ces grands écrivains qui pénètrent avec
une aisance confondante dans la logique et le langage de chacun de ses
personnages. Le récit est à l’opposé de tout misérabilisme. Il n’est pas
« bien ficelé », il est à l’image des existences qui sont mal ficelées,
inattendues et très attachantes. L’humanité des personnages émerge par
la grâce d’un style à la fois vivant et retenu, avec une forme de
décontraction très new-yorkaise.
CAMUS L’IRRÉCUPÉRABLE
L’écrivain Albert Camus fera-t-il son entrée au Panthéon comme icône des
valeurs républicaines ? Parmi les invités de l’émission la Grande
librairie de François Busnel sur France 5 jeudi dernier, il n’y avait
que le philosophe libertaire Michel Onfray qui y était clairement
favorable. Il n’est pas nécessaire de mettre des guillemets à libertaire
qui est devenu un mot inoffensif d’une élasticité formidable et une
référence confortable pour tous ceux qui veulent se donner à peu de
frais un supplément d’âme politique ou morale.
Revenons à Albert Camus que Michel Onfray a caractérisé comme libertaire
au cours de cette émission. Pourquoi pas ? Camus a été brièvement membre
du Parti communiste algérien dont il a été exclu au moment du traité
entre Pierre Laval et Staline. Il avait de fortes sympathies pour les
anarcho-syndicalistes notamment espagnols. Michel Onfray l’a souligné
avec raison. Dans sa jeunesse l’écrivain a écrit une pièce de théâtre
immédiatement interdite intitulée « Révolte aux Asturies » sur
l’insurrection des travailleurs d’Oviedo.
Il est vain cependant de vouloir enrôler quelqu’un à l’esprit critique
et indépendant comme Albert Camus dans une catégorie précise. Ce n’est
pas lui rendre justice ni lire utilement ses écrits que de vouloir en
faire un maître à penser ayant eu raison en toutes circonstances.
D’autres, surtout de son vivant, ont voulu le ranger dans la catégorie
des petits-bourgeois pacifistes ou des sociaux-démocrates moralistes.
Quelques pages d’Albert Camus parmi d’autres dérangent encore un peu
plus toutes ces tentatives d’étiquetage. En 1953 un livre d’Alfred
Rosmer est publié sous le titre « Moscou sous Lénine » aux éditions
Pierre Horay. Le titre véritable était en fait « Moscou au temps de
Lénine ». Camus en a fait la préface qui commence par cette phrase
superbe de justesse : « C’est un des paradoxes de ce temps sans mémoire
qu’il me faille aujourd’hui présenter Alfred Rosmer alors que le
contraire serait plus décent. »
Rosmer était un de ces rares syndicalistes révolutionnaires restés
fermement internationalistes pendant la Première guerre mondiale et qui
ont répondu à l’appel de la Révolution d’Octobre. Il a exercé des
responsabilités dans l’Internationale communiste et à la direction du
Parti communiste français jusqu’en mars 1924. Il séjourna à plusieurs
reprises en Russie soviétique de 1920 à 1924. Ce sont ses souvenirs
qu’il raconte dans ce livre qu’il faut découvrir ou relire pour échapper
aux caricatures laudatives ou dépréciatives de la révolution russe et
des premières années de l’Internationale communiste et pour réfléchir
sur le destin de cette révolution.
Albert Camus a la plus haute estime pour Alfred Rosmer qui fut par
ailleurs un des animateurs de l’Opposition de gauche en France défendant
les positions et les analyses de Trotsky. Camus considère irremplaçable
l’expérience d’hommes comme Rosmer préservant « pendant des années, dans
la lutte de tous les jours, la chance fragile d’une renaissance ». Dans
son style précis et éblouissant, Camus explore en même temps ce qu’est
pour lui le sens d’une révolution, un moyen qui peut être trahi, qui
peut être jugé mais qu’il n’est jamais question de renier.
Il dit les points sur lesquels l’argumentation de Rosmer sur les
décisions des Bolcheviks ne le convainc pas, en particulier à propos de
la dissolution de l’Assemblée constituante et de l’écrasement de
Cronstadt. Il le fait avec prudence et scrupule, justement pas comme un
petit moraliste sûr de soi expédiant une grande tentative
révolutionnaire dans les poubelles de l’histoire. En fait s’il est hors
de propos de qualifier Albert Camus de révolutionnaire, il se situe
clairement avec Alfred Rosmer dans le camp fort peu nombreux en 1953 de
ceux qui dénoncent le régime stalinien, non pas écrit-il « parce qu’il
hérite d’une révolution où la propriété bourgeoise a été détruite, mais
au contraire parce qu’il renforce, par ses folies, la société
bourgeoise. »
LE TEMPS D’EN RIRE
Pour rire de bon cœur et sans retenue, les quatre courts métrages des
« Contes de l’âge d’or (partie 1) » (1h 18) sont une bonne option en ce
début d’année réfrigérant.
Décidément les cinéastes roumains tiennent toujours la grande forme, que
ce soit pour passer au vitriol l’ancien régime de Ceausescu comme ici
que pour dénoncer les ridicules et les tares du régime actuel. Dans ces
« contes » ils se moquent de gens de pouvoir évidemment corrompus et
imbus d’eux-mêmes et des attitudes serviles des citoyens de base. Ils le
font avec cette bonhomie assassine qu’on trouve chez Jaroslav Hašek,
l’auteur du « Brave Soldat Chvéïk ».
Tout pouvoir bureaucratique engendre une peur permanente diffuse qui
provoque avec une efficacité redoutable la destruction de toute forme de
bon sens. Un ordre du Parti ne tolère ni délai dans son exécution ni
exception. Comment rectifier la photo officielle du chef suprême avant
que les rotatives ne tournent ? Comment alphabétiser tout un village en
quelques semaines ? À cela s’ajoute la difficulté d’interpréter les
désirs des chefs pour ne pas se faire taper sur les doigts. D’où un
chaos sans fin dans la marche quotidienne d’une société roumaine qui
n’était déjà pas très vaillante. Sauf pour un flic qui a tout de même
pour souci de tuer un cochon en douce dans son appartement. On espère
que la partie 2 de ces « légendes urbaines » sera aussi divertissante.
CANTORA
En octobre dernier la chanteuse argentine Mercedes Sosa est décédée à
l’âge de 74 ans après une longue maladie. Six mois auparavant elle avait
réussi à terminer un album intitulé « Cantora » qui vient de sortir
(Sony Music). Le CD est accompagné d’un émouvant DVD centré sur les
rencontres qui ont présidé à la réalisation de cet album avec de jeunes
ou moins jeunes chanteurs et chanteuses d’Amérique latine tels que
Caetano Veloso, Shakira, Charly Garcia, Daniela Mercury, ou Luis Alberto
Spinetta. La plupart de ces artistes ont proposé une de leurs chansons
en sorte que l’ensemble n’est pas une répétition du répertoire déjà
connu de Mercedes Sosa. Son corps est manifestement très éprouvé. Dans
certaines ballades sa voix a de légères défaillances dans la ligne de
chant mais le timbre est toujours aussi beau et émouvant. Un courant
d’énergie passe particulièrement dans ses duos avec les jeunes
chanteuses. Sa voix grave fait aussi un joli contraste avec celle des
chanteurs qui est en général plus aiguë, à l’exception du duo très
prenant avec un jeune chanteur de rap, René Perez de Calle 13.
Pour qui ne connaît pas Mercedes Sosa, chanteuse issue d’une famille
pauvre de Tucuman près des contreforts andins et fidèle jusqu’au bout à
ce qu’elle appelle fièrement son idéologie (communiste), nous
recommandons plus particulièrement une compilation à nouveau disponible
où l’on retrouve sa voix dans toute sa plénitude, « The best of Mercedes
Sosa » (CD Polygram 1997). Son interprétation la plus poignante est
certainement « Gracias a la vida » chantée en public en 1982 quelques
mois avant la chute de la dictature militaire dans son pays : « Merci à
la vie, qui m’a tant donné, m’a donné deux yeux de lumière et quand je
les ouvre, je distingue parfaitement le noir du blanc. »
« Gracias a la vida » de la chilienne Violetta Para est une chanson
qu’on aura toujours envie d’entendre ou de chanter comme ce fut le cas
d’une chanteuse amie de Mercedes Sosa, Joan Baez qui contribua à la
faire largement connaître.
******
Nous adressons toute notre sympathie aux proches et aux camarades de
Daniel Bensaïd dont nous venons d’apprendre le décès ce matin. Tous ses
lecteurs attentifs dont nous étions, même lorsque nous étions en
désaccord avec lui, seront affectés par sa disparition.
Bien fraternellement à toutes et à tous,
Samuel Holder
Pour recevoir cette lettre, écrivez-nous :
mél : Culture.Revolution chez free.fr
http://culture.revolution.free.fr/