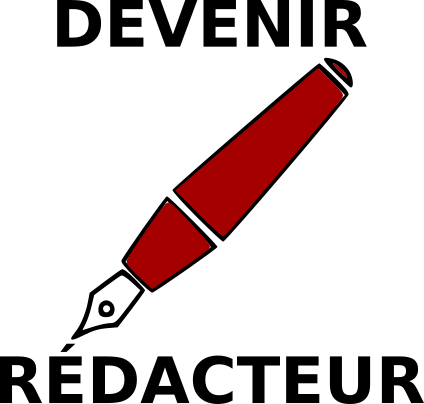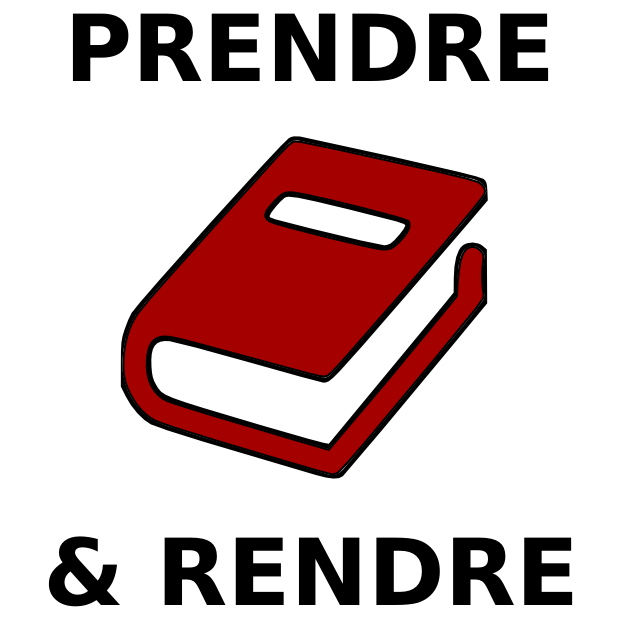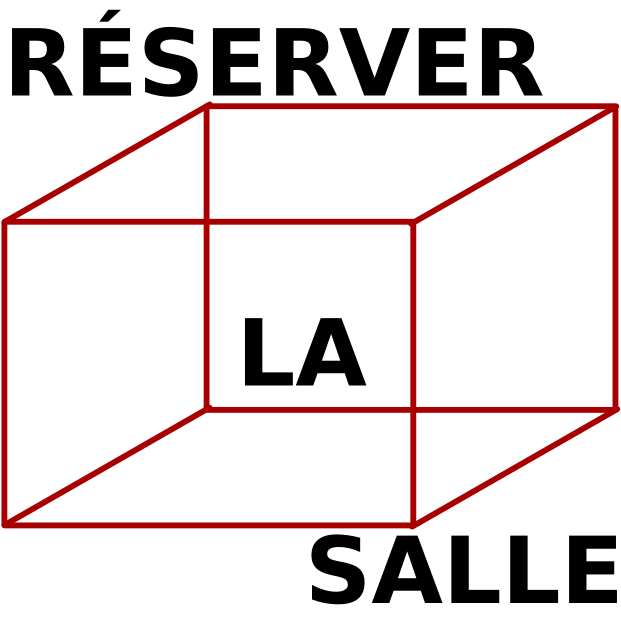Lire avec les liens et les illustrations :
http://www.article11.info/spip/spip.php?article889
Rares les entretiens qui mijotent autant avant qu’on ne les publie. En avril dernier, on rencontrait Alèssi Dell’Umbria chez lui, en son repère marseillais. Depuis, le texte fait des aller-retours, bourgeonne : révolte de 2005, tropismes marseillais, banlieues qui craquent... L’auteur (entre autres) d’une belle Histoire universelle de la cité phocéenne ne mâche pas ses mots.
Alèssi Dell’Umbria (part.I) : "Le discours idéologique républicain a anesthésié toute culture de la révolte"
Lundi 6 septembre 2010, par Lémi et JBB
[1]
La ville qui s’étend, au loin. Petit appartement, dixième étage, lui la surplombe. N’a même plus besoin de la regarder pour la voir, pour la sentir ; il en est. Marseille, c’est sa ville, son théâtre, ses arènes. Pour dire : il en a même écrit L’Histoire universelle [2], une somme de plus de 700 pages, venue de nulle part - Alèssi n’est ni universitaire, ni historien officiel - et unanimement saluée comme l’un des plus ambitieux travaux jamais produits sur la capitale phocéenne. Autodidacte rétif aux étiquettes - disons quand même : un (bon) brin anar, un brin toto - , il en est pourtant une que l’auteur revendique largement : Marseillais. Il l’affiche, l’accent et la gouaille, le vocabulaire et le goût du peuple, et jusqu’à la petite chaîne dorée autour du cou. Historien à la marge, loin des canons du genre - sinon à considérer que l’histoire par en-bas est devenue la norme (malheureusement : non) - , Alèssi Dell’Umbria est tout aussi éloigné de ceux du militantisme ; d’ailleurs, il déteste les "militants". Contempteur féroce de la gauche et de ses familles, même extrêmes, celui qui a été l’un des trublions d’une ultra-gauche activiste dans les années 1980 n’a pas renié grand chose de ses amours de jeunesse. Mort aux vaches, évidemment - même s’il ne le dit pas ainsi. Amour de la révolte, de ce qu’elle dit du surgissement de la vie, aussi. Et puis, refus des institutions mortifères, de la fallacieuse représentation, des chefaillons médiocres et autres intermédiaires auto-proclamés. Pour le reste : rock’n’roll !
Nul besoin d’en dire plus, sinon mentionner le très beau (et percutant) pamphlet publié par lui au lendemain des dites émeutes de 2005, C’est de la Racaille ? Eh bien, j’en suis ! [3]. Sans doute le seul ouvrage sur le sujet ne dépeignant pas les protagonistes pyromanes de ces journées comme des monstres assoiffés de sang et ne respectant rien, juste bons pour le karcher. Précieux.
L’entretien qui suit - d’abord né d’une rencontre en son appartement marseillais en avril dernier, le texte ayant ensuite été enrichi lors de nombreux échanges de mails - est dense, passionnant. Fleuve, aussi. Si fleuve, même, que nous le publions en deux parties : l’acte 2 sera mis en ligne mercredi. En espérant qu’en cette morne rentrée sociale, il vous donne autant envie qu’à nous de secouer-affronter-renverser tous ces satrapes qui ont fait main basse sur nos vies. Ou bien, de vous installer à Marseille. Au choix, hein.
.
La révolte de 2005 était-elle prévisible ?
Une révolte n’est jamais prévisible. Encore heureux ! La réaction des gens de Clichy-sous-Bois à la mort des deux minots n’avait en soi rien de surprenant : c’était la moindre des choses. Mais c’est cette incroyable contagion qui a pris tout le monde par surprise. J’avoue être moi-même resté stupéfait, la première semaine… Ce qui m’a également surpris, c’est la réaction de pas mal de gens de ma génération, au quartier. Je parle là de gens souvent issus des cités des quartiers Nord ou Est, et qui sont descendus vivre en-ville, certains que je connais bien et qui ont connu étant minots ce que vivent les jeunes des banlieues d’aujourd’hui… Ils avaient pourtant une réaction assez négative envers cette révolte, sur un thème récurrent : « N’importe quoi, ils brûlent les voitures des gens qui habitent leur cité et sont aussi pauvres qu’eux », et c’est tout. Venant de gens qui, somme toute, avaient fait pareil étant jeunes, c’était un peu court. De telles réactions révèlent une faille. Elles appelaient, en réponse, à défendre la légitimité d’une telle révolte. C’est ce que j’ai essayé de faire en écrivant C’est de la Racaille ? Eh bien, j’en suis ! [4] (que Agone a réédité récemment sous le titre, que je trouve assez plat, La rage et la révolte, avec une postface sur ce qui s’est passé depuis).
Suivant le point de vue d’où l’on se place, on peut voir simplement dans cette révolte une conséquence d’un système post-colonial appliqué aux immigrés et à leur descendance. Il y a du vrai dans ce point de vue, mais il nous donne une vision partielle. Après tout, la délinquance juvénile, le fameux « malaise des banlieues », étaient déjà dénoncés en 1960, et c’étaient de jeunes blancs qui semaient la terreur dans la France d’alors. À partir de ma propre trajectoire personnelle et des événements auxquels j’ai été mêlé ou que j’ai observés de près, à partir de ma ville, j’avais un autre point de vue. Pour moi, cette révolte prenait tout son sens par rapport à la construction de cette entité qu’est la France. De la même manière que la grande révolte multiraciale de Los Angeles en 1992 a radicalement mis à nu le modèle américain, la révolte de 2005 en a fait autant avec le modèle français. Deux pays qui constituent dans le monde entier des modèles idéologiques très forts - pour faire court, je dirai que dans l’un c’est l’argent qui organise le vide social, dans l’autre c’est l’État. On voit donc l’importance de ces événements.
« [...] La grande révolte multiraciale de Los Angeles en 1992 a radicalement mis à nu le modèle américain, la révolte de 2005 en a fait autant avec le modèle français. »
Même si leur matérialisation a pu varier : cette révolte a par exemple été moins importante à Marseille qu’à d’autres endroits…
Marseille est de toute façon toujours un peu à part. D’abord, il faut bien voir qu’elle a été la première ville de France où les responsables du maintien de l’ordre ont eu affaire à la révolte endémique dans les cités, dès le milieu des années 1970, et ils ont accumulé un vrai savoir-faire en matière de prévention et de répression. Pensez un peu qu’en 1976, un supermarché rue Félix Pyat fermait à cause des pillages répétés commis par les bandes du Parc Bellevue, événement répercuté dans les médias nationaux. Ce n’est pas d’aujourd’hui que les cités marseillaises sont sous observation.
En 2005, les autorités ont donc anticipé. Un exemple, dans les quartiers Est, la cité HLM Air-Bel, qui défraye régulièrement la chronique ; les flics n’avaient pas besoin de réfléchir longtemps pour identifier la seule cible potentielle là-bas, un concessionnaire Peugeot se trouvant sur un boulevard à 300 mètres de la cité : quand les minots ont débarqué un soir pour l’incendier, les CRS et la BAC les attendaient de pied ferme, et scappa via ! C’est arrivé ailleurs, au Carrefour du Merlan : un groupe descendu pour le piller a été précédé par les flics. Il est vrai que ceux-ci commencent à avoir l’habitude : dans les années 1980, il y avait de façon périodique des affrontements dans cet hypermarché, entre les jeunes des cités environnantes d’une part (Busserine, Flamands, Font Vert, Corot), les vigiles et les flics de l’autre. En 2005, enfin, le maire et le préfet se sont mis d’accord dès les premiers incidents pour imposer un black-out médiatique total : Gaudin a déclaré qu’il ne voulait pas que des incendiaires viennent ruiner dix ans de travail voués à donner une autre image de Marseille. Et, quoi qu’on dise, le fait que leurs actions passent à la télé a été un facteur très stimulant pour les incendiaires.
Après, il y a des cas particuliers. La Busserine, dans les années 1980 véritable zone de guerre avec les flics, est devenue depuis dix ans le supermarché du shit : les minots savent que s’ils caillassent une bagnole de flics, ils vont se faire camfrer par les « chefs du charbon » (selon leurs propres dires), parce que c’est mauvais pour le deal. Les petits dealers épisodiques participent eux-aussi aux caillassages des patrouilles de flics – de toute manière, nombreux sont les ados qui dealent un peu aujourd’hui, ne serait-ce que pour se payer leur consommation personnelle – ; mais ceux qui opèrent dans la catégorie au-dessus, les dealers directement connectés sur les arrivages et qui organisent un vrai business, n’ont aucune envie que ça pète avec les condés. A Marseille comme à Paris.
Mais, heureusement, les patrons du charbon ne contrôlent pas tout. Plusieurs fois par semaine, on lit dans la rubrique des faits divers que les CRS ou la BAC se sont fait caillasser dans telle ou telle cité. L’été 2009, une grenade a même été lancée contre le commissariat de la rue Felix Pyat, en plein Parc Bellevue : quatre voitures de la police ont été bousillées… Et, pour prendre l’exemple de la seule journée de hier : une voiture de police a reçu un parpaing sur le toit, cité Corot, tandis qu’à la Porte d’Aix, en-ville donc, une patrouille qui emmerdait un petit vendeur à la sauvette a été attaquée par plusieurs dizaines de personnes…
Il n’est pas rare que ça éclate en-ville, comme au Panier, il y a une dizaine d’années : un groupe de six inspecteurs s’est fait massacrer par les jeunes du quartier, place de Lenche, où ils avaient eu l’imprudence de venir dîner en terrasse une fois leur service terminé ; le vin aidant, ils ont commencé à apostropher des jeunes, et la réaction n’a pas tardé. Les six sont repartis sur des civières, un dans le coma. Les jeunes se les ont pris à coups de U, vous voyez ces U d’acier avec un gros cadenas qu’on met sur les scooters… Un canard parisien a titré alors quelque chose comme « le malaise des banlieues en plein cœur d’une ville française ! ». Même avec l’invasion des cultureux et des bo-bos, il y a toujours au Panier des bandes de jeunes à qui il ne faut vraiment pas aller chercher des embrouilles, ce qu’avaient fait ces flics. D’ailleurs, en ce moment, tous les nouveaux arrivants du quartier se font systématiquement cambrioler et saccager leur appartement, le journal La Provence a même dénoncé « la bande de la place de Lorette » comme responsable de ces actions… Pour le Parisien branché qui croyait se retrouver dans Plus belle la vie, grosse déconvenue !
On rejoint là ce que tu racontes dans La Racaille…. Marseille a un centre-ville pauvre, plus ouvert aux jeunes des cités…
Et cela crée un sentiment d’appartenance commune – que chacun décline aussi à sa manière, selon ses origines et ses affinités. En 1981, j’étais allé aux Minguettes avec des amis : ça m’avait espanté de découvrir à quel point, quand tu étais aux Minguettes, tu étais au mieux à Vénissieux, la commune sur laquelle la Zup a été bâtie, mais certainement pas à Lyon. Et quand on montait à Lyon avec des jeunes de la Zup, la ville nous faisait sentir qu’on n’était pas les bienvenus : avec cette hostilité feutrée d’un centre-ville fait pour les bourgeois.
À Marseille, les gens qui vivent dans les cités des quartiers Nord ou Est ne sont pas aussi radicalement exclu de la ville – en tout cas de ce qui fait l’essence de la ville, un espace où ça se mélange un tant soit peu, un espace où chacun puisse éprouver l’altérité ; et qui, en cela, est plus que la simple somme des parties périphériques. Bien sûr, quand tu vis à la Savine ou au Parc Kalliste, à l’extrême limite des quartiers Nord (après c’est la garrigue…), tu as rarement l’occasion de descendre en-ville – pour l’OM, ou un concert de rap. Tu descends d’abord à Saint Antoine, ou à Grand Littoral. Mais tu sais que si tu descends en-ville, tu ne seras pas en territoire hostile.
Autre chose : l’immigration actuelle est en grande partie nord-africaine, c’est à dire méditerranéenne. Et tout autour de la Méditerranée, on a des codes communs : le rapport à la parole – la tchatche – mais aussi au silence, la culture du trafic et de l’arrangement, un certain sens de l’honneur et de la pudeur, la solidarité instinctive du groupe, etc. bref, un ensemble de choses qui constituent les éléments d’un langage. Celui-ci est peut-être pauvre et empreint d’archaïsme aux yeux d’un intellectuel parisien, mais il existe. Quand les immigrés arrivent à Marseille, ils découvrent des fonctionnements locaux dans lesquels ils n’ont pas trop de mal à entrer, des fonctionnements assez claniques, qui génèrent à leur tour un fort sentiment d’appartenance local, au quartier ou à la cité, et qui vont de pair avec une identification à la ville tout entière.
Pour revenir à votre question… Les éléments qui ont nourri la révolte de 2005 sont présents à Marseille comme ailleurs, mais ils réagissent entre eux selon une alchimie différente.Si la tragédie de Clichy-sous-Bois s’était produite ici, je peux vous garantir que ça aurait explosé. Mais même en ce cas, cela se serait exprimé sans doute un peu différemment ; si un jeune incendie une voiture dans une cité des quartiers Nord, il a vraiment intérêt à bien la cibler parce que tout le monde se connaît…
« Les éléments qui ont nourri la révolte de 2005 sont présents à Marseille comme ailleurs, mais ils réagissent entre eux selon une alchimie différente. »
Ce n’est pas la même chose à Paris ?
Je n’ai pas l’impression. J’ai plusieurs fois entendu des Parisiens descendus ici me dire : « Les jeunes de la banlieue, là-haut, ils sont vraiment durs, impossible de parler avec eux, le moindre problème ça tourne à la violence, alors qu’ici vous arrivez assez bien à gérer tout ça avec la tchatche… » Ce qui ne manquait pas de m’amuser : quand je vivais en France, dans les années 1980, j’entendais régulièrement cette remarque : « Oh, les Marseillais, tout ce qu’ils savent faire, c’est parler… » Au moins, nous, on sait faire ça, parler... Après, ne rêvons pas, il y a ici aussi des situations où la tchatche ne fonctionne plus.
Pour revenir à l’hostilité des jeunes de cités envers les flics… elle s’exprime ici beaucoup autour du football, comme le confirme une série récente d’affrontements en-ville après-match. Le clou, ça a été quand les supporters du PSG sont descendus en-ville en octobre 2009…
Ils se sont jetés dans la gueule du loup, non ?
Je comprends ! L’annulation du match, annoncée deux heures avant, avait créé une situation inédite. Le dispositif policier, désormais bien rodé à chaque match OM-PSG, n’était pas préparé à ça. Tous ces escadrons de CRS, c’est lourd à déplacer… Du coup des centaines de supporters parisiens ont pu descendre en ville. Un groupe est monté aux Allées Gambetta attaquer le bar qui sert de local au Club Central des Supporters – juste eux, le pur club de pères tranquilles qui vont aux tribunes ! Le temps qu’ils cassent un peu par-là, les nôtres arrivaient de tous côtés, en scooter, en courant, et là les Parisiens ont reçu la grosse punition. Une femme leur a même jeté une télévision depuis sa fenêtre… Ensuite les CRS sont arrivés, et ont réussi à isoler les Parisiens en nous arrosant de grenades lacrymo et à les accompagner jusqu’à la gare. Mais même là-haut, à St Charles, certains des nôtres ont continué à les harceler en passant par les voies ferrées… Une fois les Parisiens partis, ça a continué : les voitures de flics se sont faites systématiquement caillasser pendant toute la soirée.
En même temps, au Vieux Port, ceux de Boulogne faisaient le salut nazi : forcément, tout le monde est devenu fou… Les flics les avaient tirés des mains des Marseillais et repoussés contre des immeubles ; les habitants leur jetaient des pots de fleurs, des œufs, des seaux d’eau, ça faisait très émeute médiévale. Il y avait de l’ambiance… une bonne humeur partagée dans les rues du centre. Pendant quelques jours, ça a été un sujet de discussion à l’apéro…
De façon générale, l’après-match d’une victoire importante est une situation assez chaude à Marseille. Quand des dizaines de milliers de gens occupent de façon spontanée le centre d’une ville, l’affrontement avec les flics survient, tôt ou tard. Ce n’est pas nouveau. En 1991, par exemple, quand l’OM a gagné contre le Spartak de Moscou en quart de finale de la coupe d’Europe, les affrontements ont duré des heures : on était sur le Vieux Port, les CRS sur la Canebière, et ça a cartonné, caillasses contre lacrymo… Scénario inverse un mois après, quand on a gagné contre l’AC Milan en demi-finale : là, on tenait la Canebière et eux le Vieux Port. La seule présence des CRS avec leur équipement suffit à faire remonter la haine, après ça part tout seul.
Hors du foot, quand est-ce que les premières révoltes d’importance ont eu lieu à Marseille ?
Ça a explosé en octobre 1980, le jour où un CRS a tué un jeune dans le quartier Nord. Du coup, les quartiers ont déboulé au centre-ville, à la Préfecture, et se sont bastonnés avec les CRS. C’est la première et la seule fois où la banlieue a tapé au cœur d’une ville, indépendamment d’une manif lycéenne ou étudiante. Ça a duré toute une soirée, avec le centre-ville inondé de lacrymos… Le gars est mort le samedi soir, et ça s’est passé le lundi en fin d’après-midi (c’était une marche en l’honneur de la victime, mais qui a fini en baston général). Après, ça a été chaud pendant plusieurs années – jusqu’à ce que la poudre - l’héroïne - ruine toute l’énergie.
À la Cayolle, toujours en 1980, après un déboulé massif et particulièrement brutal des flics dans la cité (lui-même consécutif au caillassage d’une voiture qui coursait un voleur de moto), les gens ont barricadé les accès et ouvert le feu sur le premier car de flics qui s’est présenté ce soir-là. Six mois après, les gars du SAC [5] (parmi lesquels des flics) faisaient sauter une bombe dans un hall d’immeuble de la cité, tuant un gitan de huit ans…
Pour cet affrontement, quand les jeunes des quartiers ont déboulé au centre-ville, on retrouve le même mécanisme qu’en 2005 ? Un assassinat policier qui lance les hostilités ?
Oui. À l’époque, ça se concentrait beaucoup dans les cités de la Zup n°1 (la Busserine, Font-Vert, Corot, les Flamants, d’où était le jeune qui avait été flingué), d’autres aussi comme la Paternelle ou les cités de la Rose, plus à l’est (Frais-Vallon, Le Clos, etc.) ; et le Parc Bellevue, bien sûr, à Saint-Mauront. Et puis la Cayolle, toujours n° 1 au box-office (l’an dernier, les jeunes de cette cité perdue dans les quartiers Sud ont incendié un appartement témoin d’une zone pavillonnaire de luxe en cours de construction, qui va dévorer la pinède derrière la cité : « On veut pas de bourges ici ! », ont expliqué ceux qui ont été arrêtés les jours suivants). Mais, pour revenir à octobre 1980, le lundi en question ce n’était pas seulement les gars de ces cités des quartiers Nord qui étaient descendus en-ville : ça venait aussi de la Belle de Mai ou du Panier, Arabes et Blancs ensemble. Nous, on ne connaissait pas le jeune qui avait été tué, mais on s’est tous identifié à lui. [6]
Quant tu dis « nous », c’est qui ?
Une équipe d’en-ville et de la Belle-de-mai avec qui je traînais alors. Une bande composée d’une part d’anciens d’un lycée technique, qui avaient participé aux affrontements de la gare St Charles en 1979, et de l’autre de « rockers ». C’était looké cuir noir, beaucoup de bagarres avec des bandes de mias (les prolos-minets, sapés et qui allaient eux en discothèque), on allait harceler les CRS à l’occasion de concerts où, de toutes façons, on ne pouvait pas rentrer (les Stray Cats, Trust etc.)._ En ce qui me concerne, j’avais déjà pas mal circulé auparavant et vécu des situations d’affrontements dans la rue, pour parler de 1980/81, c’étaient avec ces gars-là que je marchais à Marseille.
Parfois, je bougeais, aussi. Par exemple, à l’été 1981, je suis monté à Liverpool. Et là-haut, grosse secousse…
Fallait être salement motivé, pour faire le déplacement jusqu’à Liverpool…
Sans doute ; c’était aussi une façon de s’échapper un peu de Marseille… On n’hésitait pas à manger des kilomètres quand on pensait que ça en valait le coup. Une bonne manière de voir le monde, quoi… Liverpool, j’y suis allé avec ma compagne de l’époque et un ami qui venait de sortir de taule.
On avait lu dans un canard français qu’une marche anti-police allait se dérouler le 15 août à Liverpool. On ne voulait pas rater ça : juste avant, au mois de juillet, toute l’Angleterre prolétaire avait explosé, aucune ville n’avait été épargnée, mais c’est à Liverpool que ça avait été le plus puissant. Un destroy incroyable ! Ils avaient même incendié des banques, des bâtiments entiers s’étaient écroulés ! Et donc, on s’est dit que ça allait forcément péter à nouveau pour le 15 août.
« On n’hésitait pas à manger des kilomètres quand on pensait que ça en valait le coup. Une bonne manière de voir le monde, quoi… »
À Liverpool, le jour de la marche, c’était la folie. C’est de suite parti au carton avec les condés. Les bobbys étaient très mal équipés, ils ont été laminés… Des vieux venaient nous encourager, l’ambiance était très sympathique. Et puis, Liverpool, c’était un peu le Marseille de l’Angleterre : ils ont leur propre façon de parler et une identité très portuaire, très ouvrière, et beaucoup ont connu un jour ou l’autre la prison. Les gens nous offraient l’hospitalité sans problème. Et comme à Marseille, presque toutes les usines fermées.
Un gars, rencontré pendant les affrontements du 15 août, nous promène quelques jours après vers le port, et énumère : telle usine, fermée il y a deux ans, telle autre il y a six mois etc. Quand, au bout d’un moment, je lui demande s’il y a encore une usine qui fonctionne à Liverpool, il me répond sans hésiter : « Yes, the cops ! » Lui-même a plongé peu après, pour une vieille histoire de casse, je n’ai jamais réussi à le revoir lorsque je suis repassé plus tard dans sa ville. Dommage, c’était un gars vraiment à la coule, un vrai scouser.
Une anecdote : le samedi, on se trouve dans le centre de Liverpool, une heure avant la marche, plein de condés partout, on va voir un groupe de jeunes, des blancs, tout de jeans vêtus, on leur dit qu’on est venu pour la marche, ils hallucinent (« Hey, they’re coming from France for fighting the riot ! »). On sympathise, et à la fin ils nous demandent si on avait pris des couteaux avec nous en vue de la marche… C’était le samedi, hein, le lundi, dans le canard local, on voit que, parmi les flics blessés, il y en avait un dans le coma après s’être pris un coup de lame…
On a quand même fini par revenir en France, et on s’est aperçu que ça chauffait aussi, spécialement dans la banlieue lyonnaise. Je me faisais peut-être un film, mais entre l’Angleterre d’un côté et la France de l’autre, je voyais s’amorcer un saut qualitatif extraordinaire : tout ce qu’on avait vécu de façon éparse et isolée durant la décennie 70, tout ce qu’on avait connu dans la clandestinité du vécu quotidien, ressortait là de façon collective, une puissance énorme qui prenait corps. Nous, les « délinquants juvéniles », les voleurs de voitures du samedi soir, les chômeurs-à-vie, toute cette jeunesse qui ne s’intégrait pas, on en arrivait là, à occuper la rue, massivement et ouvertement. J’avais l’impression qu’il y avait comme un sujet historique qui déboulait comme ça, sans crier gare, et qui allait tout niquer. Une jeunesse qu’ils ne pourraient pas digérer, pas comme avec les étudiants. On est donc allés voir par là-bas, à la rencontre des gars à Vénissieux, dans la Zup des Minguettes. Après, on a aussi circulé en banlieue parisienne. C’était une période particulière, avec de bonnes énergies. On a rencontré beaucoup de monde, des gens parfois extraordinaires, dont celui à qui j’ai dédicacé le livre, Mustafa Amine, le « sultan noir » de Vitry.
Vers 1980-81 dans les banlieues, les gens cherchaient encore à se rencontrer, ça bouillonnait. Je vous parle là de rencontres informelles, ça ne passait pas par le truchement d’associations ou de structures socio-cul, ni de groupes politiques, juste quelques jeunes qui vont rencontrer leurs semblables dans d’autres banlieues d’autres villes. Dans un esprit très rock’n roll, comme c’était à l’époque. Je crois que ce serait impensable aujourd’hui, de se déplacer comme ça.
« J’avais l’impression qu’il y avait comme un sujet historique qui déboulait comme ça, sans crier gare, et qui allait tout niquer. Une jeunesse qu’ils ne pourraient pas digérer, pas comme avec les étudiants. »
Ça n’a pas duré ?
En 1983, date de la Marche des beurs [7], tout était déjà fini. L’optique s’était inversée : alors que les jeunes des cités se plaçaient en combattants en 1981, ils se posaient en victimes en 1983. Dans la banlieue lyonnaise, des jeunes immigrés se faisaient flinguer, par des flics ou des Français moyens [8] au doigt crispé sur le 22 LR.
Je comprenais la motivation des jeunes qui avaient lancé cette marche, j’en connaissais certains. Je suis resté en dehors, toutefois. J’y voyais un remake peu crédible de la Marche des Noirs américains pour les droits civiques, en 1965 –d’autant que Delorme [9] n’avait certainement pas le charisme de Martin Luther King. Mais, en tant que visage-pâle qui n’a pas à endurer personnellement le racisme, je ne me sentais pas autorisé à aller faire la leçon à des jeunes traumatisés par ces assassinats racistes se multipliant partout dans le pays. D’autant que du racisme, j’en souffrais aussi, d’une certaine manière – quand tu as des amis arabes, berbères, et que tu entends cracher le venin de la haine sur leur compte presque partout où tu vas, c’est insupportable. Mais je ne pensais pas que la Marche y changerait quoi que ce soit.
Ceci dit, même parmi la jeunesse d’origine nord-africaine, l’initiative n’a pas fait l’unanimité. Je me souviens d’une déclaration d’un collectif de jeunes immigrés de Nanterre qui y était hostile, dénonçant le fait que la marche était lancée par un prêtre et reçue à Paris par un ministre. Et ils se refusaient à réduire cela à un problème de droits civiques. C’est aussi ce que disait Mustafa, de Vitry : « Ce qui se passe dans les cités n’est pas une question de races, mais une question de riches et de pauvres. »
L’année 1983 correspond aussi au moment où la gauche abandonnait la social-démocratie pour le libéralisme déclaré. Et pour se différencier de la droite, cette gauche libérale allait s’appuyer sur deux axes : la culture - avec Jack Lang - et les droits de l’homme. Ils ont mis le paquet sur ça, sur du pur discours - la France est sans doute le plus gros producteur de discours au monde… Et puis, ils avaient senti une vraie puissance à l’œuvre dans la révolte des banlieues, et il leur fallait la neutraliser.
Pour toi, la marche de 1983 était une façon de canaliser la révolte ?
Pour ceux qui l’ont inspirée, Delorme, la Ligue des droits de l’homme, etc. clairement. Pour Toumi Djaïdja aussi. Pour les autres jeunes des Minguettes qui y ont participé, c’était différent, et sans doute assez confus.
Il faut rappeler que tout cela a démarré quand, à la suite d’affrontements en mars 1983 aux Minguettes, un jeune de la Zup, Antonio Manunta, a été emprisonné : ses copains ont alors lancé une grève de la faim pour sa libération. C’est là que Christian Delorme, prêtre à Vénissieux, est venu les voir et leur a livré tout un discours à base de pacifisme, de Gandhi… Les anti-racistes professionnels étaient là aussi, des avocats de gauche etc. Ils proposaient aux jeunes des objectifs négociables avec un pouvoir de gauche. Mais quoi ? La reconnaissance explicite par la République des jeunes immigrés « seconde génération » comme Français à part entière. En effet, ça a été le message de Mitterrand quand il a reçu à l’Elysée Toumi Djaïdja. Pensez un peu qu’il était le petit frère d’Amar Djaïdja, alors emprisonné, et pour longtemps, à la suite d’un casse ; ce dernier incarnait tout le contraire, rock’n roll à fond, c’était un des premiers s’étant amusé avec une BMW volée à percuter délibérément un car de flics, en pleine ZUP, en juillet 1981. Après le jeu s’est répandu et est devenu le cauchemar des patrouilles… Mais deux ans plus tard, Amar en prison, et Toumi reçu à l’Élysée !
Ce que j’ai vu alors, c’est comment s’organise le spectacle de la politique. Parce qu’au départ, il y a simplement des jeunes qui mènent une action de soutien à un copain enchristé – lequel était un fils d’immigrés italiens, il y en avait beaucoup aux Minguettes, pour dire que le racisme était d’emblée dépassé dans cette affaire où des jeunes, principalement nord-africains soutiennent leur copain italien sans se poser de questions. Et soudain, déplacement de perspective, il s’agit d’interpeller la France entière sur la question du racisme. Des gens qui mènent une action concrète – soutien public à un gars de la ZUP arrêté après un baston contre les flics - se retrouvent propulsés sur une action spectaculaire, i.e qui s’adresse à un public abstrait, représenté en dernière instance par les institutions, par le gouvernement.
Il y avait quand même un côté plus bienveillant de l’opinion publique dans les années 1980, non ? Quand tu racontes ton dégoût devant les réactions suscitées par la révolte de 2005 chez les anciens, ça correspond à une évolution ?
Plus bienveillant ? Ce n’est pas le souvenir que j’ai. Une évolution ? J’ai des copains de 40-50 ans qui ne parlent pas volontiers de ce qu’ils ont vécu quand ils en avaient 20 : il y a comme une auto-censure, sous-entendu « Ouais, on était jeunes et complètement cramés ». Face à cette nouvelle génération – disons celle de 2005 – , ils se renferment sur eux-mêmes. Ils se plaignent de ce que ces jeunes ne respectent rien ni personne – à commencer par eux, les anciens. C’est vrai qu’il y a un problème de respect, mais je crois qu’il s’agit d’abord d’un manque de confiance entre générations. Après, au niveau de l’adolescence, on observe aussi des comportements chroniques qui sont parfois à la limite de la sociopathie – et là-dessus, jeunes immigrés des banlieues et jeunes de la classe moyenne blanche sont à égalité. La moindre réflexion d’un adulte qui pourrait être interprétée comme une manifestation d’autorité, et la réaction violente advient immédiatement. Ne croyez pas que je me la joue « Ah, les jeunes d’aujourd’hui… » : j’étais comme ça quand j’avais leur âge. Et je sais que ça ne m’a pas toujours aidé… Les anciens dont je parle, ils ont connu ça aussi et ils voient ceux de la nouvelle génération encore plus à cran, encore plus cramés – parce qu’en plus, la cocaïne, le crack, le rohypnol et toutes ces saloperies n’arrangent rien. Bref, en 2005, ces anciens n’arrivaient pas à voir la différence qualitative entre cette violence bornée du quotidien et celle d’un affrontement collectif contre l’État.
Que les « grands frères », qui sont plutôt des pères de famille, maintenant, soient ainsi dans l’incompréhension, c’est terrible. Parce que la transmission de l’expérience, la constitution d’une mémoire, est quelque chose d’essentiel et que son absence explique aussi certaines formes de la révolte actuelle. Quant aux plus anciens, la première génération d’immigrés nord-africains, les pères de famille qui ont 60 ou 70 ans, certains tiennent des propos encore plus durs à l’encontre de cette jeunesse. Dans mon immeuble, je sais par exemple qu’il y a au moins deux pères de famille arabes qui ont voté Sarkozy à la présidentielle (je le sais par d’autres Arabes de l’immeuble, qui en étaient ulcérés). Ce n’est pas difficile de deviner pourquoi : pour eux, Sarkozy incarne le rétablissement de leur autorité de père de famille qui a été bafouée.
« Que les "grands frères", qui sont plutôt des pères de famille, maintenant, soient ainsi dans l’incompréhension, c’est terrible. »
Pourtant, tous n’ont pas eu un regard négatif sur les émeutes spontanées de 2005 ou 2007…
C’est vrai… je cite là des cas limites. Les choses sont plus nuancées, en réalité. Et puis, en 2005, la tranche d’âge des révoltés était plutôt large : ça allait de gamins de 12 ans jusqu’aux grands frères trentenaires. Si les « grand frères » sont supposés calmer les plus jeunes, il peut aussi arriver qu’ils les fassent bénéficier de leur propre expérience dans l’affrontement avec les flics… En tout cas, il serait souhaitable que cela arrive plus souvent, l’immaturité et l’inexpérience ayant parfois des conséquences catastrophiques, comme on l’a vu avec des incendies d’autobus. Les plus âgés sont souvent enfermés dans le rôle des grands frères responsables qui appellent au calme, et en tant que tels ils n’ont que peu de crédibilité auprès des plus jeunes quand la rage explose après la mort d’un des leurs, alors qu’ils peuvent contribuer à ce que la violence soit plus ciblée. On en revient à ce que je disais il y a deux minutes, sur la confiance et le respect. À Clichy-sous-Bois, là oui, des adultes ont participé, surtout après que les CRS aient balancé une grenade lacrymogène à la sortie de la mosquée. À Clichy ça a pris un caractère plus proche de ce que j’avais vu en Angleterre en 1981.
En même temps, c’est aussi quelque chose que Sarkozy a utilisé, dont il s’est servi…
C’est clair qu’il a tiré son épingle du jeu. Et que l’événement a alimenté la surenchère sécuritaire, le discours répressif. Mais il en aurait de toute façon été ainsi. Au téléspectateur-électeur, qu’importait la mort de deux adolescents à Clichy ? « S’ils ont fui, c’est qu’ils avaient quelque chose à se reprocher », je l’ai lu tant de fois, dans les jours suivants cette tragédie, dans les commentaires de sites internet ! Mais les voitures brûlées… La dramatisation médiatique exploite un pur registre affectif, en l’occurrence la réaction de l’électeur-téléspectateur qui est également propriétaire d’un véhicule automobile. Et savoir exploiter ce registre, c’est gouverner la France.
Je veux dire que les discours en bois que j’entends par-ci par-là, genre « les jeunes des banlieues se sont fait manipuler par Sarkozy », me niflent sérieusement. Ce pays est de toutes façons plongé jusqu’au cou dans le sécuritaire, et il sera bientôt difficile de trouver un angle mort pour éviter la vidéosurveillance, pour ne pas être tracé en permanence par les puces RFID et échapper aux techniques d’identification toujours plus affinées. J’évoque dans La Racaille… cette volonté d’aller vers l’état d’exception permanent, en notant qu’elle est de toute façon inhérente au concept de l’État souverain. La gauche, dont tout le discours est basé sur le fantasme idéologique d’un État bienveillant qui redistribuerait les richesses de façon égale, a fini par faire oublier aux classes laborieuses ce qui a longtemps été une évidence.
À savoir que l’essence de l’État, c’est la guerre. Ou du moins la spécialisation de la guerre, la guerre comme activité spécialisée, comme division particulière du travail. _ Au fondement du système étatique se trouve le fait d’imposer sa protection à des gens qu’on a désarmé. L’État, précisément parce qu’il détient le monopole de la violence, doit élaborer et perfectionner à l’infini des dispositifs de contrôle et de répression, qui se présentent aussi comme dispositifs d’assistance, appliqués aux populations qu’il prétend protéger. A ce stade-là, l’armée n’est plus qu’une composante de l’État, mais le système tout entier fonctionne selon la logique militaire d’une organisation verticale et centralisée.
Cela signifie aussi que cette gigantesque combinaison de dispositifs doit fonctionner de toute façon. Comme l’armée : il faut qu’elle ait régulièrement des occasions d’intervenir, dans un pays d’Afrique, en Afghanistan ou ailleurs, pour rester d’attaque : une armée qui n’a jamais l’occasion de faire la guerre se rouille. Donc, le ministère de l’Intérieur tend de plus en plus à fonctionner comme celui de la Défense. Il lui faut des ennemis, ciblés et isolables, pour éprouver sa puissance.
Dans cette épreuve, l’État trouve la confirmation de sa propre essence. Sans oublier une chose extrêmement importante : tout ce qui est actuellement expérimenté dans les banlieues pauvres pourra servir en cas de soulèvement général, soit en France, soit dans divers pays d’Afrique où la France est présente. Il s’agit là de véritables savoir-faire, qui peuvent être exportés dans le monde entier ; ça a par exemple été fait dans les années 1960 : en matière de tactiques et de stratégie contre-insurrectionnelle, liée à l’expérience des guerres coloniales, la France a apporté une contribution unique, rarement mise en lumière – même la CIA a appris des Français pour ses opérations en Amérique latine.
« Ce pays est de toutes façons plongé jusqu’au cou dans le sécuritaire, et il sera bientôt difficile de trouver un angle mort [...]. »
L’État fondait jadis sa légitimité sur la protection de ses ressortissants face à un ennemi extérieur (ennemi qui n’était autre qu’un État concurrent, bien sûr…). Mais dans les pays riches d’Europe occidentale, qui ont repoussé la guerre au loin, chez les « sous-développés », la protection de l’État doit à présent s’exercer face à un ennemi intérieur. Je pense que la France, de ce point de vue, a été d’avant-garde, parce que c’est le premier pays d’Europe à avoir reçu une immigration étrangère importante. A la fin du XIXe siècle, les immigrés de l’époque furent ainsi désignés à la vindicte des Français ; ce qui est nouveau à cet égard, c’est que l’État désigne maintenant à la même vindicte des gens qui sont eux-mêmes Français – des Français de seconde zone et première génération, sans doute, puisqu’on en vient à envisager la possibilité de leur retirer la nationalité en cas de besoin. Et l’on voit, de façon plus générale, des techniques jusque-là réservées au contre-espionnage appliquées couramment à des citoyens français. La fusion des RG et de la DST dans un service unique confirme bien cette évolution.
À présent, l’essence de l’État est en train de rejoindre son concept : garantir spectaculairement la protection de qui s’est laissé volontairement désarmer, contre qui ne s’est pas encore laissé désarmer. La banlieue pauvre constitue le terrain d’expérimentation privilégié de cette logique.
J’évoquais dans La Racaille… la figure paternelle de l’autorité étatique, qu’incarne le flic en uniforme auquel on ne s’adresse jamais sans un peu de crainte – ou de haine, dans certains endroits. Mais l’État en est arrivé à incarner aussi, en France, la figure maternelle. La majorité des Français ont à présent avec l’État une relation fusionnelle, qui est de même nature que celle d’un nouveau-né avec sa mère – alors que la relation au père implique toujours de la distance. Ils sont en demande permanente de cette protection qui vient d’en haut, de l’État et de ses spécialistes. Lesquels les traitent comme de petits enfants à qui l’on peut raconter ce que l’on veut. Une épidémie de grippe inédite est annoncée ? L’État veille, qui commande des tonnes de vaccin comme il commandera une autre fois des tonnes d’obus, toujours pour vous protéger. Seul problème, l’épidémie était elle-même une invention du ministère de la Santé… Et tout à l’avenant. C’est ce désarmement initial et final des gens qui les rend à présent réceptifs à n’importe quelle manipulation gouvernementale, par exemple les discours sur l’insécurité et les jeunes de banlieue.
C’est en tant que système destiné à faire la guerre que l’État devient une institution politique (ce qu’il est dès le départ). J’ai consacré un gros chapitre à cette transformation, dans mon livre sur Marseille, ce moment historique qu’on appelle la Révolution française. La structure militaire de l’État est imprimée à la sphère politique : ce n’était pas évident, au départ, il existait des formes politiques autres, communautés paysannes, communes citadines, dont on voit ressurgir l’esprit en période de troubles (les sections populaires de 1792, la Commune de 1871). Mais elles sont toutes liquidées au profit de l’État comme unique institution politique. Que le politique soit ainsi modelé par le militaire, c’est l’acte de naissance de l’État moderne, on peut le dater – c’est la grande œuvre des Jacobins. C’est aussi pourquoi, contrairement à ce que l’on croit, l’État n’est finalement pas le lieu de la politique mais celui de sa liquidation. Il est le lieu du spectacle de la politique, qui se déroule sous les yeux de ceux qui ont été dépossédés de cette activité.
À partir de là, ceux que l’on a dépossédés, désarmés, les citoyens à présent terrorisés par la racaille, acceptent parfaitement que des gamins de 15 ans meurent pour rien – même pas pour avoir commis un délit, juste pour éviter un contrôle ou pour s’être amusé avec une mini-bécane. À Villiers comme à Clichy, ce sont des minots qui sont morts, presque des enfants, et la France entière semble trouver ça normal. Récemment, le 19 juillet, une certaine Élisabeth Levy [10] appelait, sur RTL, à envoyer l’armée dans les banlieues en disant « On est en guerre » (qui donc est censé recouvrer ce « on » ? les auditeurs de RTL, ou simplement les gens de son milieu social ?) : si cette radasse sortait un tant soit peu de sa bulle, elle verrait que la militarisation est déjà la réalité quotidienne de nombreuses cités de banlieue pauvre, à Villiers-le-Bel notamment. Les hélicoptères à basse altitude, qui braquent leurs projecteurs jusque dans les appartements en pleine nuit, ça évoque quoi, sinon la guerre ? Et celle-ci ne se mène pas seulement au détriment de quelques centaines de « racailles », mais de tous ceux qui vivent dans les cités. Comme à la Courneuve, le 27 juillet : des gens, expulsés d’une barre d’immeuble destinée à la démolition, occupent la place publique et se font embarquer sans ménagement par les CRS. La Courneuve, c’est là où Sarkozy parlait de passer le Kärcher : il a tenu parole, et ceux qui ont été pénalisés ne sont pas les dealers qui hantaient l’immeuble en question – qui sont sans doute allés installer leur biz ailleurs - mais des familles d’immigrés, des femmes, des enfants, à présent sans logement. Et l’immeuble sera détruit comme il a été construit : sans discussion.
« [...] La militarisation est déjà la réalité quotidienne de nombreuses cités de banlieue pauvre, à Villiers-le-Bel notamment. »
Sarkozy s’est contenté de renforcer cette machine militaire, ce que fait chaque Président, et d’amplifier encore la rhétorique guerrière contre les banlieues, ce que fait tout candidat éligible à chaque élection présidentielle. Ce côté hargneux qu’il affiche en plus, c’est l’image d’une droite à l’américaine, « décomplexée » comme il dit. Ce n’est plus la France des notables, c’est celle des managers. Quant à la gauche, elle a une responsabilité énorme en France parce qu’elle a fait intérioriser par le monde ouvrier le culte et l’idéologie de l’État, à travers le discours républicain – regardez par exemple la genèse d’un des principaux corps de répression, les Compagnies Républicaines de Sécurité. L’esprit d’insubordination à la Loi, qui hantait les mondes ouvriers d’avant la Première Guerre mondiale, a été pacifié par les militants de gauche - la haine du flic était pourtant forte chez les ouvriers si l’on en croit les témoignages de l’époque. Ce qui a contribué aussi à interdire toute connivence des générations : parce que nous voyons bien que la haine des flics persiste chez les jeunes des quartiers pauvres, qu’elle se reproduit d’une génération à l’autre. Des Apaches de 1900 aux « racailles » de l’an 2000…
Ceux qui déplorent et blâment le caractère sauvage des révoltes de 2005 feraient mieux de prendre la question dans l’autre sens : le discours idéologique républicain a anesthésié toute culture de la révolte. Tout est tellement institutionnalisé dans ce putain de pays… Aucun espace n’échappe à l’État et à sa logique, relayée par les partis et les syndicats. Où existe-t-il aujourd’hui un espace public qui ne soit pas configuré par des dispositifs mis en action par l’État, par ses administrations ? Les manifs ne vous laissent que le droit de défiler sur le parcours autorisé – essayez simplement de sortir du cortège pour aller écrire un slogan à la bombe de peinture sur un mur, et la BAC intervient aussitôt, et ce ne sera certainement pas le s.o de la manif qui ira vous en libérer. Le moindre écart est aussitôt puni.
Dans les mouvements de jeunes, il y a plus de fraîcheur et de joie de vivre, ils ne sont pas engoncés dans les institutions politiques et syndicales. Et pourtant, celles-ci sont à l’affût : prenez l’exemple des services d’ordre syndicaux. Dans les manifs lycéennes où on allait, avec mes amis, en 1973, les gros bras de la CGT cherchaient déjà à imposer leur loi, à empêcher tout débordement. On pouvait se demander : qu’est-ce que fichait la CGT dans une manif lycéenne ? Ils nous traitaient d’éléments extérieurs (alors qu’on avait encore la plupart de nos copains dans ces lycées et collèges) ; mais eux, alors ? Depuis, ça n’a pas changé : en 2006, les petites frappes du s.o CGT faisaient la chasse aux jeunes à capuche dans le mouvement anti CPE. Soi-disant pour éviter de nouvelles agressions, comme aux Invalides. Et les lycéens se trouvaient ainsi infantilisés, comme s’ils n’étaient pas capables de s’organiser pour assurer leur propre défense. En réalité, les partis et les syndicats cultivent une telle incapacité : les gars, manifestez gentiment, selon le parcours autorisé, nous on s’occupe de votre sécurité. C’est ainsi qu’on fabrique une génération immature, inapte à la moindre confrontation physique. Et ça, c’est la gauche.
![]()
Notes
[1] Photographie prise depuis le balcon de l’appartement d’Alèssi.
[2] Publiée aux éditions Agone. Il revient sur cet ouvrage dans la deuxième partie de l’entretien.
[3] Aux éditions L’Échappée, réédité très récemment par les éditions Agone, sous le plus fade titre La Rage et la révolte. On parlait de la première édition ici.
[4]
[5] Le SAC (service d’action civique) a été créé par des gaullistes en 1960. Rapidement devenu une milice de droite, la prétendue association a multiplié, jusqu’en 1982, les tabassages de gauchistes, coups tordus, attentats et même assassinats.
[6] La Cayolle.
[7] La Marche des beurs, lancée par des jeunes des Minguettes, est partie de Marseille, le 15 octobre 1983. Le cortège s’est étoffé au fur et à mesure qu’il avançait sur Paris et s’est terminé, le 3 décembre, par une grande manifestation parisienne réunissant 60 000 personnes.
[8] Ainsi, par exemple, de l’assassinat d’Habib Grimzi, jeté du train Bordeaux-Vintimille par trois légionnaires, alors même que la Marche des beurs remontait vers Paris.
[9] Le prêtre Christian Delorme était l’un des organisateurs de la Marche.
[10] Éditorialiste réactionnaire officiant notamment sur le site Causeur.
Suite à lire
http://www.article11.info/spip/spip.php?article890
Alèssi Dell’Umbria (Part. II) : "Patience, ils sont tous en train de se tirer une balle dans le pied"