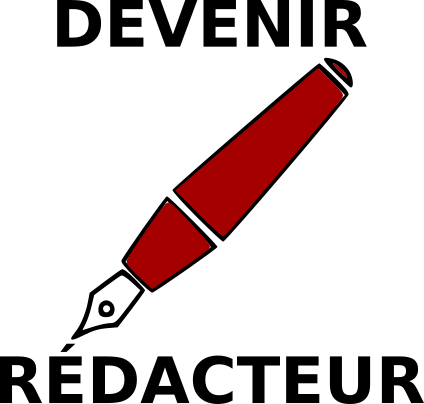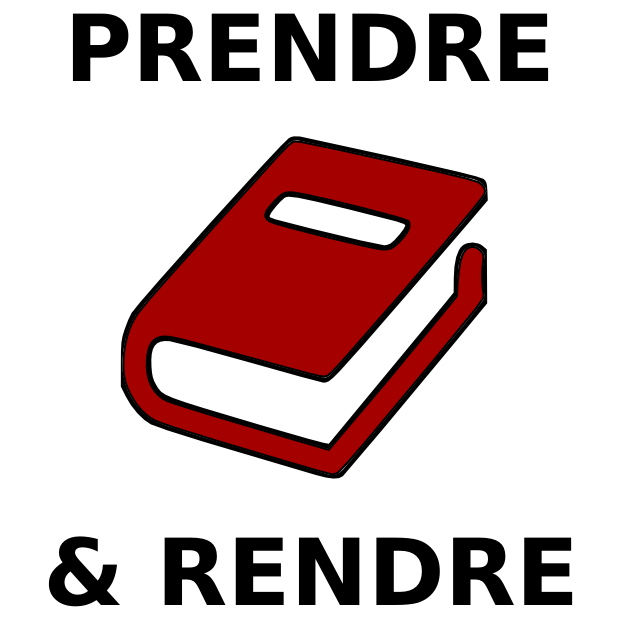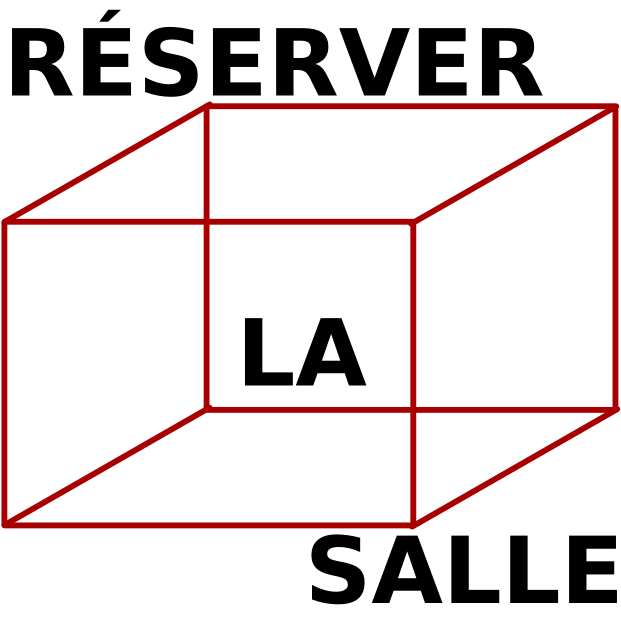Texte libre
Ce matin de décembre deux mille quelque chose ou trois mille quelque chose, peu importe, le réveil sonne, imperturbablement. Six heures déjà. Mes sens doucement s’éveillent au monde, à la naissance de cette journée banale, d’un temps indéterminé, aux confins d’un siècle ou aux balbutiements d’un autre. Lentement, le cerveau tente de se remémorer la date, puis énumère en une fraction de seconde les tâches à accomplir aujourd’hui. L’ouïe, assoupie depuis plusieurs heures, capte avec une précision étonnante les bruits extérieurs, ces petits sons familiers qui vous indiquent le temps qu’il fait. Il neige, il neige certainement : sons feutrés et lointains relayés par les hauts parleurs branchés sur le monde de dehors. La nature a mis sa patte de velours. Un coup d’œil à l’écran branché sur le monde de dehors : à n’en pas douter, l’aurore est lumineuse, scintillante à ravir d’une discrète auréole.
Un pied, deux pieds, la marche se réapprend chaque jour. Je n’aime pas cette chasse d’eau automatique. Je grogne « café », l’affaire est en marche, la valse des objets animés débute d’un pas mesuré, d’un temps régulé, efficace, sans nuance. La valse ! Je revois encore ce film sur lequel mes arrière-grands-parents dansaient la valse pour leur trentième anniversaire de mariage. Qu’elle drôle d’époque ! Sans doute pleine d’imprévues, de mystères, de … Non, pleine de morts, de maladies, d’inconfort, de doutes, de réponses multiples et déstabilisantes. Froid dans le dos. Le petit déjeuner me rappelle à l’ordre. Tout est prêt et je ne peux résister aux appels déchirants de ces objets, cette nourriture douée de parole. Pas de temps à perdre, en plus, me rappellent les voyants lumineux du grand agenda des journées d’activité. La classe à préparer et, cet après-midi, aider le dernier de cinq mois à assister à sa séance télévisée d’ordonato-psycho-matologie. Quand je pense à l’erreur que nous avons faite, malgré tous les rappels sonores et visuels de notre puce personnalisée. C’est fou et impardonnable. Au cinquième mois de grossesse, oublier de prendre les gouttes de psycho-mato-maturité qui bloquent les mauvaises communications de l’environnement, des quelques pensées du père et de la mère qui peuvent encore s’échapper du fin fond des ères passées. Le blocage de l’histoire n’est pas encore totalement réussi. Il faudra sûrement encore quelques générations. Une erreur, une erreur, qui sait, et si c’était comme une rébellion, comme un sursaut de vie, pour se prouver ne serait-ce qu’une seconde sa propre existence, lutter contre l’infantilisation, la lâcheté, l’abandon de soi ? Et si c’était comme une gangrène de résistance au codé, à la marche forcé des temps vers l’Eden, à la fatalité de la pliure de nos consciences ?
Le petit déjeuner me rappelle à l’ordre. La lumière clignote, le café refroidit. Café, café, qu’est-ce c’est, au fait, ce breuvage ? Comment ils le fabriquent ? Vieux mots calqué sur une réalité inconnue. Que veulent dire les mots, à quoi servent-ils ? Deuxième et dernier rappel à l’ordre des objets. Il faut boire ton café, sinon il va te sauter à la gueule. Rappel à l’ordre du générateur de langage correct et admis. Du calme, ce matin, mon ami, du calme. C’est la neige qui te perturbe, enfin le mot neige. Quelle sensation c’est, la neige ? Neige, sensation, des mots, que veulent dire les mots, à quoi servent-ils ? La tasse se renverse.
7 H 50. Bientôt l’heure de mes cours. Je m’installe dans ma salle de classe intégrée au logement, 10 m² d’écrans, de caméras, de claviers. 8 H. L’heure de la rentrée. J’allume tous les récepteurs. Tout le monde est là. Parfait. Poste numéro 4, tenez-vous droit et raccrochez vos boutons de culotte. Et je tape, je tape, je tape, j’émets des sons, des sons, des sons, pour transmettre aux petits installés chez eux dans une même pièce de 10 m², électrodes branchés au front, le savoir de base indispensable pour qu’ils se développent harmonieusement et correspondent à ce que le monde de dedans attend d’eux, le socle commun de connaissances qu’ils appellent. Quatre heures de cours, entrecoupées toutes les trente minutes de poses de publicité qui permettent à la société d’éducation qui m’emploie de me rémunérer, d’acheter le matériel et de remplir son escarcelle de biens allégoriques.
12 H. Le plateau repas est servi. Il faudra penser à commander les repas pour les quinze prochains jours. Je mange en compagnie de ma femme et de mes deux enfants. Nous nous sommes rencontrés, ma femme et moi, comme tous les couples, grâce aux émissions d’accouplement formaté. Notre couple est fonctionnel. Nos émissions personnalisés n’ont jamais rien trouvé d’anormal. Arrivés au point où nous en sommes de maturité, cinq ans de vie commune, deux enfants qui sont notre propriété provisoire, nous allons passer à la phase échange et dialogue, et trouver un autre couple afin que nous fassions l’enfant supplémentaire et obligatoire que nous élèverons ensemble. Deux enfants et demi par couple pour satisfaire à la survie durable du monde de dedans, pour fournir exactement le nombre nécessaire de main d’œuvre, c’est la norme actuellement. Cela se fera normalement, en laboratoire. L’émission obligatoire de chaque jour commence à 14 H. Il faut la regarder car on ne sait pas quand ce sera notre tour et il faut être disponible de suite.
14 H. Silence. Je suis assis, une main dans une poche, et mon regard est distrait, mon attention comme absente. Je vais me faire rappeler à l’ordre. Mais ce bout de papier sale que je touche, là, au fond de ma poche, sur lequel mes doigts glissent, que ma peau caresse avec un sentiment vague de plaisir, comme une volupté inconnue mais vraie. Comment suis-je tombé, un jour, par hasard sans doute, sur ce bout de papier voletant au gré des ventilateurs dans une impasse souterraine. J’avais mis un temps fou à mettre un nom à ce que je venais de ramasser. Il m’avait fallu rechercher dans ma mémoire quelque émission pédagogique racontant les différents supports qu’avait utilisés l’homme pour écrire. Du papier ! C’était la première fois que j’en touchais réellement. Une adresse inscrite et un sigle, imprimés bizarrement avec une matière inconnue qui avait une odeur, une vraie, un peu forte.
Est-ce la neige qui tombe toujours mélancoliquement, comme un tendre soupir ? Est-ce cette émission devenue agaçante tout à coup ? Les enfants soudain apparus difformes, inexistants ?
Il faut que j’y aille.
J’y vais.
Le jour a largué les voiles dans les rues souterraines dénuées de hublots. La nuit navigue entre les écueils de lumière artificielle. Serrant mon papier au creux de la main, je marche d’un pas rapide. Personne à cette heure, mais les caméras ont sûrement détecté ce désordre soudain dans ma personne. Tant pis. Il faut aller vite. Quelques hésitations. Là, voilà, c’est ici. Une caverne comme une autre, anonyme. Je sonne, on m’ouvre. Senteurs, vertige, serrement de main inhabituel, inattendu, transmettant la chaleur, la moiteur l’énergie d’un ouragan tropical.
Une immense salle me tend les bras : moquette, petites tables entourées de chaises en bois, en bois !, de vieux fauteuils de cuir craquelé empreints de formes diverses, et, tapissant les quatre murs, d’immenses étagères où se calfeutrent des milliers de livres, de vrais livres, des journaux, des illustrés, toutes sortes de brochures en papier. Je rêve, je déambule hagard, et surtout je touche, je respire, j’hume le fumet enivrant. La vie est là, je la sens me pénétrer, me mordre les entrailles, me baiser. Les rares personnes présentes me soutiennent, m’encouragent, heureuses de cette nouvelle naissance. Il faut que je lise, que je lise. Instinctivement, je me retrouve devant un rayonnage consacré aux livres sur l’école. Je prends un livre « Ecole rurale, communication et technologies nouvelles », datant de 1995, la préhistoire ! Je feuillette et m’arrête sur un article « Qu’est-ce qu’un vrai outil de communication ? Un exemple : un hebdomadaire en classe unique », et je lis, et je lis…
Pour qu’un outil pouvant permettre la communication soit vraiment un outil de communication, il doit remplir quelques conditions :
Que chacun puisse l’utiliser et y exprimer ce qu’il veut, au moment où il veut ;
Que l’on soit sûr que le message émis sera lu, entendu, reçu ;
Que son utilisation se fasse sans espoir, c’est-à-dire que chacun accepte, après avoir émis une information, de ne recevoir aucune réponse, ou de recevoir des réponses différentes de celles qu’il attendait ;
Que cet outil soit un des éléments qui permettent à une structure de vivre et à une multitude de structures de s’interpénétrer ;
Que la taille de ces structures soit petite et que leur composition soit la plus hétérogène possible.
Le journal scolaire peut être un vrai outil de communication. Voyons cela à partir de l’exemple du journal d’une classe unique dont le titre est « Les aubépines en fleurs ». Ce sont les premiers élèves qui l’ont créé qui lui ont donné ce nom, en 1979, qui est resté toujours le même au fil des ans, comme un symbole de la continuité qui existe en classe unique, de cette vraie histoire qui se construit d’année en année, de cette dimension du temps passé, présent, avenir qui fait trop souvent défaut dans la plupart des écoles, dans une époque qui ne reconnaît que l’instant présent, la rentabilité immédiate, la satisfaction instantanée.
Mais ce journal, dans ces premiers temps, ne remplissait pas tout son rôle de vrai outil de communication : étant vendu dans le village, les enfants, inconsciemment, ne pouvaient pas écrire ce qu’ils voulaient ; il y avait des moments précis bien définis pour travailler au journal, même pour écrire les textes ; il était une juxtaposition de textes dits libres, mais ne reflétait pas une vie de groupe parce que la structure de la classe était moribonde (coupée du monde, peu de communications internes, emploi du temps rigide, travail individuel des élèves dirigé par un plan de travail de style contrat). Le journal n’était qu’une cerise sur le gâteau dont la recette était définie ailleurs.
Pour que ça change, il fallait que la vie entre dans la classe, que les fenêtres s’ouvrent. Cette vie, ce fut un réseau de classes qui l’amena et ses échanges par minitel, puis par internet. Cette vie, ils l’ont prise tout doucement, avec des pincettes, sans jamais répondre au début, mais les messages des autres écoles suscitaient des échanges divers entre les élèves et avec le maître. Du coup, ils existaient, ils avaient plein de choses à se dire, à se raconter, des tas d’expériences à se communiquer. Les individus existaient, le groupe existait, la structure se construisait de ces richesses. Et avant de participer vraiment au réseau, il a fallu que cette communication interne se mette bien en place, que chacun et le groupe se prouvent « qu’on est, que nous sommes, qu’elle est, que je suis, que tu es… ». Ils ont demandé alors de recevoir des journaux d’autres écoles et ont décidé que « Les aubépines en fleurs » ne serait plus vendu dans le village pour pouvoir dire ce qu’ils voulaient, mais envoyé aux autres écoles. Echanges avec toute la France, mais aussi avec la Roumanie en pleine révolution, l’Uruguay, le Sénégal, un village dans la forêt de Guyanne, la Finlande.
L’introduction du fax fut le déclic pour lancer un hebdomadaire. Par sa rapidité, son immédiateté, sa façon de rendre très proches des gens très lointains mais avec de l’émotivité, presque de la sensualité, le fax leur a fait ressentir comme insupportable d’attendre un mois ou même quinze jours pour publier tout ce qui se passait, et encore, combien de recherches, de discussion, de textes laissés de côté, faute de temps, d’envie ou de volonté. Ce fut donc l’apparition de l’hebdomadaire, faxé chaque vendredi à 27 écoles différentes. Du coup, le journal fut conservé, mais avec une parution mensuelle, pour le village, avec les textes des hebdomadaires que les auteurs acceptaient de voir apparaître dans le mensuel.
Les communications, la vie, ont pris toute la place et ont été le vecteur des apprentissages.
L’hebdo est devenu un vrai outil de communication :
Chacun peut y écrire ce qu’il veut, quand il veut. Il n’y a pas de moments dans la journée pour obligatoirement écrire puisque chacun le choisit suivant ses projets personnels ou ceux d’un groupe ou de la classe. On n’est pas obligé d’écrire ;
Ils sont sûrs qu’ils sont lus : par leur histoire et leur expérience, par des retours (réactions, demandes, emprunts ou traces dans d’autres journaux…) ;
La plupart sont arrivés à écrire dans l’hebdo sans espoir d’un retour. S’il y en a un, on est content, sinon, tant pis. Jamais un élève n’a renoncé à écrire parce que personne n’avait réagi. Il sait qu’il existe par la vie du groupe, il sait qu’il est lu et entendu, il est reconnu pour ce qu’il est, il a un rôle dans la structure classe, il a un rôle dans les autres structures lointaines, sans forcément que celles-ci le sachent autrement que par ces écrits qu’ils lisent, puisqu’il est, plusieurs semaines dans l’année, responsable des messages du réseau, des journaux reçus, de la mise en page de l’hebdo. Il est donc forcément, à un moment ou à un autre, le vecteur de la parole des autres vers son groupe. L’espoir, au fil du temps, n’est plus aussi nécessaire et laisse la place à la liberté et à la gratuité.
L’hebdo renforce la vie de la structure, puisqu’il renforce la communication interne et en est souvent le reflet. Mais, dans l’autre sens, la structure, en évoluant vers toujours plus de communications, a entraîné la nécessité de l’hebdo. Par son échange avec d’autres, ses frottements et chocs avec les autres supports, il permet un incroyable maillage de structures différentes, sans qu’il soit d’ailleurs possible toujours de savoir qui elles sont.
La classe unique, par sa taille et son hétérogénéité, est l’espace-temps typique qui allie le bon nombre d’élèves et la diversité.
Voici quelques morceaux de titre ou de textes pris dans les hebdos de l’année. Ils montrent succinctement tous les genres d’écrits qu’on y trouve. Impossible, par contre, de faire figurer l’histoire de ces textes, leur genèse qui pourtant seraient plein d’enseignements : pourquoi tel texte arrive à tel moment, qu’est-ce-qui l’a déclenché, quels rapports a-t-il avec un autre récit ?
« Pendant les vacances j’ai fait du poney », « On a trouvé une abeille vivante dans la cour. Elle ne pouvait plus voler. Nous l’avons observée… », « On a vu un oiseau qui mange un ver de terre : il l’aspire comme un spaghetti… », « Histoire du fléau et de la batteuse », « Je demande à ma maman si on casse la croûte tout de suite… », « On a entendu la mer dans un coquillage… », « Mon oncle est tombé », « La clavicule est l’os de l’épaule… », « Un jour, avec ma petite sœur, on a vu un petit vaisseau spatial. Des Martiens nous l’ont fait visiter… », « Les Mérovingiens », « Il était une fois un gros bonhomme… », « On pense qu’il y a un rapport avec la vitesse et le poids… », « Chantourner, c’est couper des formes courbes dans du bois… », « Nous avons fait une recherche sur la façon de fabriquer les piles des ponts avec l’instituteur de la Bergerie… », « La classe de neige », « Ensuite, ma chienne et le chien jaune se sont collé le derrière… », « Comment se font les bébés », « Quand Florian met ses lunettes à l’envers, on voit ses yeux plus gros… », « Mon papa répare des tracteurs et des machines agricoles… », « Les couleurs quand ça chauffe », « Quand j’étais petite, je croyais… Mais après j’ai tout compris. », « J’ai fabriqué un moulin à eau… », « J’essaie, depuis que je suis toute petite de ne rien imaginer. Pas d’univers, je me dis il y avait du blanc, mais puisqu’il n’y avait rien, il n’y avait pas de couleurs… », « Mon week-end au futuroscope », « Les champignons chantaient… », « Quand j’étais petite je croyais qu’après la mort on redevenait un bébé. Moi, je ne me souviens pas d’être morte… ».
Je ne me souviens pas d’être morte, disait Alice, cette fille unique d’un couple d’agriculteur, perdue dans une minuscule ferme d’un hameau perché, dont les seuls compagnons sont les animaux de la ferme. Elle est bien vivante, elle le sait. Mais sait-elle tout ce qu’elle a appris aux autres par ses observations sur la nature ? Sait-elle ce que tous ses textes ont suscité dans le cœur d’un indien Wayanna, la tête blonde d’une petite finlandaise ou la tête crépue de Asmane le sénégalais ? Sait-elle ce qu’elle a donné au groupe de sa classe avec sa logique d’une brutalité déconcertante durant les sept ou huit ans qu’elle est restée dans cette école ? Sait-elle ce qu’elle a donné à d’autres groupes ? Elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais, et personne ne le sait. Mais nous savons que grâce à l’hebdo et à toutes les communications existant à l’école, et parce qu’elle a eu la possibilité et le temps de manipuler en toute liberté, durant toute sa scolarité primaire, différents langages qu’elle a fait siens, elle a pu, le jour où elle en a ressenti l’envie ou le besoin, après avoir lu des « Quand j’étais petite je croyais… » dans un autre journal d’une autre classe, oui, elle a pu dire au monde entier, de manière compréhensible, qu’elle ne se souvenait pas qu’elle était morte. Et qui peut dire que ce n’était pas essentiel et vital pour elle, et peut-être pour quelqu’un d’entre nous ?
Comme un coup de point dans le ventre. Je n’ai pas tout compris, mais j’ai ressenti. Qu’est-on devenu, qui suis-je ? Alice, ma sœur, ma mère, je t’entends plus d’un siècle plus tard et tu emplis mon coeur sec. K.O. debout.
Une femme me prend par le bras, c’est normal, la première fois, prenez ce verre d’eau. Nous franchissons une porte. Nous nous trouvons dans un atelier d’imprimerie, sale à ravir, d’une odeur d’encre fraiche que je ne connaissais pas et que j’avais senti sur le bout de papier logé dans ma poche. Il faut que j’imprime, que je manipule ces petites lettres de plomb. Mais que vais-je donc écrire qui vienne de moi, de moi ? Le vide insondable de mon esprit se cherche des crevasses. De longues minutes de réflexion, de prostration.
« La neige tombe. C’est tout blanc dehors. » J’ai trouvé. Heureux comme un enfant ayant découvert ses mains, je compose mon texte avec l’aide et le soutien de quelques personnes présentes. Oui, moi, j’ai fait un texte. La neige tombe. C’est tout blanc dehors. Un texte sorti de moi, non dit, non ordonné, non préformaté. L’ivresse est à son comble. Le rouleau, l’encre, la presse et le papier blanc devenu couleur, vie. J’y vois la neige danser la sarabande avec mon âme damnée à jamais.
Minuit déjà. Le temps s’est écoulé si vite. Il faut partir, quitter ce sanctuaire des mots. Tant de beauté, c’est trop fort. Et puis vont-ils me laisser retrouver ma famille ? Et puis… Malgré les conseils des autres me recommandant de rester là, je sors. Respirer l’air, en finir avec cette vie recluse, enterrée. Une porte s’ouvre devant moi, automatiquement, je m’engouffre, elle se referme. Je suis dans le monde de dehors que je ne connais pas. Respirer l’air ! Va, cours, vole, éclate en sanglots puisque tu es un homme libre. Il fait froid, mais que peut le froid contre la lumière intime. La neige est immaculée et j’y imprime mes pas, mes mots, mes pieds lourds, rouleaux. Mon cœur plein à craquer se métamorphose en matière éphémère. Je suis seul, perdu, trouvé, découvert, abandonné. De maigres oiseaux planent mollement de branches déchiquetées en troncs squelettiques. Au loin, dans un bruissement pointillé, un nuage approche, mouvant, animal. Ils ont senti la chair fraiche. Il fallait s’y attendre. Le vin des mots t’est monté à la tête, pauvre allumette éteinte.
Où suis-je dans ce monde de dehors ? Caverne N°5. L’entrée du souterrain est fermée. Peut-être la 10, proche de chez moi. Cours, mais je n’en ai pas la force. Le nuage m’entoure, me bourdonne sa joie et ma perte. Les fourmitorax et les guèposaures, ces énormes insectes devenus rois du domaine extérieur, se régalent d’avance. Enfin un homme, l’adversaire, l’éternel revanche à prendre sur l’histoire de la terre. Les yeux globuleux, haineux de venin conservé, m’observent, moi, la mouette des mers de feuilles, l’albatros retrouvé.
Je tombe à genoux. La neige éclate en cent milles sanglots. Je souris, j’embrasse le monde et palpe la beauté, mon texte imprimé, mon œuvre de ressuscité. La neige tombe. Tout est blanc dehors. Piqûres mortelles, allalie du gibier. Moi taureau, et l’arène applaudit. Taches de sang, d’encre. Corps allongé, F majuscule de plomb.
Sur le champ de bataille délaissé, les charognards, des rats géants, commencent leur festin.
Il ne reste bientôt qu’un léger papier blanc taché, hoquetant ridiculement à la brise nocturne. La neige tombe. Tout est blanc. Grignote. La neige tombe. Tout – La neige tom – La –
Il ne demeure plus qu’une empreinte vieillotte, belle d’inattendu, de naïve imprécision, scintillante à l’aurore naissante, balayée par la poussière blanchâtre d’un incendie lointain.
Chapitre suivant : Putain de neige