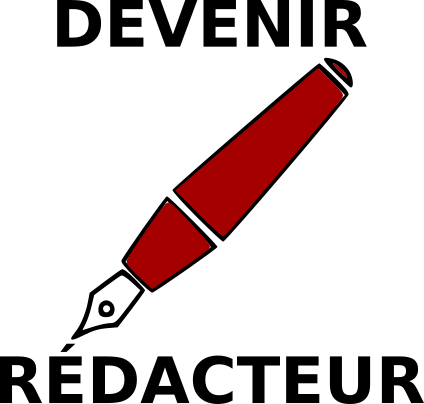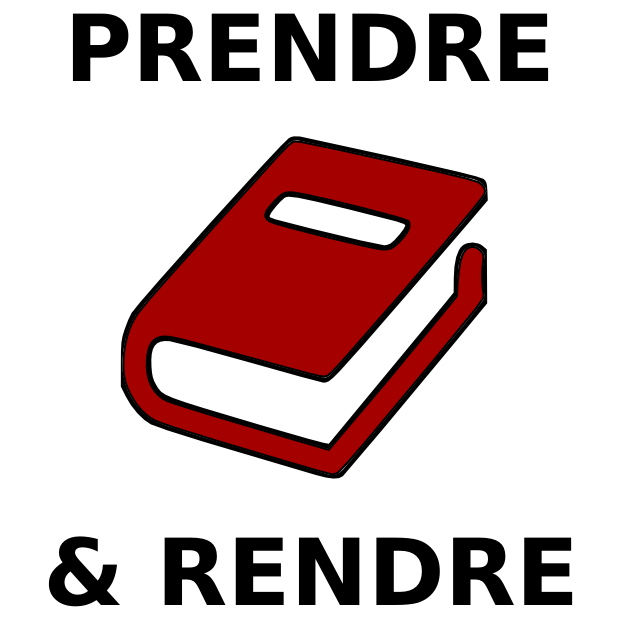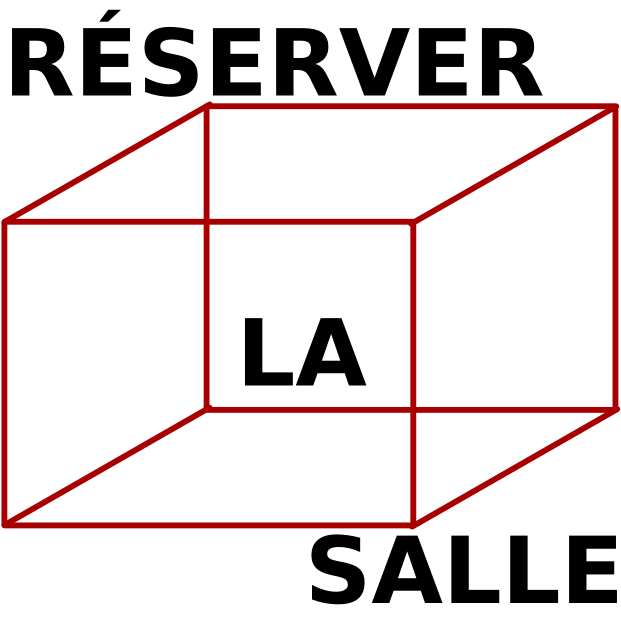Salut,
Mille babords... une nouvelle qui mérite d’être lue, la tragédie des sans-papiers :
http://www.nouvelocratie.bibliocrat...
Cdlt,
JD
Mare nostrum
Le bateau franchissait les vagues les unes après les autres, laissant sur l’eau un long sillage d’écume. Assis à la poupe, Georges tenait la barre du moteur d’une main ferme. Il se retournait souvent pour observer la traînée blanche, une longue veine ouverte, que la mer semblait peiner à refermer. Cette trace était la seule preuve qu’ils faisaient route vers quelque part.
Tout autour n’était que la mer. Au loin, quand le bateau montait sur une vague un peu plus haute que les autres, Georges apercevait l’horizon. Une mince ligne qui séparait la mer d’un immense ciel bleu. Pas une terre en vue, pas un navire, de l’eau, du ciel, une ligne qui les sépare, le soleil, et quelques humains, rien d’autre.
Pousser la barre pour infléchir le cap vers bâbord, tirer pour tribord. Réduire les gaz quand le bateau descendait une vague, donner de la puissance quand il gravissait la suivante. Georges avait acquis la dextérité nécessaire pour naviguer en haute mer.
Le soleil était bas maintenant, et la température chutait. Le vent et les embruns augmentaient la sensation de froid. Georges, en relevant le col de sa veste, eut la sensation de perdre quelque chose. A l’est était apparue la lune, et, au-dessus, quelques étoiles confirmaient l’arrivée imminente de la nuit. Si le ciel se peuplait, la mer, elle, demeurait immensément vide.
Georges regardait la lune, presque pleine, et la remercia. Sa faible lumière lui permettrait de continuer à distinguer le relief marin. Réduire les gaz, les remettre, éviter les petits rouleaux qui, parfois, naissaient au sommet des vagues.
L’homme consulta la boussole, puis vérifia que le GPS, la carte et le téléphone satellite étaient à leur place. Il sourit à la lune : finalement, tout allait bien, et elle faisait briller de blanc tout ce qui devait être vu. Mais pas ce qui arriverait.
C’est le car que Justine et Léa avaient choisi pour rejoindre Pozzallo. La climatisation les privait de l’air chaud de la Sicile, mais le véhicule roulait vite sur une autoroute en bon état. Elles seraient vite arrivées. Les deux jeunes femmes regardaient le paysage ras qui montait rapidement, sur leur droite, en collines et, au loin, en montagnes. Elles parlaient peu ; de temps en temps l’une ou l’autre prenait une photo à travers les vitres.
Le matin, elles avaient atterri à Catane en provenance de Paris. Le dépaysement avait commencé lorsque par le hublot de l’avion elles avaient aperçu l’Etna.
Le car s’arrêta dans la petite ville balnéaire de Pozzallo dans le milieu de l’après-midi. L’hôtel, par chance, était juste à côté, bien situé, à quelques rues de la plage.
Elles avaient trouvé un très bon tarif low-cost pour l’avion, le car avait coûté moins que ce qu’indiquait leur Guide du routard et l’hôtel, modeste, était d’un très bon rapport qualité-prix. _ Sans une minutieuse préparation budgétaire, les deux amies n’auraient pas pu se payer cette semaine de vacances qu’elles planifiaient depuis plus d’une année.
Une semaine au soleil, en Sicile, à ne rien faire. _ Simplement se reposer d’une longue année de travail.
Pozzallo était ce qu’il leur fallait, elles en riaient. _ Touristique mais pas trop, authentique sans être austère. Le soleil et la chaleur étaient là, les restaurants ne semblaient pas très chers, et les Siciliens étaient beaux et sympathiques.
Quelques mois auparavant elles avaient envisagé de partir plutôt en septembre, mais Léa venait de se séparer de son compagnon, alors son amie avait pris les choses en main pour avancer leur départ. Le chagrin te passera au soleil lui avait-elle dit, allons-y en juin.
Léa avait laissé faire, et elle ne le regrettait pas. Attablées à une terrasse, elles buvaient un cocktail et profitaient de la brise chaude qui montait du sud, de la mer. Une brise dont l’arrivée semblait avoir précipité la chute d’un beau crépuscule rougeoyant. D’un rouge sang.
Au lever du soleil, Georges reprit la barre du bateau. Aux dernières heures de la nuit il l’avait confiée à l’homme qui lui avait semblé le plus à même de tenir le cap dans l’obscurité. Tout s’était bien passé, et les quelques heures de sommeil l’avaient remis d’aplomb pour une nouvelle journée de navigation qui, crut-il, s’annonçait bien. Le vent avait molli, la mer était moins grosse.
Mais le moteur s’arrêta. Il eut d’abord quelques ratés, Georges l’avait tapoté, avait vérifié l’arrivée d’essence, l’arrivée d’air, avait demandé à ce qu’on vérifie le niveau de carburant. Tout semblait normal, mais le moteur toussa une dernière fois, puis cessa de fonctionner. Georges essaya longtemps de le redémarrer, sans succès. _ A chaque, fois la mécanique semblait repartir mais s’étouffait. Face au moteur, dos à la proue, il voyait le sillage du bateau se refermer. Bientôt il n’y eut, derrière le canot immobile, plus aucune traînée d’écume.
Georges se retourna et contempla les dizaines de passagers qui le regardaient, incrédules. Il évalua la situation : aucune terre en vue ; les conditions s’étaient un peu améliorées ; il n’y avait rien pour confectionner un gréement de fortune ; il fallait essayer de réparer le moteur.
Durant toute la journée, ballottés par des vagues insensibles à leur détresse, Georges et quelques hommes démontèrent le moteur, le nettoyèrent, le remontèrent, l’ouvrirent à nouveau et ainsi de suite. Sans résultat.
Le soleil avait fini sa course du jour, et Georges, fourbu, contemplait le GPS, la carte et la boussole qui lui semblèrent absurdes, maintenant qu’ils n’avançaient plus. Quant au téléphone satellite, il n’avait plus de batterie. Sans le moteur ils entendaient les bruits intimes de la mer et du bateau. Légers sifflements, clapot autour de la coque, craquements.
Il se déplaça jusqu’à la proue du bateau et parla à son frère, Ismaël. Tu sais, on n’a plus de moteur, lui dit-il à l’oreille. Et je crois qu’on n’en aura plus du tout. Il est mort. Le frère, son petit frère, ne répondit rien. Il baissa simplement les yeux.
Une nuit un peu plus fraîche que la précédente enveloppa le canot désemparé.
Le jour suivant, et le jour d’après encore, les hommes essayèrent de faire fonctionner le moteur. Au troisième jour de dérive retentirent les premiers pleurs. Et comme un appel que le courage avait tu jusque-là, ils en déclenchèrent de nombreux autres. Une bonne moitié des passagers geignait et pleurait. Beaucoup aussi continuaient de vomir : malades depuis le départ, le fort roulis, qui s’ajoutait au tangage depuis qu’ils n’avançaient plus, aggravait leur état.
En fait, et Georges le constata au GPS, ils n’étaient pas immobiles. Ils dérivaient. Mais à un rythme affreusement lent.
En fin d’après-midi du troisième jour, une femme cria qu’il n’y avait presque plus d’eau. L’homme qui avait tenu la barre le dernier soir avant la panne – il se considérait un peu comme le second de Georges, dont personne ne contestait l’autorité bien qu’il ne fut en rien le capitaine en titre : il n’y en avait pas – le second, donc, se précipita pour vérifier les réserves d’eau. _ Sans rien dire, il revint aux côtés de Georges. Pas tout à fait. Mais demain, nous n’aurons plus d’eau. Il faut boire moins, répondit Georges. Demain nous n’aurons plus d’eau en buvant seulement un petit verre chacun, répondit le second.
Georges s’adressa malgré tout aux soixante-quinze hommes et femmes dans le canot, par mots et par signes, en leur recommandant de boire le moins possible. Certains ne l’entendirent pas à cause de la brise, certains à cause de leurs pleurs, d’autres parce qu’ils ne comprenaient pas sa langue et beaucoup parce qu’ils ne comprirent pas ses gestes.
Le lendemain, alors que la mer était devenue presque tout à fait calme, il ne se passa rien de plus. Plus personne n’essayait rien avec le moteur, ceux qui priaient, priaient, ceux qui pleuraient, pleuraient et les autres ne faisaient rien d’autre qu’essayer de rester digne.
En fin de journée, un grand navire militaire se détacha à l’horizon. Georges et quelques hommes s’activèrent pour confectionner, avec des chemises et blousons colorés, une sorte de grand drapeau qu’ils agitèrent quelques instants. Le navire les avait déjà vus et approchait à vive allure. Mais il ne fit rien d’autre. Sur le canot, tout le monde criait. A la proue, un homme tendait à bout de bras un bébé vers le grand navire gris. Le bébé ne bougeait pas, et quand Georges croisa le regard d’Ismaël, celui-ci dit avec ses lèvres, sans prononcer aucun mot : il est mort, ce bébé est mort.
Georges fut ensuite certain d’apercevoir, sur le grand navire gris, des marins qui prenaient des photos, appuyés au bastingage. Le second, dont le comportement était très troublé depuis la veille, plongea ses mains dans la boite contenant la carte, la boussole, le GPS et le téléphone satellite. Il les jeta à la mer en hurlant au grand navire de guerre qu’il fallait les sauver. Maintenant, il faut nous sauver, répétât-il.
Mais le grand navire repartit.
(...)