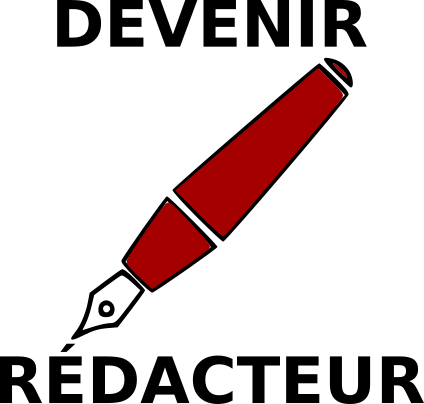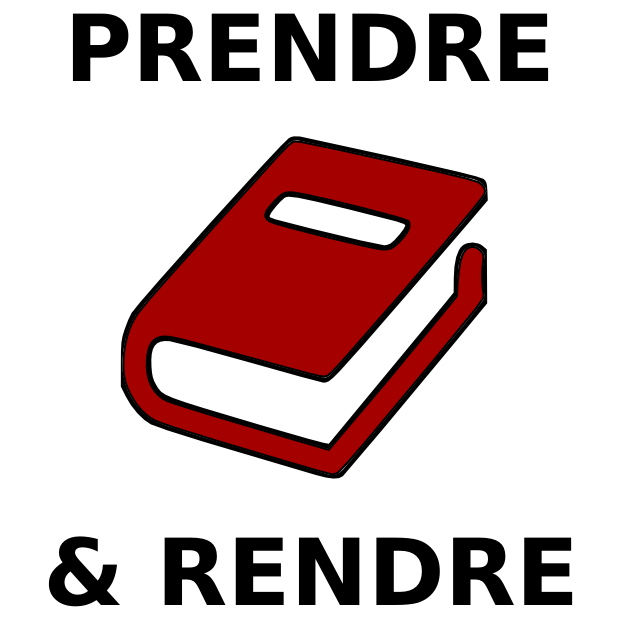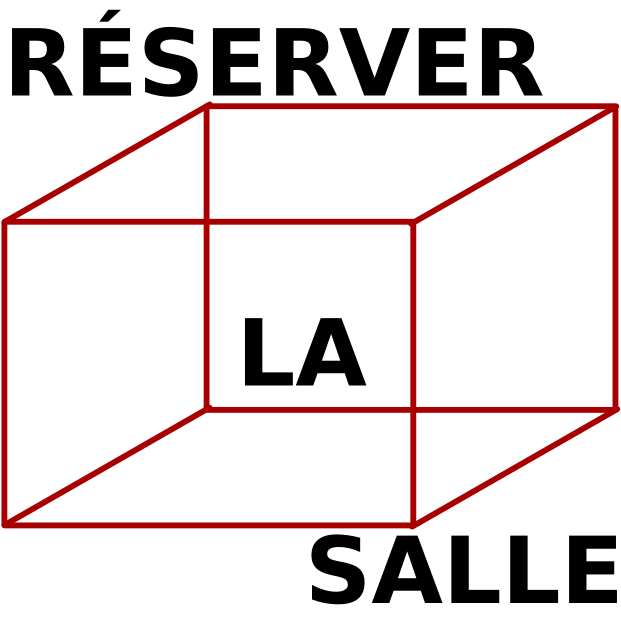Dans l’autocar qui me conduisait de Tasqueña (Mexico) à Chilpancingo, capitale de l’État du Guerrero, passait une étrange publicité sur l’écran de la télévision : en achetant un billet d’autobus pour Acapulco, nous pouvions, dans le même élan, acheter tout un lot de promotions qui nous promettait des réductions lors de notre séjour touristique à Acapulco, nous voyions un jeune couple mexicain profiter de cette « offre exceptionnelle » : dans un hôtel, un décompte en pourcentage leur était fait sur le prix d’une chambre luxueuse ; dans un restaurant, le couple, jeune et souriant, économisait jusqu’à 200 pesos sur le prix du menu (je me demandais à combien revenait le prix du repas quand je mange, très bien, pour 60 pesos dans la fonda de mon village !), enfin, de sortie, ce jeune couple se voyait offrir une réduction de 100 pesos sur les cocktails et les tapas dans une sorte de boîte de nuit. Il était tout sourire.
Dans l’autocar qui me conduisait de Tasqueña (Mexico) à Chilpancingo, capitale de l’État du Guerrero, passait une étrange publicité sur l’écran de la télévision : en achetant un billet d’autobus pour Acapulco, nous pouvions, dans le même élan, acheter tout un lot de promotions qui nous promettait des réductions lors de notre séjour touristique à Acapulco, nous voyions un jeune couple mexicain profiter de cette « offre exceptionnelle » : dans un hôtel, un décompte en pourcentage leur était fait sur le prix d’une chambre luxueuse ; dans un restaurant, le couple, jeune et souriant, économisait jusqu’à 200 pesos sur le prix du menu (je me demandais à combien revenait le prix du repas quand je mange, très bien, pour 60 pesos dans la fonda de mon village !), enfin, de sortie, ce jeune couple se voyait offrir une réduction de 100 pesos sur les cocktails et les tapas dans une sorte de boîte de nuit. Il était tout sourire.
Il y a des Mexicains qui ont de l’argent et qui peuvent se payer un séjour touristique de haut de gamme à Acapulco et l’on sent bien que c’est à eux que la pub s’adresse, à leur argent, money, money… Ce jeune couple, qui vit dans le monde douillet du fric, se trouve totalement hors de la réalité que connaissent les Mexicains dans leur grande majorité, pourtant ils deviennent la seule réalité qui compte vraiment pour les promoteurs d’Acapulco, capitale du tourisme dans le Guerrero, les autres Mexicains, la majorité des gens ordinaires, ne comptent pas, ils sont hors du coup, bons pour la casse ! Le contraste est absolu entre une minorité friquée et l’énorme majorité des Mexicains qui n’ont pas le sou.
Je venais, soudain, de me rendre compte de l’immense fracture, de l’abîme, qui peut exister entre le présent des gens et la vie idéale, heureuse mais humainement misérable qu’on leur propose, fondée uniquement sur l’argent. Pour atteindre cet idéal représenté par ce jeune couple, on tue. Cela n’a pas d’importance : on tue des gens qui sont déjà socialement morts [1].
Durant le mois d’août de l’année 2019, je me suis rendu à Tlapa, ville de l’État du Guerrero qui se trouve au cœur de la montagne tlapanèque. Le Centre des droits humains Tlachinollan fêtait son vingt-cinquième anniversaire. Pendant un quart de siècle, le Centre Tlachinollan a inlassablement défendu la population victime des abus commis par les forces de l’État, armée ou police. J’ai connu son directeur, Abel Barrera, il y a vingt ans, en 1999. Depuis je m’efforce de le rencontrer au moins une fois tous les ans par sympathie.
C’est un long voyage, presque initiatique, dans l’État du Guerrero où se mêlent dans un réseau inextricable des forces et des courants contraires : les séquelles d’une guérilla qui a connu une forte présence et une forte activité dans les années 1970 avec Lucio Cabañas et le Partido de los Pobres [2], mais qui est loin d’être réduite au silence, dans le jeu de massacre auquel se livre sans aucune retenue le pouvoir ; la présence obsessive de l’armée, et du crime organisé autour de la culture et de la vente de l’amapola (opium) avec ses luttes intestines et meurtrières entre cartels ; la résistance sociale des peuples indiens, Na Savi, Me’phaa, Nauas, Nomndaa, des Afro-Mexicains et des Métis ; et la présence d’une police et d’une justice communautaires qui ont pris différentes figures en fonction de sa situation géographique et de la composante, métisse ou indienne de ses membres [3].
« Dans les années 1970, à Tlapa, la police judiciaire et l’armée ramenaient de la Montagne des Indiens attachés les uns aux autres comme s’ils étaient des animaux. Ils les convoyaient en de longues files de prisonniers meurtris, les vêtements en loques, les pieds nus et ensanglantés.
« Les policiers, qui se voulaient les représentants de la loi et de l’ordre, le révolver à la ceinture, les accusaient d’avoir tué, volé ou violé. Ils les emmenaient jusqu’à la commanderie, qui se trouvait sur le zócalo, et, après les avoir torturés, ils les laissaient, attachés dans la rue, à la vindicte du public.
« Ce n’était pas un fait exceptionnel. Il se répétait. Quelques-uns des détenus n’arrivaient même pas jusqu’à la ville. Ils étaient tout bonnement pendus en cours de route.
« Les métis de la ville applaudissaient à ce spectacle, qui alimentait leurs fantasmes de l’indigène barbare et sauvage.
« La Tlachinollan fut fondée en 1994 pour s’affronter à cette immense vague d’injustice et de discrimination. 1994 est aussi la date du soulèvement zapatiste et des mobilisations dans le Guerrero pour les cinq cents ans de résistance indienne, alors vigoureuses et fortes.
« En ces premières années, nous n’avions à offrir que notre présence et notre solidarité. Nous avions en mémoire, sans pouvoir l’effacer, la phrase gravée sur un mur de la prison de Tlapa : “Dans ce lieu maudit où règne la tristesse, on ne châtie pas le délit, mais la pauvreté.” » [4]
On n’arrive pas facilement à Tlapa, il y faut un long voyage.
Habituellement je m’arrête pour quelques jours à Chilpancingo, la capitale du Guerrero, j’y avais mes habitudes et, dans les dernières années du XXe siècle, les amis du Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular. Avec eux j’ai pu voyager dans la Mixteca, j’ai séjourné dans les villages nahuas du río Balsa, j’ai assisté à la rencontre des peuples venus de tous les coins perdus du Guerrero pour l’anniversaire d’Emiliano Zapata — ce fut un moment de rencontre jubilatoire.
J’ai retrouvé des amis du Consejo Guerrerense dans le village de Pueblo Hidalgo dans la municipalité de Malinaltepec, au cœur de la Montagne, au moment du dixième anniversaire de la police et de la justice communautaires, en octobre 2005, ils avaient participé à sa mise en place avec le Centre des droits humains Tlachinollan et surtout avec l’ensemble des villages et des communautés de la montagne concernés.
Le local du Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena ne se trouvait pas très loin du centre-ville, en direction du marché. Comment évoquer l’esprit qui les animait ? C’étaient des femmes et des hommes du Guerrero, attachés à la lutte sociale par une sorte d’atavisme qui plongeait ses racines dans l’histoire de l’État. Ils s’affrontaient au pouvoir avec une obstination construite. Ils étaient en guerre. Et cette guerre n’avait de sens pour eux que par la victoire annoncée : la fin de l’oppression et de l’exploitation.
Beaucoup se disaient marxistes dans une société où les ouvriers ne formaient qu’une minorité pour ainsi dire inexistante, en tout cas insignifiante. Je me suis souvent posé cette question concernant leur « marxisme ». Leur lutte se voulait à la fois historique (inscrite dans l’histoire universelle de l’humanité) et révolutionnaire (devant nécessairement et théoriquement aboutir à une victoire finale). Je dirai que cette conviction (à connotations religieuses), je l’ai retrouvée dans tout l’État, de la guérilla marxiste-léniniste aux centres des droits de l’homme. C’est une constante de la vie sociale et politique, de la vie religieuse, aussi, de tous ceux qui s’opposent au pouvoir de la classe dominante dans le Guerrero [5]. Devons-nous y voir l’influence occulte qui a animé la guérilla dans les années 1970 ? C’est bien possible, je pense que l’esprit de la révolution a fortement imprégné une grande partie des montagnes et des ravins du Guerrero indien, inconnu, invisible et menaçant. Genaro Vázquez et Lucio Cabañas sont des héros populaires, non seulement connus et reconnus mais familiers (dans le sens propre du terme, partout dans la montagne tlapanèque on se dit cousin de Genaro Vázquez).
La guérilla des années 1970 a véritablement marqué les esprits aussi bien du côté des humbles que du côté des puissants et des riches, qui ont senti passer très près de leurs têtes, le vent de la révolte. Aujourd’hui encore ce sont dans les termes d’une lutte impitoyable contre les pauvres que le gouvernement du Guerrero, aussi bien d’ailleurs que le gouvernement fédéral, réagit et conçoit ses actions et ses initiatives dans le domaine de la justice et de la police. Le soulèvement zapatiste en 1994 dans le Sud-Est mexicain a relancé les espoirs d’un côté et les inquiétudes de l’autre. On parle généralement du Guerrero bronco, je parlerais plutôt du Guerrero rebelle et revoltoso, comme disent les Mexicains. Dans le Guerrero, on est en guerre et le gouvernement est en guerre. Il s’agit, pour lui, de « pacifier » la population indigène comme, dans les colonies de la République, on « pacifiait » la population autochtone en massacrant, sans autres formes de procès, hommes, femmes et enfants qui osaient s’organiser et défier l’État tout-puissant. C’est la tâche qui incombe à l’armée et, dans le Guerrero, l’armée est bien une armée d’occupation, elle en a toutes les caractéristiques et tous les privilèges.
En évoquant ces amis de Chilpancingo, qui tournaient tous autour du Consejo, je me dis qu’ils étaient idéalistes, mais avec une nuance importante, tous, ils puisaient leur idéal dans une expérience ancestrale et très concrète : la vie communale de leur village. Leur village était leur point d’ancrage, que leur village se trouvât à quelques kilomètres de Chilpancingo, ou dans le cœur de la Montagne tlapanèque ou encore dans la Mixteca, à la frontière avec l’État d’Oaxaca. C’est alors qu’ils redevenaient eux-mêmes, dans cet entourage familier, dans ce tissu social serré comme une natte, fait d’échanges de service et de solidarité. Quand ils ont obtenu de la municipalité de Chilpancingo un terrain à la périphérie de la ville, leur idée a été de créer une sorte de phalanstère, une « colonie » d’habitations reposant sur les valeurs de la vie communale.
Le Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular s’est effiloché au chant des sirènes de la politique mais ce « phalanstère » de gens animés par le même idéal d’égalité et de fraternité a trouvé ses assises et son ancrage dans la banlieue de la capitale.
Chilapa, ville indienne et métisse de la basse montagne, se trouve à mi-chemin entre Chilpancingo et Tlapa. Le taxi collectif, ou la « urban », passe par Tixtla ; autrefois j’y visitais les enfants d’un couple de commandants de l’EPR (ou de l’ERPI) qui se trouvait, à cette époque, dans les geôles de l’État ; c’est aussi à proximité de cette ville importante que se trouve, dans la commune d’Ayotzinapa, l’école normale rurale Raúl Isidro Burgos. C’est un lieu autogéré où des jeunes des milieux dits défavorisés sont formés à devenir de futurs instituteurs bilingues. Pour l’État du Guerrero comme pour l’État fédéral, c’est une pépinière de futurs guérilleros, qui y reçoivent une formation idéologique et militante. Pour les familles paysannes, c’est la possibilité pour leurs enfants d’avoir une formation et de devenir instituteurs. L’État cherche à supprimer ces écoles normales et commence par annuler toute subvention, ce qui conduit les étudiants à une pratique systématique de la « reprise » afin de se procurer ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l’école [6].
Les étudiants d’Ayotzinapa avaient été chargés par la Fédération des étudiants paysans socialistes du Mexique (d’obédience marxiste-léniniste) de se procurer des autobus afin que les normaliens des autres écoles puissent se rendre à la manifestation commémorant le massacre de Tlatelolco le 2 octobre 1968 (massacre des étudiants par l’armée sur la place de Tlatelolco où ils tenaient un meeting). Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, les étudiants d’Ayotzinapa ont été pris sous le feu nourri des différentes forces de police alors qu’ils tentaient de sortir d’Iguala avec des autobus. 43 étudiants, soumis par les forces de l’ordre, ont disparu [7]. Depuis les mères et les pères de famille manifestent pour que justice leur soit rendue ainsi que leurs enfants.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos ! (Vivants, ils ont été enlevés, vivants, nous voulons les retrouver !)
Autrefois, j’aimais m’arrêter pour quelque temps à Chilapa, ville métisse où la population indienne des environs se rendait pour vendre ses produits agricoles et son artisanat dont de la poterie de grande beauté. Le marché connaissait une belle animation et j’aimais m’y perdre. C’était aussi une ville mythique qui rappelait les combats entre les « tigres » au début de la saison des pluies. Les Indiens, le visage dissimulé sous le masque d’un tigre avec de belles moustaches, s’affrontaient à poings nus dans des combats singuliers ; parfois aussi les tigres défiaient des personnages munis de longues cordes nouées servant de fouets.
La ville a bien changé aujourd’hui, elle s’est comme recroquevillée sous la peur ; deux cartels s’affrontent, los Rojos et los Ardillas, et laissent des morts sur le trottoir, surtout à la veille des élections ; ces deux cartels regroupent deux partis, le PRI et le PRD, qui s’opposent à la fois pour le contrôle de la drogue, celui de l’argent de la drogue et celui des votes. Le soir, la ville de Chilapa est devenue silencieuse et seules les voitures de haut luxe des narcos circulent au pas, très lentement, dans les rues de Chilapa. Des hommes ont été enlevés et ont disparu, leurs familles sont sans nouvelles et sans ressources ; des femmes jeunes ont disparu, elles aussi. Les narcos se sont rendus maîtres de la ville et de ses environs. Parfois ils se livrent à des guerres meurtrières entre eux pour le contrôle de toute la région et du trafic de l’amapola et de l’héroïne.
Sous l’impulsion de l’argent occulte du trafic de la drogue, la ville s’est développée et agrandie, on y devine une activité économique plus intense. Entièrement livrée au trafic dans une connivence des intérêts où l’on retrouve l’union sacrée des hommes d’affaires, des politiques et des forces de l’ordre, dont l’armée, Chilapa a troqué son passé colonial pour un futur, lui aussi, grandement questionnable. Non ?
Avant de prendre un taxi collectif pour Tlapa, je me fais l’observation suivante : pendant toutes ces années, l’armée a bien tenté de prendre le contrôle de la sierra, de faire en sorte que les habitants ne s’organisent pas, de les soumettre à un État de caractère colonial. Vainement. Elle est souvent tombée dans des embuscades aussi bien au cœur de la sierra que sur la route qui va de Chilpancingo à Tlapa. Elle a pratiqué de manière systématique la torture pour avoir des informations sur les groupes armés de la guérilla. En vain. La population a continué à s’organiser. Ce n’est que tout dernièrement, grâce à la culture de l’amapola, qui est devenue, pour la population paysanne, une nécessité économique de survie, que l’armée a réussi à s’introduire subrepticement dans un monde qui la rejetait.
L’amapola est une véritable bénédiction pour l’armée : elle lui permet d’exercer un chantage sur la population ; de s’enrichir directement en s’impliquant en tant qu’intermédiaire, dans sa production et dans sa vente ; de prendre enfin un ascendant sur une région en s’alliant avec les caciques du narcotrafic. Finalement le retour au monde colonial du péonage que représente dans ces régions la monoculture de l’amapola lui convient parfaitement. L’armée est au service de ce monde et de ses maîtres.
La symbiose, qui a lieu entre les narcotrafiquants, les forces de police et de justice, les fonctionnaires et les hommes politiques, soulage l’armée dans sa tâche de répression, elle n’a plus qu’à se mettre au service des caciques qui ont repris, grâce à la culture et au commerce de l’opium, le contrôle de leur région. Ce sont désormais les groupes de la « délinquance organisée » qui se chargent du nettoyage social et d’éliminer les gêneurs par des assassinats ciblés qui restent impunis. Ces meurtres ont ainsi cessé d’avoir un coût politique pour l’État et ses institutions comme l’armée et la police fédérale (à moins que l’État ne soit amené à protéger ouvertement, comme dans le cas d’Iguala et des normaliens, ceux qui se trouvent directement impliqués dans les massacres).
Enfin cette histoire trop subjective, presque « journalistique », du Guerrero nous amène cependant, en prenant de la hauteur, à saisir le sens, plus général, d’une politique dont nous avons pu suivre le développement sur le terrain. À partir de 1960, les peuples originaires, retirés dans les zones de montagne et de refuge qui n’intéressaient personne, sont devenus la cible et l’objet de l’intérêt des grandes corporations marchandes et cela sur tous les plans de l’activité capitaliste et sociale, il y avait dans ces lieux retirés de l’eau, du bois, la possibilité de cultiver de la drogue, une marchandise qui se vend très bien, des ressources minières et énergétiques. Ces zones étaient à nouveau à conquérir. Elles étaient devenues très, très intéressantes d’un point de vue commercial. L’État a alors entrepris une seconde conquête coloniale afin que les entreprises capitalistes puissent se rendre maîtresses de toutes ces richesses. Nous en sommes là. Les peuples indiens résistent comme ils peuvent à cette seconde vague de colonisation marchande. Je ne sais pas si un jour la société dite occidentale se rendra compte de l’intérêt humain de cette lutte et de cette résistance.
À partir de Chilapa, nous entrons dans la haute montagne, après des lacets, la route suit la ligne des crêtes d’où nous avons une vue plongeante sur les vallées, puis nous retrouvons les lacets pour descendre sur Tlapa, qui se trouve dans un coude du río Balsa.
C’est une ville déjetée, qui a été construite un matin de cuite quand on n’a pas les yeux en face des trous, les cheveux emmêlés et le teint grisâtre, c’est une mocheté de bric et de broc entremêlés ; un arroyo la traverse et la coupe en deux, ce n’est pas une blessure nette, c’est une blessure qui s’étale et qui suinte, s’y tient un marché improvisé en saison sèche. Ce sont les Indiens me’phaa ou tlapanèques qui descendent de la montagne pour y vendre leur produit et acheter l’indispensable. Ils sont pauvres et la ville, métisse, leur est hostile.
Tlapa n’a pas vraiment changé, la ville se laisse aller dans les torpeurs d’une lassitude progressive et coloniale. Je connaissais un endroit assez couru, on y mangeait d’excellentes quesadillas, au fromage, aux pommes de terre, à la viande, avec des champignons, etc. Il a disparu, à la place il n’y a plus qu’un trou sombre, un véritable bouiboui où les quesadillas dégoulinent d’huile. Impossible de boire une tasse de café, ne serait-ce que du nescafé ! Ce n’est décidément pas une ville pour touristes. Par contre ce sont plutôt les cantinas qui résistent obstinément à cette sorte de débâcle et d’amollissement, fonctionnant la nuit avec de l’alcool frelaté et des filles costaudes remplissant confortablement leur short.
Tout ce beau monde, les filles accompagnées de leurs tenanciers aux larges dos, avec tout de même un certain embonpoint robuste, se retrouve à cinq heures du matin au terminal d’autobus de seconde classe. Ils mangent des quesadillas préparées par une jeune fille maigrelette sur un comal et un feu portatifs. Moi, je vais prendre le bus pour Puebla.
☀
Marseille, deuxième semaine de septembre
Georges Lapierre
Notes
[1] Cette constatation explique la « complaisance » dont font preuve aussi bien les riches que les hommes d’État (tous les présidents de la République mexicaine dont l’actuel) à l’égard du crime organisé et des cartels du capital. Quand l’argent est devenu l’unique moteur de la vie sociale, toute autre forme de vie sociale ne reposant pas sur l’argent est devenue obsolète, bonne à être jetée dans les poubelles de l’histoire.
[2] El Partido de los Pobres : Le Parti des pauvres. Á ce sujet, lire, de Carlos Montemayor, Guerra en el paraíso, traduit en français sous le titre, Guerre au paradis (Gallimard, 1999).
[3] Le 13 juin 1994, 200 soldats ont envahi El Escorpion, village de l’Atoyac, ils étaient à la recherche des membres de l’Organisation paysanne de la Sierra Sur (OCSS, Organisación Campesina de la Sierra del Sur) soupçonnés de faire partie de la guérilla ; un an plus tard (le 28 juin 1995) se produit le massacre d’Aguas Blancas : 17 membres de l’organisation paysanne (OCSS) furent délibérément assassinés par la police de l’État à un barrage ; au cours de la commémoration de ce crime d’État commis par le gouverneur du Guerrero, apparaît l’EPR (Ejército Popular Revolucionario). En 1998, le 7 juin, nouveau massacre commis cette fois par l’armée à El Charco, village d’Ayutla de los Libres, dix indigènes mixtèques et un étudiant de l’UNAM qui participaient à une rencontre furent exécutés au cours d’une opération militaire. C’est alors que l’on parle de l’ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), une scission, dit-on, de l’EPR. Une telle situation, massacre des gens et naissance de la lutte armée, semble ne pas avoir de fin dans le Guerrero. Dans son obstination à soumettre entièrement la population, l’armée crée continuellement son propre ennemi.
[4] Texte d’introduction au livre de Luis Hernández Navarro et d’Abel Jesús Barrera Hernández, Desde el corazón de la Montaña, Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 2019.
[5] Même le PRD (Parti de la révolution démocratique) quand il était alors un parti d’opposition avait cette teinte révolutionnaire dans le Guerrero, il a eu ses martyrs : plus de 300 membres du parti ont été assassinés au cours des années 1980 et 1990.
[6] Il faut bien se dire que toutes ces écoles normales de formation des enseignants reposent sur une idéologie, c’est-à-dire sur une conception de l’État concernant la tâche des enseignants dans la société. Actuellement, dans ces écoles rurales encore en service, l’État s’est fait déposséder de son idéologie par une autre idéologie, toujours profondément étatique mais qui se veut évolutionnaire : le marxisme-léninisme. Jusqu’à présent, les gouvernements se sont contentés, face à cette situation, de supprimer purement et simplement les subventions ou les écoles. Dans ce domaine, la stratégie du nouveau gouvernement (celui d’Andrés Manuel López Obrador) est plus subtile, elle consiste à reprendre l’idéologie pour tenter de la transformer à son avantage : les instituteurs seront toujours le fer de lance de l’État dans les villages mais pour faire entendre les visées « démocratiques » de l’État actuel. Pour cette raison, l’éducation se veut le point fort du gouvernement d’AMLO qui, avant même son élection, y avait consacré tous ses efforts.
[7] Cf. « La nuit d’Iguala ».
Et aussi,
de John Gibler, Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, Mexico, avril 2016 (Rendez-les-nous vivants ! Histoire orale des attaques contre les étudiants d’Ayotzinapa, CMDE, Toulouse, 2017) ;
de Témoris Grecko, Ayotzinapa, mentira histórica, estado de impunidad, impunidad de Estado, Mexico, septembre 2016 ; nous devons aussi à Témoris Grecko le film Mirar morir ;
de Carlos Martín Beristain, El tiempo de Ayotzinapa, Espagne, janvier 2017, Mexico, janvier 2017 ;
d’Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala, Grijalbo, 2018.