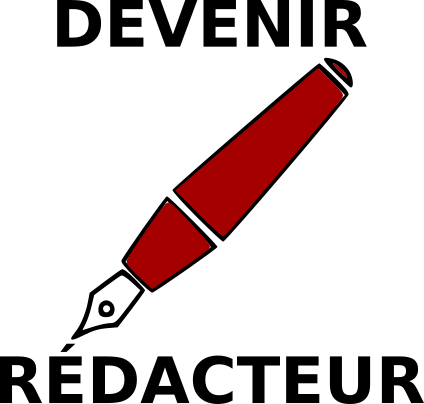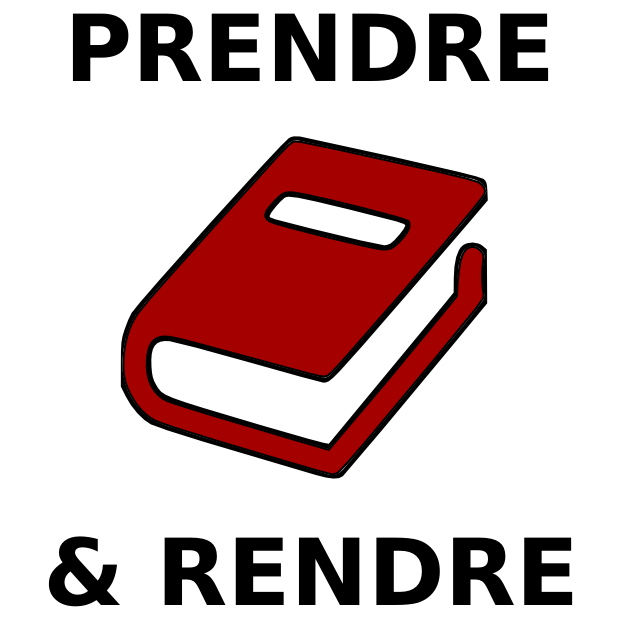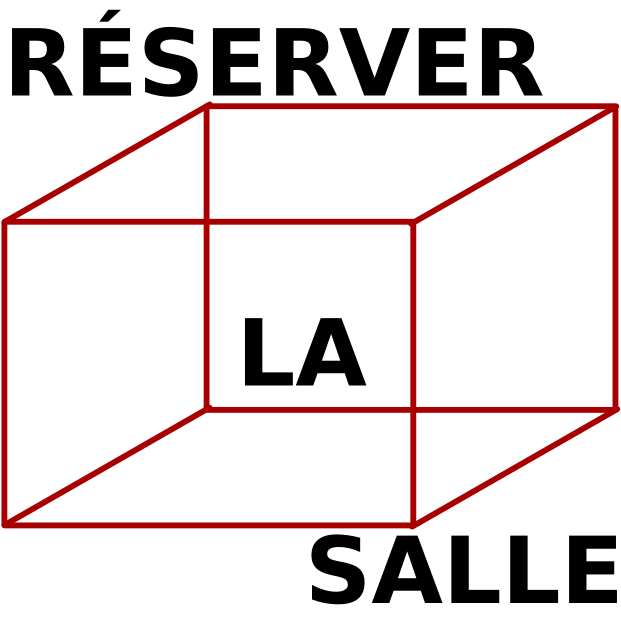IL EXISTE CHEZ LES ANIMAUX, combinés avec les instincts d’agression, des instincts de réconciliation. L’étude de ces instincts, notamment chez les primates, est très utile pour penser une politique non-violente adaptée à l’espèce humaine.
Beaucoup de comportements que l’on croit spécifiques aux humains, notamment la vendetta, la guerre, la lutte pour le pouvoir, ont leurs homologues chez d’autres primates, et des analogues chez des animaux très différents. Par exemple, si la prohibition de l’inceste à travers des règles morales et sociales et des croyances est spécifiquement humaine, on observe chez de nombreuses espèces animales une inhibition instinctive de l’inceste, ou plus précisément des rapports sexuels entre des individus qui ont été en relation de maternage : un jeune ne s’accouple pas avec l’adulte qui l’a allaité, qu’il s’agisse de sa mère biologique ou d’une mère adoptive. D’où une règle générale de méthode : si on veut transformer un comportement humain, il vaut mieux, avant de spéculer sur ses significations spécifiquement humaines, commencer par s’interroger sur ses soubassements instinctuels et sur leurs marges de modification possible. Par exemple, on ne peut pas envisager de supprimer la guerre chez les humains sans s’interroger d’abord sur la prégnance de l’instinct de pouvoir qui conduit les humains à faire la guerre. Et pour cela il est indispensable de comparer les expressions et transformations de l’instinct de pouvoir chez les différentes espèces de primates.
« Si on te frappe la joue droite, tends l’autre joue »...
On tourne souvent en dérision ce précepte de l’Évangile, en disant que c’est la meilleure façon de « s’en prendre plein la gueule ». Mais c’est mal connaître la psychologie des hommes et des animaux. Dans une bagarre entre deux loups, ou deux chiens, il arrive que celui qui a le dessous s’allonge au sol et offre sans défense sa gorge au vainqueur. Ce dernier pourrait donc l’égorger d’un coup de dents sans difficulté. Mais il ne le fait pas : la mimique de soumission du vaincu déclenche une inhibition de la violence du vainqueur. On dirait que le vaincu est « à la merci » du vainqueur, il dépend de sa pitié. Tout cela fait partie de l’héritage instinctif des loups. « Tendre l’autre joue » est un rituel instinctif de soumission qui sert de signal déclenchant une réconciliation hiérarchique. Donc si comme l’écrit Hobbes « l’homme est un loup pour l’homme », le loup qui est en nous a aussi des côtés sympathiques. De semblables interactions instinctuelles existent chez de nombreuses espèces, notamment chez les primates. Le conseil de l’Évangile puise donc son efficacité dans nos instincts sociaux de primates. Certes, cela ne marche pas à tous les coups, le meurtre d’un congénère existe aussi chez les animaux : dans une situation donnée se déclenchent plusieurs schémas d’émotion et d’action (Konrad Lorenz écrit qu’il y a comme un « parlement des instincts »), et il n’est pas rare que l’agressivité l’emporte sur les comportements d’apaisement.
Les raisonnements et les instincts
Longtemps j’ai cru que le précepte de l’Évangile était un appel ironique à la prise de conscience éthique de l’agresseur : le message au premier degré est « frappe-moi », le message au second degré est « vois comme tu serais lâche et cruel de continuer à me frapper » : l’agresseur est mis face à sa responsabilité. Autre interprétation : le « tendre l’autre joue » serait une illustration paradoxale, donc mnémotechnique, du principe moral selon lequel, comme l’a dit Socrate, « il vaut mieux subir l’injustice que la commettre » (ça se discute...). De telles interprétations font appel à des significations spécifiquement humaines, élaborées par des raisonnements, qui le plus souvent sont plus complexes et plus abstraits que ceux des chimpanzés. Donc ces interprétations sont légitimes... mais elles ne doivent pas nous dispenser d’essayer de comprendre les bases instinctuelles des comportements humains, avec les contraintes qu’elles nous imposent mais aussi les possibilités de variation qu’elles nous offrent.
Tout laisse à penser que les raisonnements humains sont alimentés par des instincts sous-jacents, d’autant plus que les connaissances actuelles sur le cerveau montrent que dans la pratique ce sont nos émotions qui servent de critère à nos décisions et à nos jugements de valeur. Le neurologue Damasio, dans le livre Le Sentiment même de soi, donne l’exemple de malades victimes de lésions dans les secteurs du cerveau qui gèrent les émotions : ces personnes, alors même que leur raisonnement logique reste intact, sont très embarrassées pour prendre des décisions et prennent le plus souvent des décisions irrationnelles [1].
Il est vraisemblable certes que les instincts des humains sont plus complexes et plus variables que ceux des autres primates, qui eux-mêmes le sont plus que ceux des chiens. Mais il est vraisemblable aussi qu’une grande partie des instincts humains sont les mêmes que ceux des espèces les plus proches génétiquement : les chimpanzés et les bonobos (et les yetis s’ils existent !... et les différentes espèces d’hommes préhistoriques, mais malheureusement il n’y en a qu’une qui ait survécu). D’où l’intérêt des comparaisons primatologiques,... en évitant toutefois le décalque pur et simple, car, c’est un principe darwinien, chaque espèce a ses propriétés spécifiques. On trouve dans les livres du psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik de nombreux exemples où il met en perspective la psychologie humaine à partir de la primatologie, et de l’éthologie animale plus largement.
La guerre chez les singes
La vendetta existe chez les chimpanzés : un chimpanzé qui a été agressé par un de ses congénères agressera le lendemain un frère ou un ami de son agresseur.
Les chimpanzés pratiquent une sorte de guerre d’agression territoriale. Les chimpanzés, comme les chasseurs-cueilleurs humains dans la forêt, vivent en petits groupes dont la dimension (une trentaine d’individus par exemple) correspond aux ressources alimentaires disponibles dans le voisinage. Sur un territoire étendu, ces groupes se connaissent les uns les autres et forment une « communauté » : les individus peuvent changer de groupe, notamment les jeunes adultes, ce qui leur permet d’échapper aux mésententes et de trouver des partenaires sexuels. Les relations entre communautés voisines peuvent être hostiles. En cas d’incursion des membres d’une communauté sur le territoire des voisins il y a des agressions et des meurtres. Si le rapport de force le permet, on passe à la guerre de conquête : après plusieurs meurtres les envahisseurs finissent par s’installer collectivement.
Ce comportement a pour moteur une agressivité contre les inconnus : quand on met en présence deux chimpanzés mâles qui ne se connaissent pas, ils se bagarrent. Les bonobos (une espèce un peu différente des chimpanzés) sont moins agressifs, plus portés à la bonne entente : quand deux bonobos inconnus se rencontrent, ils s’observent avec méfiance, ils échangent des mimiques qui sont l’équivalent du sourire, et s’ils n’ont pas de motif précis d’hostilité ils s’embrassent et font connaissance.
Une politique non-violente doit donc à la fois comprendre les causes instinctuelles et les scénarios instinctuels préprogrammés de la violence, et s’appuyer sur les instincts de réconciliation, les encourager et les entraîner.
Une combinaison souvent mise en place par les chimpanzés et par les humains est la réconciliation à l’intérieur de la communauté avec la projection de l’agressivité sur un ennemi extérieur. Donc l’instinct de réconciliation peut être utilisé dans une démarche belliciste, il vaut mieux en prendre conscience. Même les sociétés guerrières utilisent l’ouverture bienveillante aux étrangers : leurs coutumes d’hospitalité font partie des tactiques par lesquelles chaque groupe essaie de recruter des alliés. Depuis la première guerre mondiale, et de plus en plus avec la crise écologique, les menaces qui pèsent sur l’humanité nécessitent la mise en place d’un système de sécurité mondial, donc la définition d’une communauté universelle sans ennemi étranger. Comme l’a remarqué Norbert Elias, il s’agit d’une exigence inédite dans l’histoire humaine. Il est donc vital de trouver des alternatives aux scénarios classiques de canalisation de l’agressivité sur un ennemi extérieur intraspécifique.
La guerre chez les humains : pas de culture sans instinct, pas d’instinct sans culture...
Chez les humains la plupart des guerres ne se déclenchent pas comme chez les chimpanzés. La décision de faire la guerre résulte d’un raisonnement sur le pouvoir et la richesse que donnera la victoire. Or la richesse, passé un certain niveau, est essentiellement un moyen de pouvoir. Les chimpanzés ne savent pas accumuler des richesses ; mais ils ont un instinct de pouvoir, comme nous le verrons plus loin. Ce n’est pas l’agressivité qui explique les formes spécifiquement humaines de la guerre, c’est plutôt l’instinct de pouvoir, secondé par le raisonnement. Cela dit, il est assez évident que les guerres chez les humains mobilisent une agressivité et des schémas de comportement instinctuels qui ont leurs homologues chez les autres primates.
L’aspect instinctuel de la guerre chez les humains est bien montré par la présence de la sexualité : dans la guerre d’agression territoriale, on tue et on viole. Lors de la guerre en ex-Yougoslavie, les nationalistes extrémistes ont mis en œuvre des plans qui combinaient le massacre des hommes, parfois leur castration, le viol des femmes et le « nettoyage ethnique » des territoires conquis. Certes ces plans ne se fondaient pas sur des instincts incultes, mais sur des préjugés communautaristes, et sur une idéologie politique délirante formulée par des dirigeants pervers (Karadzic, le leader des nationalistes serbes de Bosnie, est un psychiatre qui a fait sa thèse sur la manipulation mentale - nous reviendrons plus loin sur le comportement des dirigeants politiques). Tout cela provient d’une élaboration qui nécessite une culture spécifiquement humaine. Mais ce qui fait que ces plans ont été facilement mis en œuvre, qu’ils ont suscité l’enthousiasme des miliciens, c’est qu’ils exprimaient des schémas instinctuels typiques chez les primates. Ce sont les mêmes schémas instinctuels qu’expriment (moins méchamment peut-être) les supporters de football de Marseille dans leur slogan « Paaa-risien, j’ai niqué ta mère, sur la Cane-Cane-Cane, sur la Canebière » : appartenance communautaire et territoriale, agressivité contre les étrangers, agressivité sexuelle. Un non-violent averti en vaut deux : si l’on veut prévenir la barbarie, il vaut mieux connaître ses scénarios plutôt que de rester sidéré devant son horreur indicible.
...et pas de culture sans fantasmes
Cela dit, si nous référons un comportement à d’hypothétiques instincts, cela ne suffit pas à l’expliquer : il faut comprendre les médiations psychologiques par lesquelles une probable prédisposition innée se transforme en un comportement effectif. Par exemple, dire aux Parisiens qu’on a niqué leur mère, c’est salir leur identité fondée sur la filiation paternelle, comme quand on traite quelqu’un de bâtard : c’est l’expression d’une idéologie patriarcale, pas seulement d’un instinct. C’est aussi l’expression du désir œdipien de prendre la place du Père en transgressant la Loi : il y a là un scénario fantasmatique qui suppose un raisonnement inconscient... dont on ne sait pas s’il existe un homologue chez les singes.
Agressivité et réconciliation : de Lorenz à De Waal
Les rats forment des communautés qui se reconnaissent à l’odeur. Chirac n’a rien inventé : les rats « ne peuvent pas sentir » les étrangers. Ils tuent les rats intrus qui portent une odeur différente de celle de leur communauté. Les oies pratiquent en groupe ou en couple un cérémonial dit de « triomphe » par lequel elles se confortent mutuellement et menacent les étrangers. Ce cérémonial ressemble beaucoup au folklore tribal et belliqueux des groupes fascistes et des supporters de football. Dans son livre des années 50, L’Agression, une histoire naturelle du mal, Konrad Lorenz a décrit ces comportements, et analysé leur genèse par combinaison et réorientation des instincts. Par là, il a donné un éclairage des mécanismes psychosociologiques du fascisme, donc une autocritique implicite de son engagement dans le nazisme. Dans les descriptions de Lorenz l’agressivité intraspécifique sert principalement à la défense de l’espace vital de l’individu et du groupe et à la compétition sexuelle, le plus souvent entre les mâles. Mais Lorenz a insisté sur ce qui limite la violence dans l’agression intraspécifique :
![]() l’inhibition : un chat qui frappe ses familiers le fait en rentrant ses griffes ; les chiens, dans la plupart de leurs fréquentes querelles, s’infligent rarement des blessures graves.
l’inhibition : un chat qui frappe ses familiers le fait en rentrant ses griffes ; les chiens, dans la plupart de leurs fréquentes querelles, s’infligent rarement des blessures graves.
![]() la ritualisation : les cerfs qui se battent pour une biche n’utilisent pas toutes leurs armes (ruades, morsures), mais se contentent de mesurer leur force dans une joute avec leurs bois. Dans beaucoup d’espèces la bataille physique est souvent remplacée par des mimiques de menace.
la ritualisation : les cerfs qui se battent pour une biche n’utilisent pas toutes leurs armes (ruades, morsures), mais se contentent de mesurer leur force dans une joute avec leurs bois. Dans beaucoup d’espèces la bataille physique est souvent remplacée par des mimiques de menace.
![]() la réorientation : un comportement de menace peut être utilisé comme une parade amoureuse.
la réorientation : un comportement de menace peut être utilisé comme une parade amoureuse.
![]() la soumission : par exemple, lorsqu’un chimpanzé ou un chien rampe ostensiblement avec de petits cris plaintifs devant un congénère qui est plus fort que lui, une relation de domination se met en place : le dominant se satisfait des messages rituels de soumission et d’allégeance qui lui sont adressés, et, une fois cette soumission acquise, s’abstient le plus souvent d’infliger des blessures physiques au dominé. Il en va de même chez les humains : une alternance de violence et d’allégeance ritualisée est particulièrement cultivée dans les sociétés guerrières ou féodales et les maffias.
la soumission : par exemple, lorsqu’un chimpanzé ou un chien rampe ostensiblement avec de petits cris plaintifs devant un congénère qui est plus fort que lui, une relation de domination se met en place : le dominant se satisfait des messages rituels de soumission et d’allégeance qui lui sont adressés, et, une fois cette soumission acquise, s’abstient le plus souvent d’infliger des blessures physiques au dominé. Il en va de même chez les humains : une alternance de violence et d’allégeance ritualisée est particulièrement cultivée dans les sociétés guerrières ou féodales et les maffias.
De Waal est allé plus loin sur cette voie. Dans De la Réconciliation chez les primates, il montre que chez les primates, et dans de nombreuses autres espèces qui ont une vie sociale importante, les loups par exemple, l’agression à l’intérieur du groupe sert le plus souvent à déclencher des comportements de réconciliation, (notamment l’épouillage et le toilettage mutuel : « gratte-moi le dos ») qui créent des liens affectifs (le plus souvent hiérarchiques, parfois amicaux et égalitaires) permettant la coopération entre les membres du groupe. Lorenz a mis en évidence une aptitude instinctuelle à limiter la violence. De Waal met en évidence une aptitude instinctuelle à construire la paix.
De Waal insiste sur l’intelligence des relations sociales chez les primates. Dans la vendetta par exemple, si un individu se venge sur le frère de son agresseur, cela prouve qu’il a une certaine connaissance de la relation existant entre deux autres individus. Cette connaissance s’observe également dans les tactiques d’alliance. On observe aussi des cas de médiation. Par exemple, si un chimpanzé adulte A est fâché contre un jeune J, il arrive que la mère M du jeune vienne épouiller A, ce qui tend à calmer A ; à ce moment J s’approche de M puis participe à l’épouillage de A ; A le laisse faire, à ce moment M s’éloigne, et A et J se réconcilient. Le comportement de M laisse penser qu’elle a pris des initiatives dans l’intention de réconcilier A et J.
Dans Le Bon singe, De Waal explique que la morale a pour origine naturelle les émotions liées à la réconciliation et à la coopération, et les comportements, encouragés par les partenaires, où l’individu leur signale ces bonnes dispositions.
Donc comme le pensait Rousseau il y a en l’homme une bonté naturelle ; mais elle est mise au point par la vie sociale. Et il y a aussi une méchanceté non moins naturelle.
La bonne volonté morale, la sociabilité, et l’aptitude au bonheur avec autrui sont effectivement inscrites dans les possibilités psychiques de l’espèce humaine, mais il n’y a aucune probabilité que ces bonnes dispositions soient spontanément plus fortes que celles qui produisent la cruauté, la fourberie, la domination et son acceptation. Le malheur n’est pas fatal, mais biologiquement probable.
Violence conjugale et domination masculine
Les gorilles mâles sont connus pour leur violence conjugale. Les gorilles, les chimpanzés, les babouins, bref la majorité des espèces de singes pratiquent la polygamie autoritaire (plus exactement la polygynie) : le mâle dominant maintient son monopole sexuel sur ses guenons en les mordant et en les menaçant ; il écarte les prétendants par les mêmes moyens. Cela dit, il existe aussi des harems contrôlés par plusieurs mâles, une polygamie partagée en quelque sorte. Les guenons se soumettent au(x) mâle(s) dominant(s), mais pratiquent aussi l’adultère, ce qui leur permet d’entretenir des liens sociaux avec d’autres mâles : il y a une polyandrie informelle. Selon les espèces, le degré de soumission ou d’indépendance des guenons n’est pas le même. Et dans une même espèce, il y a de grandes différences entre les groupes, selon les rapports de force entre mâles et femelles, et selon la culture du groupe : ici les mâles seront d’une jalousie violente, là ils seront plus tolérants. Chez les quelques espèces monogames (les titis par exemple, beaucoup moins proches génétiquement des humains que les chimpanzés), l’adultère n’est pas rare (comme chez les nombreuses espèces d’oiseaux monogames), mais la guenon, comme le mâle, s’efforce d’écarter ses rivales par la violence et la menace : la monogamie est donc le résultat équilibré d’une double jalousie. Monogamie, ou polygamie avec une certaine polyandrie informelle, quelque soit le régime matrimonial il est toujours conflictuel et se règle par un mélange de gentillesse et de violence, de confiance et de menace.
Chez les bonobos il semble que les mâles aient d’importantes inhibitions à la violence vis-à-vis des guenons : un mâle peut menacer une guenon mais souvent il n’ose pas la mordre. D’autre part les guenons, liées entre elles par des pratiques d’amitié homosexuelle, sont solidaires contre les mâles. La violence existe chez les bonobos, mais le pouvoir passe plus par la séduction, principalement sexuelle, que par la menace : make love, not war. En résultat, le pouvoir éventuel d’un mâle est fortement contrebalancé et il peut y avoir domination féminine dans le groupe. Il arrive souvent que le mâle formellement dominant reste sous l’influence de sa mère, qui de ce fait a un important pouvoir dans le groupe. (Voir le livre de Frans De Waal : Bonobo, le bonheur d’être singe.)
La domination masculine chez les singes a pour enjeu le sexe, la nourriture (le dominant se sert en premier), et l’autorité dans le groupe (autrement dit le pouvoir). Ces enjeux existent aussi chez les humains, mais d’autres s’y ajoutent. La division du travail permet d’exploiter le travail d’autrui et d’accumuler des richesses (choses qui, nous le verront, ne peuvent pas se développer chez les singes), ce qui augmente considérablement les possibilités de pouvoir sur autrui. Les hommes en position dominante peuvent exploiter le travail des femmes ; ils ont aussi plus de moyens que les chimpanzés pour imposer la soumission des enfants à leur autorité, donc conquérir le contrôle politiquement décisif des rapports de parenté ; et pour cela ils intensifient les contraintes limitant l’autonomie des femmes en matière de reproduction, ce qui suppose de limiter leur autonomie sexuelle et sociale. Sur les rapports de pouvoir entre les sexes chez les primates, et dans l’histoire humaine, voir le livre remarquable de Sarah Blaffer Hrdy, Les Instincts maternels.
En résumé dans les rapports de pouvoir entre les sexes chez les primates il y a une forte probabilité de la domination masculine mais cela dépend de rapports de force complexes. L’oppression des femmes peut prendre des proportions beaucoup plus importantes que celle des guenons dans les autres espèces. Il existe chez toutes les espèces, et davantage chez les humains, des ressources sociales et morales permettant de contrer la domination masculine.
Avons-nous l’instinct de tuer les enfants des autres ?
L’infanticide par les mâles montre bien comment un instinct de violence permet aux mâles de contrôler le pouvoir reproductif des femelles. (Il s’agit d’un contrôle de fait, pas d’un contrôle conscient et réfléchi). Cet exemple montre aussi qu’il faut éviter les décalques simplistes d’une espèce à une autre : les homologies ne doivent pas faire oublier les différences.
Chez les macaques entelles (ou langur) et les babouins hamadryas, quand un mâle a conquis un harem en évinçant celui qui en était précédemment le maître, il commence par massacrer les bébés des guenons. Comme c’est typique et prévisible, on peut penser que c’est un instinct. Des comportements plus ou moins semblables existent chez de nombreuses espèces, des chimpanzés aux rats en passant par les lions. L’existence de cet instinct peut s’expliquer par la sélection naturelle : le mâle qui, par cet instinct, fait place nette pour ses propres futurs enfants a plus de chances d’avoir des descendants. Cette hypothèse est confirmée pour les rats par l’expérience suivante : on badigeonne une ratte A avec l’urine d’une ratte B enceinte, ce qui a pour effet de donner à A l’odeur de B ; on met la ratte A ainsi parfumée en présence d’un rat et ils s’accouplent ; peu après, quand la ratte B a fait ses petits, on met ce rat en présence de la mère et des petits, et contrairement à ce qui se passe habituellement il ne les tue pas ; on suppose que le rat a l’instinct de tuer les petits des femelles qui sont nouvelles pour lui, et que le souvenir du parfum que portait la ratte avec laquelle il s’est récemment accouplé inhibe cet instinct infanticide. Par ce dispositif, que l’on peut supposer être un soubassement instinctif de l’amour paternel, le comportement du rat favorise la transmission de ses propres gènes. Dans l’expérience en question on leurre cet instinct. D’autres observations confirment cette hypothèse. La colonie de macaques entelles où un grand nombre d’infanticides par les mâles a été constaté vivait sur un territoire surpeuplé (suite à des déforestations) où la concurrence pour la nourriture et l’espace était rude. Dans une autre colonie de la même espèce, bénéficiant au contraire d’un large espace, il y avait peu de conflits entre mâles et pas d’infanticide [2]. On peut donc supposer que l’agressivité infanticide est déclenchée par les excitations liées au surpeuplement, et que les mâles qui ont cet instinct réussissent mieux à transmettre leurs gènes dans des conditions de concurrence exacerbée. Ces dispositifs, que pour abréger nous appellerons « l’instinct rat-macaque », existent aussi chez les femelles. On a vu des guenons macaques kidnapper le nourrisson d’une rivale et l’empêcher de l’allaiter. On a vu une louve massacrer les petits d’une autre louve.
L’instinct rat-macaque existe-t-il chez les humains ?
Ce qui est certain, c’est que l’instinct opposé existe : il n’est pas rare que le nouveau conjoint d’une personne se prenne d’affection pour les enfants qu’elle a conçus avec un conjoint précédent et qu’il les élève avec succès. D’ailleurs l’adoption existe chez les singes et chez les loups. Cela dit, le nouveau conjoint a probablement plus d’agressivité (ou moins d’inhibition à l’agressivité) vis-à-vis des enfants d’un conjoint précédent qu’il n’en aurait vis-à-vis des siens. C’est ce que laissent penser les statistiques suivantes : dans la société moderne actuelle, il n’y a qu’une très faible probabilité pour un bébé d’être victime de maltraitance mortelle de la part d’un adulte qui s’occupe de lui (par exemple quand un adulte excédé par les cris d’un bébé le secoue de colère au point de provoquer sa mort). Mais si l’homme avec lequel vit la mère d’un bébé n’est pas celui avec lequel elle l’a conçu, ce risque est nettement plus élevé que le risque moyen : 70 fois plus en Amérique du nord d’après une enquête citée par Sarah Blaffer-Hrdy. Mais cela peut s’expliquer aussi bien par un reste inconscient de jalousie que par un hypothétique instinct rat-macaque latent. Dans les sociétés polygames, un crime typique est l’empoisonnement des enfants d’une des co-épouses par une autre ; mais les calculs d’intérêt suffisent à expliquer ce fait sans qu’on l’attribue à un hypothétique instinct. D’ailleurs les mêmes calculs d’intérêt conduisent à des assassinats entre frères dans les familles royales.
L’histoire des guerres et des génocides, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ne permet pas de trancher cette question de façon probante. Certes il existe des sociétés guerrières où les hommes ravissent des jeunes femmes pour les épouser et tuent leurs bébés au passage. Mais il existe aussi des sociétés guerrières où les hommes ravissent des bébés pour les adopter après avoir tué leur mère. Dans la guerre en ex-Yougoslavie, les nationalistes qui systématiquement tuaient les hommes et violaient les femmes ne tuaient pas spécialement les petits enfants. Lors du génocide des Tutsis au Rwanda, la radio gouvernementale insistait pour qu’on n’oublie pas de tuer les enfants, mais on tuait aussi les femmes, même après les avoir violées.
On peut donc penser que l’instinct rat-macaque est insignifiant chez les humains. On peut faire l’hypothèse qu’il a été éliminé par la sélection sexuelle. Les femmes sont certainement beaucoup moins disposées que les rattes et les guenons à se laisser approcher par un mâle qui vient de massacrer leurs enfants. Il est probable que les préférences des femmes et leur sens moral plus aigu que celui des guenons les aient amenées à sélectionner les hommes enclins à être gentils avec les enfants qui ne sont pas les leurs.
Cette discussion montre que les raisonnements sur les instincts sont toujours hypothétiques. Il est difficile d’isoler des faits probants. Et si on ne le fait pas on risque de tomber dans des raisonnements oiseux, ou des clichés, ou des fantasmes.
Le concept de scénario instinctuel est un concept-valise
Quand un scénario de comportement est typique chez une espèce, avec des enchaînements stimulus-réponse prévisibles, on l’appelle un instinct, on suppose qu’il a sa source dans des prédispositions innées et héréditaires. Mais comment ?
On peut faire l’hypothèse qu’il existe un programme tout prêt (lui-même fabriqué par un programme génétique), qui serait inscrit quelque part dans le système nerveux comme un programme est inscrit dans un ordinateur, et qui n’attendrait que l’occasion de s’actualiser. Mais à vrai dire on ne sait pas dans quelle mesure un instinct est programmé en détail dans l’héritage génétique, ou s’il est plutôt élaboré dans l’histoire de l’individu et du groupe, soit en réponse à des besoins typiques de l’espèce dont les modes de satisfaction ne seraient pas pré-programmés, soit en réponse à des prédispositions qui ne seraient que des esquisses grossières susceptibles de mises au point diverses selon les expériences pratiques. Dans cette dernière hypothèse, chaque individu réinventerait l’instinct à son tour, ou du moins le mettrait au point par essais et erreurs, en empruntant certes des passages obligés, donc semblables dans toute l’espèce, mais pas nécessairement programmés. De fait, on constate que la plupart des instincts nécessitent une mise au point par des interactions sociales, et que par là ils ont des marges de variation, ils sont plus ou moins élastiques. Il y a chez les primates, et surtout chez les humains, des prédispositions instinctuelles à l’élasticité culturelle.
D’autre part tous les comportements typiques ne s’expliquent pas par la métaphore du programme informatique. Il existe dans les interactions sociales, mais aussi dans le fonctionnement des organes et notamment du cerveau, des déterminismes dont le programme n’est écrit nulle part et qui sont le produit d’un ensemble de mécanismes d’équilibration fonctionnant de façon probabilitaire. Les comportements qui en résultent ne sont pas immuables mais peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs aléatoires (et dont on ne connaît pas la liste intégrale). Les comportements que l’on repère comme typiques sont en fait seulement les plus probables, mais des comportements improbables existent aussi, qui peuvent s’avérer viables dans certaines conditions. Il faut donc éviter une vision mécaniste des instincts.
En somme le concept d’instinct est un concept-valise : on ne sait pas exactement comment fonctionne un instinct, et il résulte probablement de la combinaison de plusieurs processus différents [3]. Mais ce n’est pas un concept fourre-tout : parler d’un instinct n’est utile que si cela aide à expliquer des faits observables et à en découvrir de nouveaux.
L’autonomie de l’agressivité : critique de l’utilitarisme
L’agressivité existe entre singes du même groupe : pour la nourriture, pour le sexe, pour le pouvoir. Bref, l’individu agresse autrui pour défendre et promouvoir ses propres intérêts. Mais cette explication utilitariste de l’agression est sans doute trop rationaliste, car souvent les singes s’agressent par jeu, sans qu’on puisse penser qu’ils en escomptent un avantage autre que le plaisir de l’agression en elle-même. Par exemple les jeunes singes aiment agresser un peu les adultes pour le plaisir de les taquiner ou de déclencher leur colère, comme les préadolescents humains qui s’amusent en groupe à provoquer les personnages d’autorité. Ce comportement a sans doute son utilité objective comme entraînement ludique à la compétition sociale (ce qui explique qu’il se soit maintenu par sélection naturelle), mais on peut se demander dans quelle mesure l’individu organise son action par conscience de ce but, ou s’il agresse plutôt de façon compulsive, poussé par un instinct préprogrammé. Dans le cas des humains, nous savons par introspection et par la psychanalyse que l’agression par bravade s’explique par un raisonnement, en grande partie inconscient, fantasmatique et pervers : j’agresse pour montrer ma force, et en agressant un personnage d’autorité, je montre aux autres et à moi-même que je suis plus fort que la Loi. Peut-être que les singes tiennent des raisonnements de ce genre, mais comme ils ne parlent pas, on ne peut pas les amener sur le divan du psychanalyste pour en savoir plus. Mais le fait que ces agressions sont stéréotypées dans chaque espèce et ont un aspect compulsif, et le fait qu’on en trouve l’équivalent chez les poulets et autres oiseaux qui par ailleurs n’ont pas de grandes facultés de raisonnement, tout cela laisse penser que l’agressivité est d’abord un instinct préprogrammé... même si cet instinct peut être réorganisé par un raisonnement utilitaire ou fantasmatique.
L’instinct d’agression peut fonctionner par lui-même, sans que l’individu y recherche un bénéfice alimentaire, sexuel ou social. C’est ce que montre l’expérience suivante. Si on lâche une souris à proximité d’un chat, il essaie de l’attraper et il la tue, même s’il n’a pas faim, même si on lui donne régulièrement à manger, et même s’il n’a été élevé que par des humains qui ne lui ont jamais appris à chasser. Après que le chat a tué et mangé la souris, si on en lâche une deuxième il l’attrape et la tue, et ainsi de suite. Au bout d’un certain temps le chat cesse de manger les souris, mais il continue à les tuer. Si à ce moment-là on lâche une souris juste devant le chat et en même temps une autre un peu plus loin, plus difficile à attraper, le chat délaisse la proie facile et se précipite pour attraper la plus difficile [4]. D’ailleurs quand un chat attrape une souris il est fréquent qu’il ne la tue pas tout de suite, et qu’il joue un certain temps avec, d’une manière qui nous semble sadique. Tout cela montre que le comportement de prédation est en grande partie inné et indépendant du comportement alimentaire, même si évidemment il lui est le plus souvent associé. Si cela est vrai pour la prédation, c’est probablement vrai aussi pour l’agressivité intraspécifique (l’instinct d’agression entre membres d’une même espèce), y compris chez les humains.
Que la prédisposition à la violence soit innée, c’est ce que tend à prouver la présence de la violence à des degrés divers dans toutes les sociétés. Il y a des actes de violence gratuite entre les enfants dans une crèche ; on prend plaisir à faire souffrir autrui, notamment par la moquerie, et par le choix d’une « tête de Turc » (ces comportements existent aussi chez les chimpanzés) : tout porte à penser qu’il y a une prédisposition innée à la méchanceté. À la tendresse aussi.
L’inné et l’apprentissage. Un exemple : la violence masculine
Chacun connaît la controverse sur l’inné et l’acquis. En gros, elle oppose les conservateurs et les progressistes. Par exemple les conservateurs pensent que les comportements masculins et féminins sont en grande partie innés, qu’il y a une nature masculine et (surtout !) une nature féminine différentes. C’est ce qui expliquerait que les garçons soient plus brutaux et les filles plus douces, et il serait malsain de vouloir modifier cet état de fait. Les progressistes n’ont aucune difficulté à montrer que les rôles masculins et féminins sont appris dès la petite enfance, que les enfants les acquièrent par imitation, que les adultes les leur inculquent y compris par l’intimidation (« ce n’est pas bien pour une fille de taper comme ça ») et par des gestes inconscients. La preuve que ce n’est pas inné c’est qu’il y a des garçons normaux qui ont un caractère dit féminin et inversement ; il n’y a aucun trait de caractère typiquement masculin qu’on ne retrouve chez certaines femmes et inversement. La liste des comportements typiquement masculins ou féminins est très différente d’une culture à une autre, ce qui prouve que c’est culturel. Dans chaque culture la référence à une supposée nature sert à justifier des jugements de valeur qui en fait se sont formés dans l’histoire. À quoi les conservateurs répondent par les statistiques : statistiquement les hommes commettent plus de violences que les femmes, les garçons sont plus brutaux que les filles. Les coupables d’homicides sont très majoritairement des hommes. La très grande majorité des meurtres conjugaux sont le fait de l’homme, qui dans la plupart des cas reproche à sa femme de vouloir le quitter ou de lui être infidèle ; dans la minorité de meurtres conjugaux qui sont le fait de la femme, le mobile de la femme est le plus souvent la peur de la violence de l’homme. Cette dissymétrie se retrouve dans des sociétés très différentes. Il y a peut-être des sociétés qui valorisent la douceur masculine et la brutalité féminine, mais elles sont rares. Les progressistes répondent que ces faits ne proviennent pas de tendances innées mais de rapports de force qui dictent les choix de comportement de chacun(e) à travers lesquels se forment les habitus. La sociologie de Bourdieu en a donné de nombreux exemples. On croit que les habitus sont naturels parce qu’on n’est plus conscient de leurs origines. Mais comment expliquer alors le maintien d’une différence statistiquement importante entre la plus grande brutalité des garçons et la plus grande douceur des filles même si les parents et l’école les ont élevés en faisant pression sur eux pour qu’ils n’adoptent pas ces comportements ? Certes on peut attribuer cela à l’influence de la télévision (?) et de l’environnement social ; ou encore aux significations fantasmatiques qui passent dans les récits (les contes de fées par exemple... mais c’est de moins en moins vrai car les auteurs d’albums et de dessins animés inventent des contes féministes). Plus important encore : il y a des messages émotionnels inconscients qui passent par les gestes des adultes, et l’ethnologie montre que les gestes et les émotions sont culturels. Les progressistes peuvent faire remarquer que tout cela se modifie avec les générations. C’est vrai, mais est-il vraisemblable biologiquement que l’inconscient des gestes et des émotions soit complètement culturel ? La neurologie actuelle et l’éthologie humaine montrent que les émotions de base sont transculturelles et universelles. Par exemple, s’il existe des codes culturels pour les expressions du visage, certaines expressions sont comprises universellement.
Sartre a formulé de façon autocaricaturale de la thèse de l’insignifiance de l’inné : « il n’y a pas de nature humaine », a-t-il écrit, à la fois contre les conservateurs et contre les rousseauistes naïfs. Mais Sartre ne s’intéressait pas beaucoup à la biologie. Si les progressistes comptent sur l’avenir pour prouver la thèse de l’insignifiance de l’inné, ils risquent d’être déçus, d’une part par la résurgence de comportements ataviques, d’autre part par les découvertes de la science. Et les conservateurs auront beau jeu de les dénoncer, ce qui me gène car les conservateurs sont le plus souvent enclins à s’accommoder de la domination et de l’oppression.
Or les biologistes savent depuis quelque temps que le fait qu’un comportement ait besoin d’être appris ne prouve pas que la prédisposition n’en est pas innée.
Par exemple, la peur des serpents est vraisemblablement un instinct inné. De nombreuses espèces de mammifères ont peur des serpents. Chez les humains et les singes, rares sont les individus qui n’en ont pas peur. Cette peur bien définie (on a beaucoup moins peur des lézards) est une émotion dont l’intérêt adaptatif ne fait guère de doute. Or un jeune chimpanzé qui n’a jamais vu de serpent n’a pas peur quand il en voit un pour la première fois. Mais s’il voit un adulte avoir peur d’un serpent il prend peur lui aussi, et il manifestera dorénavant la peur des serpents. On peut facilement inculquer la peur des serpents à un jeune chimpanzé qui n’en a jamais vu en lui montrant une vidéo où des singes ont peur des serpents. Cette émotion est donc acquise par l’éducation. Mais ce n’est pas si simple. On a essayé d’inculquer la peur des fleurs à un jeune chimpanzé en lui montrant des vidéos où des singes avaient peur des fleurs (on avait mis des fils électriques dans les fleurs, si je me souviens bien). Or cela ne marche pas : il faut énormément insister pour que le chimpanzé acquière la peur des fleurs. Il est donc vraisemblable qu’il a une prédisposition innée à la peur des serpents, que l’expérience et l’éducation ne font qu’actualiser et nuancer cette prédisposition, et qu’à l’inverse il n’a pas de préjugé inné contre les fleurs.
Donc l’universalité d’un comportement, ou simplement sa forte fréquence, donne à penser qu’il existe une prédisposition innée à ce comportement. Donc il faut s’attendre, quelle que soit la culture, à de faciles résurgences de la brutalité masculine. Mais cela n’inclut aucune fatalité, justement parce que les prédispositions innées ne s’actualisent que par l’expérience et l’éducation, et peuvent s’actualiser de diverses façons.
Il ne faut donc pas nier les prédispositions innées, mais essayer, si l’on veut modifier la culture humaine, de comprendre comment elles s’actualisent, sachant que pour l’instant on ne connaît pas en détail la façon dont elles sont programmées par les gènes. Les différences d’agressivité entre les mâles et les femelles s’expliquent par les hormones, mais à ma connaissance on ne sait pas exactement comment les gènes masculins et féminins déterminent le phénotype et le régime hormonal. Ce sont des processus complexes et il n’y a sans doute pas une différence simple et étanche entre le masculin et le féminin, comme le croient les conservateurs, mais plutôt des différences dont l’articulation peut connaître des variantes importantes.
Prenons un autre exemple. Les bébés sont en général plus attachés à leur mère qu’à leur père, disons plus à la femme qui les allaite qu’au compagnon de cette femme, même si ce compagnon a l’habitude lui aussi de dorloter l’enfant, de lui faire sa toilette et de lui donner le biberon. Y a-t-il une prédisposition innée à cette préférence du bébé pour la femme ? C’est plausible. Mais ce n’est pas simple. Quand un bébé pleure la nuit, la femme, le plus souvent, se réveille plus vite que l’homme et va plus vite s’occuper du bébé. Cela s’explique par les hormones : quand on fait entendre les pleurs d’un bébé à un adulte qui dort, cela déclenche une sécrétion hormonale qui le réveille et le rend actif. Or le délai de déclenchement, le temps de latence, est plus long chez les hommes que chez les femmes, différence qui n’est probablement pas culturelle. En conséquence, il y a une plus forte probabilité que l’enfant qui pleure la nuit soit consolé et pris en charge par la femme que par l’homme. Or le bébé s’attache de préférence à la personne qui le materne. Donc même s’il est plausible que les premières perceptions du nouveau-né (les odeurs, la voix) le prédisposent à s’attacher à sa mère, on peut créer un attachement à une autre personne, même un homme : cela fait aussi partie des prédispositions instinctuelles du bébé. C’est ce qui arrive par exemple si on décide que la mère mettra des bouchons d’oreille pour dormir et que c’est l’homme qui se lèvera la nuit pour donner le biberon. Tactique contre nature ? Non. Une tactique semblable est utilisée instinctivement par les guenons d’une espèce monogame appelée titi : après la tétée la guenon repousse le bébé et l’empêche de s’accrocher à elle, il s’accroche donc au père et c’est le père qui va le prendre en charge. Le naturel n’est pas invariable, la sélection naturelle a mis en nous des prédispositions adaptatives très diverses. Par exemple, les chimpanzés mâles, qui d’ordinaire ne s’occupent pas des bébés et en laissent la charge aux guenons, vont s’occuper d’un bébé si aucune femelle n’est présente pour le faire. L’inné est différent de l’image qu’en ont les conservateurs.
En conclusion, il existe des prédispositions innées, on peut s’en faire une idée conjecturale, et il est prudent de ne pas les frustrer complètement. Par exemple il est utile de laisser les enfants faire l’expérience de leur propre brutalité (ne serait-ce que pour prendre conscience de leurs capacités instinctives de réconciliation). Il est vain de vouloir faire adopter aux enfants des comportements unisexes, puisqu’il y a des différences naturelles. Tout autant, il est bon qu’un garçon fasse l’expérience de sa capacité, naturelle elle aussi, à se comporter de façon « féminine », et inversement. Pour nous rendre capables de prendre en main notre histoire il est de bonne politique d’explorer les diverses possibilités qu’offrent nos prédispositions naturelles.
L’instinct n’est pas un destin. Pluralité et élasticité
Il y a chez chaque individu une pluralité d’instincts, éventuellement opposés, et qui s’actualisent de façon variable, avec des éliminations et des compromis, selon l’expérience de l’individu. C’est ce schéma que Lorenz résume par la métaphore du « parlement des instincts ».
La pluralité des instincts s’explique par la théorie darwinienne de l’évolution : les instincts qui se sont transmis sont ceux qui dans le contexte écologique et social où s’est formée l’espèce étaient les plus favorables à la survie de l’individu et à sa reproduction : la méchanceté permet d’éliminer les concurrents, la tendresse et la coopération permettent de gagner des alliés dans le groupe, la moquerie permet de disqualifier les concurrents dans l’opinion des autres, enfin la souplesse dans la combinaison de ces instincts permet leur utilisation adéquate dans des interactions sociales complexes.
Composites et biologiquement construits, les instincts ont donc une marge de variation, plus ou moins étendue selon les espèces. La culture, c’est-à-dire les comportements qui sont inventés puis transmis par l’éducation, intervient dans cette variabilité des instincts, chez les animaux (voir les livres de De Waal, notamment Quand les singes prennent le thé - titre ironique !) et dans une mesure beaucoup plus grande chez les humains. L’instinct n’est pas un destin.
Freud a montré comment l’affectivité de chacun s’associe dès la petite enfance à des objets et des scénarios proposés par les humains avec lesquels l’enfant est en relation, et comment les conflits psychiques conduisent à des transformations fantasmatiques et à des substitutions des objets du désir. Cela dit, la présence d’émotions et de comportements communs à toute l’espèce humaine, ou fréquents parmi des cultures par ailleurs très différentes, et qui ont des homologues chez d’autres espèces de primates, laisse penser que des exigences instinctives restent sous-jacentes dans un psychisme transformé par la culture.
Chez les chimpanzés, le degré d’agressivité est variable selon la psychologie de chaque individu (on peut modifier les rapports hiérarchiques dans un groupe de singes en donnant des calmants ou des excitants à l’un des individus) et selon les habitudes relationnelles (la culture politique en quelque sorte) qui se sont installées dans l’histoire des relations de pouvoir au sein du groupe. Chez les primates l’éventail des variantes comportementales est assez large et l’ordre social dépend de l’histoire singulière du groupe. Cela dit il y a pour chaque espèce des types de rapports sociaux qui sans être inéluctables tendent à s’établir avec une forte probabilité, ce qui laisse penser qu’il y a des scénarios instinctuels préprogrammés. C’est le cas chez les chimpanzés pour la polygamie autoritaire et la guerre.
Parmi les primates, les humains ont les instincts les plus élastiques, les capacités d’apprentissage et de raisonnement les plus étendues, les formes sociales les plus variables. La primatologie ne nous enferme pas dans un modèle unique et confirme l’idée que les humains ont à tracer leur propre chemin. Mais il est utile pour cela de connaître nos prédispositions et les scénarios tout prêts qui sont en nous. Même et surtout si nous voulons inventer d’autres scénarios [5], nous devons connaître les ornières dans lesquelles nous risquons de tomber, et les prédispositions auxquelles nous devons répondre pour que notre vie sociale soit vivable. De plus, certains comportements humains n’ont peut-être aucun homologue chez les primates. Par exemple, dans le domaine du langage, l’écriture ; dans le domaine des sentiments, la mono-homosexualité. Certaines actions s’expliquent par la curiosité, le désir de nouveauté (qui est peut-être un instinct mais qui par définition ne conduit pas à des actes préprogrammés) ; surtout, d’autres actions résultent d’une réflexion stratégique, d’un raisonnement où l’individu a comparé en imagination plusieurs possibilités d’action et leurs conséquences. De Waal a clairement mis en évidence des raisonnements chez les chimpanzés, raisonnement visant certes à satisfaire des instincts, mais avec des inventions.
Pour avoir quelques chances de comprendre les causes et les fonctions d’un comportement humain, il ne suffit pas de le comparer terme à terme à des comportements homologues ou analogues existant chez les animaux, mais il faut comparer un échantillonnage de ces comportements dans différentes espèces, afin de repérer les facteurs pouvant expliquer leur présence ou leur absence et leurs variantes, pour ensuite se demander si de tels facteurs sont présents dans l’espèce humaine et comment ils agissent. C’est seulement ainsi que l’on peut comprendre la fonctionnalité spécifique d’un comportement. Les homologies ou analogies terme à terme peuvent suggérer des idées mais elles peuvent aussi être trompeuses.
Notre auto-domestication
Les différences de comportement dans une même espèce de mammifères entre l’état sauvage et l’état domestique nous invitent à considérer l’humanité comme une espèce qui s’est auto-domestiquée par sa propre culture. L’expérience millénaire de la domestication des animaux montre que les instincts d’une espèce ne sont pas indéfiniment élastiques, mais aussi qu’ils peuvent s’ordonner selon plusieurs dispositifs différents, plusieurs modes de vie satisfaisants, le mode de vie sauvage n’étant pas forcément le meilleur.
Dans les groupes de chimpanzés vivant dans un zoo, il y a plus de querelles que dans les groupes vivant dans la nature, car les individus en conflit ne peuvent pas s’éloigner et encore moins quitter le groupe. Mais de ce fait la culture du groupe est plus tournée vers la réconciliation. Pour cette raison, et contrairement à ce qui se passe chez les rats, la promiscuité, la diminution de l’espace disponible, ne conduit pas à une augmentation de la violence. Il en va de même chez les êtres humains entassés dans des villes surpeuplées. Si les groupes de chimpanzés en zoo sont moins violents que dans la nature, c’est d’une part grâce à une culture de la réconciliation, d’autre part parce qu’il y a assez à manger pour tous (donc les conflits n’ont pas un enjeu vital), enfin parce que les gardiens font la police et arrêtent les conflits trop dangereux. En somme, comme ils n’ont pas de prédateurs, et pourvu qu’ils aient assez d’espace, que leur environnement soit assez riche, qu’ils ne soient pas privés de vie sociale, qu’ils soient bien alimentés et bien soignés, il se peut que les chimpanzés vivent mieux en zoo que dans la nature. Ils passent plus de temps à la sexualité, à la vie sociale, aux loisirs et au bricolage ; n’ayant pas à craindre pour leur vie, les dominés peuvent être plus libres vis-à-vis des dominants. En somme, un bon système de sécurité, un accès garanti à l’alimentation et à la santé, et une culture obligatoire de la réconciliation créent les conditions d’une vie plus « humaine » pourrait-on dire. Nous les humains, bien sûr, nous devons avoir des ambitions culturelles plus élevées (voir note précédente), mais nous n’améliorerons pas notre vie d’animaux « auto-domestiques » dans la civilisation, conformément à notre nature de primates, si nous ne réalisons pas ces mêmes conditions. Et c’est à nous de le faire puisque nous n’avons pas de gardiens d’une espèce plus intelligente que la nôtre.
Reprenons notre raisonnement. D’un côté on ne peut pas dire que les instincts d’agressivité de l’individu soient produits par la compétition sociale : ils sont innés, ils sont l’héritage de l’évolution ; mais d’un autre côté ces instincts ont des fonctions dans la compétition sociale, et s’actualisent plus ou moins selon le succès qu’ils rencontrent dans leur utilisation. En résumé l’agressivité s’intègre à des instincts qui visent la nourriture, le territoire, le sexe et le pouvoir. Examinons les facteurs de violence et de non-violence liés à ces différentes motivations.
« Défendre son bifteck » : l’agressivité dans la compétition pour la nourriture et le territoire
Les chimpanzés se volent mutuellement la nourriture, comme des chiens. Il est facile de diminuer la violence de cette compétition : dans un zoo où les singes ont assez à manger et ont des abris confortables, la « loi de la jungle » n’a plus cours : les agressions entre les individus, tout en restant fréquentes, sont moins violentes que dans la nature, où beaucoup de singes portent des traces de blessures infligées par leurs congénères. Cela dit, les singes ne se battent pas comme des chiens : ils savent partager. Les chimpanzés dominants laissent les autres prendre un peu de leur nourriture. Les singes savent coopérer dans la recherche de nourriture (les loups et les chiens aussi, qui chassent en meute) et la défense de leur territoire. C’est entre autre à cela que servent les liens affectifs qu’ils créent entre eux. Ces liens sont le plus souvent hiérarchiques (ce qui nous amène à la question du pouvoir), et parfois amicaux et égalitaires, notamment entre les guenons. Les conclusions que l’on peut tirer de tout cela concernant les humains sont assez banales : ce qui aide à la prévention des guerres, c’est la prospérité, et plus encore des habitudes de coopération mutuellement avantageuse et une répartition des richesses reconnue comme juste ou admise comme légitime. Mais cela ne supprime pas toutes les causes de la violence, comme on va le voir dans ce qui suit.
L’agressivité dans la compétition pour obtenir des partenaires sexuels
Cette question sera abordée plus loin. Gardons-la pour la fin. Voyons maintenant comment l’agressivité est au service de la domination et du pouvoir.
Fonctionnalité de l’instinct de pouvoir
Les inhibitions à l’agressivité, ainsi que les comportements de réconciliation, permettent des rapports de coopération. L’agressivité maintenue sert dans la compétition canalisée au sein de ces rapports de coopération. Entre deux individus le rapport est à la fois de compétition et de dépendance. Comme le rapport des forces est le plus souvent asymétrique, ce qui se met en place est le plus souvent un rapport de domination. La coopération égalitaire est moins probable, mais peut exister. Par conséquent, et d’autant plus dans une espèce qui a une vie sociale intense, chaque individu en compétition avec les autres pour la nourriture et pour le sexe a besoin de former des alliances, et le fait le plus souvent par des rapports de domination et d’allégeance. Cela explique l’existence d’un instinct de domination et de soumission, qui s’ajoute et se combine aux instincts alimentaires, sexuels, de coopération, et d’agressivité. L’agressivité sert donc à la domination. Par exemple quand un chien rencontre un congénère il essaie de le dominer et dès qu’il se rend compte qu’il n’y parvient pas il adopte un comportement de soumission [6]. En conséquence de cela, dans les espèces qui vivent en groupe, l’empilement des rapports de domination met en place une hiérarchie. Plusieurs ordres hiérarchiques différents peuvent coexister (par exemple, dans le même groupe un jeune mâle peut être au sommet de la hiérarchie pour la chasse, et une vieille femelle pour la recherche de points d’eau), ainsi que des contre-pouvoirs, mais la combinaison des facteurs de puissance tend à constituer une hiérarchie unique, stable ou instable. Les formes de hiérarchie sont variables mais dans chaque espèce certaines formes de hiérarchie sont plus probables que d’autres. Dans un groupe de primates, les individus passent une grande partie de leur temps à lutter pour défendre ou améliorer leur position dans la hiérarchie, par des querelles, des démonstrations de force, et des alliances. Il y a donc chez les primates non seulement un instinct de domination, mais un instinct de pouvoir à proprement parler. Ce que nous appelons ici le pouvoir, c’est le fait de recevoir l’allégeance d’autrui, voire de nombreux autruis, le fait d’être reconnu comme un dominant ; cela donne des prérogatives pour imposer ses décisions, commander les actions d’autrui, agir même sur les désirs d’autrui. Par là le dominant a une puissance d’action accrue, un « pouvoir » au premier sens du verbe pouvoir ; mais ce que nous appelons ici l’instinct de pouvoir, c’est la recherche instinctive de l’allégeance des autres et le goût des prérogatives qui en découlent. Donc le goût du pouvoir n’est pas un produit tardif du fonctionnement des systèmes politiques humains, c’est un instinct commun à tous les singes et qui sert à la compétition au sein de rapports de domination. Avant d’être un « animal politique » (Aristote), l’homme est une bête de pouvoir. Surtout les mâles.
La politique a sa source dans les rapports de pouvoir, mais elle est plus que le pouvoir : elle est l’art d’utiliser le pouvoir pour manipuler et modifier les règles de pouvoir. La politique suppose le Droit, c’est-à-dire non seulement une capacité à suivre des règles implicites dans ses actes (ce que même les singes savent faire, mais aussi les loups, les chiens et les vaches), mais une capacité à se représenter ces règles dans leur généralité abstraite, à les exposer par le langage, et à agir sur elles pour les modifier ou les renforcer. Ce que, semble-t-il, les humains sont les seuls à savoir faire : les singes ont des coutumes qu’ils savent suivre, ou bafouer, ou modifier dans la pratique... mais ils n’ont pas de Droit coutumier [7].
L’autonomie et la puissance de l’instinct de pouvoir
Le désir humain du pouvoir est sans doute enraciné dans les instincts. Par exemple, ce n’est pas le besoin de nourriture et de confort qui pousse les riches à vouloir amasser toujours plus de richesses, même quand ils en ont déjà assez pour pouvoir vivre sans souci : c’est le désir d’être reconnu comme plus puissant que les autres, et de pouvoir commander à beaucoup. Les explications psychanalytiques (inflation du narcissisme, compensation du complexe d’infériorité, etc.) ramènent le désir de pouvoir à un système de fantasmes, mais on peut supposer, d’après les observations de l’éthologie animale, que ces fantasmes accompagnent des scénarios instinctuels préprogrammés. Voilà où je veux en venir : la réponse à l’instinct de pouvoir est aujourd’hui le principal problème éthologique d’une politique de la non-violence. On sait comment éviter la violence dans les conflits pour la nourriture : il faut obliger les riches à partager (encore faut-il le vouloir... et savoir mettre en place des rapports de coopération à la fois efficaces et justes). On ne sait pas bien comment éviter les violences générées par la sexualité, mais on peut les interdire, et de toute façon ce n’est pas le sexe qui déclenche les guerres. En revanche on se demande comment contrer la soif de pouvoir qui conduit au mépris des opprimés, au creusement des inégalités, à l’accumulation d’armes, aux guerres et à la terreur d’État.
Pour comprendre la logique du pouvoir chez les humains il n’est pas inutile de voir ce qu’il en est chez les autres primates.
De Waal a décrit la lutte pour le pouvoir entre les mâles au sein d’un groupe de chimpanzés : coups et blessures, menaces, harcèlement, alliances, répartition des prérogatives, reversement d’alliances, meurtre. Chez les chimpanzés la lutte pour le pouvoir passe surtout par les démonstrations de force et par la violence, mais aussi par les tactiques d’alliance : chaque dominant essaie d’obtenir le maximum de soutiens dans le groupe, ce qui donne un pouvoir aux dominés, et à l’opinion publique. Si par exemple un jeune ambitieux, appelons-le Iznogoud, essaie de prendre la place du vieux maître du harem, et même si les guenons ne sont pas insensibles à son charme, il se peut qu’elles se coalisent pour défendre le vieux. Cela peut s’expliquer de diverses façons : soit elles apprécient son caractère débonnaire (dans ce cas on peut dire qu’elles font un choix quasi démocratique), soit elles sont attachées à la tranquillité qu’assure la stabilité monarchique (ce qui ressemble au contrat social théorisé par Hobbes : un accord implicite entre les citoyens légitime un pouvoir autoritaire qui brise les ambitieux et assure la paix), soit tout simplement elles se soumettent instinctivement à celui qui a des poils blancs sur les épaules, car c’est un instinct chez les chimpanzés (le charme des tempes grisonnantes !). Bref, si le pouvoir chez les chimpanzés repose principalement sur des rapports d’allégeance quasi féodale, il existe des contrepoids quasi démocratiques, disons plutôt consensuels. Par ailleurs, certains individus peuvent s’écarter de la compétition. D’autres, des guenons surtout, cultivent plutôt l’amitié que l’allégeance. Donc tous les rapports au sein du groupe ne sont pas des rapports de pouvoir. Mais comme l’a fait remarquer Hobbes, il suffit que deux ou trois individus se lancent dans la lutte pour le pouvoir, pour que cette dernière devienne le principal organisateur de la vie sociale. Or cela est hautement probable, parce que le pouvoir donne des prérogatives dans l’accès à la nourriture et au sexe, et tout simplement parce qu’il y a un instinct de pouvoir.
Psychologie des grands hommes
La lutte pour le pouvoir sélectionne les individus dominants qui de par leur histoire personnelle sont les plus motivés par leur instinct de pouvoir, car ils ont l’énergie pour éliminer les autres de la compétition. Il en est de même chez les humains [8]. Ensuite, pris dans la compétition pour le pouvoir, ces individus sont moins sensibles à leurs propres instincts non-violents qu’ils ne le sont dans la vie courante. Ainsi, même s’ils ne sont pas spécialement sadiques à l’origine, ceux qui ont le pouvoir sont amenés à commettre en situation ordinaire des crimes que les autres individus n’oseraient pas commettre, ou ne commettraient que dans l’engrenage d’une situation de guerre. Ceci explique que des hommes de pouvoir puissent opter délibérément pour le chaos ou pour la guerre. Comment expliquer autrement que Madeleine Allbright ait opté ouvertement pour la mort des enfants irakiens sous l’effet de l’embargo ? que Mitterrand ait laissé ses alliés politiques au Rwanda préparer un génocide très comparable à la Shoah ? que Milosevic ait lancé son propre pays dans le chaos ? Analysons la guerre en ex-Yougoslavie dans une perspective primatologique. Les massacres communautaires, équivalent collectif de la vendetta, le génocide des hommes et le viol des femmes, font partie des comportements instinctuels des primates, mais l’horreur et la réprobation face à ces crimes sont également instinctuelles. La plupart des humains ne massacrent qu’en situation d’affrontement aigu, ou parce qu’une autorité leur commande de le faire. Or qui décide de précipiter l’affrontement, de faire la guerre, si ce n’est les dirigeants, qui le plus souvent ont le choix entre des procédures de négociation et la guerre. Pourquoi alors choisir la guerre ? C’est que la guerre renforce les dirigeants en justifiant la militarisation de la société par la nécessité de se défendre ; et surtout la guerre, en excitant l’esprit de vengeance, empêche la réconciliation et la coopération entre les communautés, ce qui permet le maintien au pouvoir de ceux qui dirigent la société en guerre. Si l’on veut éviter les guerres, il est certes utile d’encourager les instincts de non-violence des gens et de les entraîner aux procédures de réconciliation (ce qu’on appelle la résolution pacifique des conflits). Mais le plus décisif est d’imposer un contrôle humaniste sur les hommes de pouvoir. Une culture de la coopération et de la justice (voir § « défendre son bifteck ») doit s’accompagner d’une culture du contrôle du pouvoir, culture humaniste et pas seulement démocratique (car une démocratie peut voter pour une guerre).
Technique humaine et rapports de pouvoir
Ce ne sont pas seulement les dirigeants politiques qui sont à contrôler, mais aussi ceux qui disposent des moyens de production, les dirigeants économiques.
La puissance économique est une forme spécifiquement humaine de pouvoir. Les techniques de production inventées par la culture humaine permettent l’accumulation de pouvoir économique, qui à son tour excite le désir de pouvoir... et à son tour c’est le plus souvent le désir de pouvoir qui pousse au développement de la puissance technique, comme l’ont souligné plusieurs philosophes tels que l’École de Francfort, ou Jacques Ellul, ou d’autres.
Pour impressionner leurs congénères les chimpanzés dominants font rouler de grosses pierres et brandissent des branchages. Des humains dominants peuvent faire beaucoup plus. Grâce aux techniques inventées cumulativement par les humains, ils peuvent produire des biens pour séduire les autres et surtout pour les rendre dépendants. Mieux, ils peuvent utiliser le pouvoir politique et militaire pour contraindre certains à produire des biens qu’eux-mêmes contrôleront : c’est ce qu’on appelle l’exploitation. Ceux qui disposent de machines puissantes (des navires par exemple, dans l’antiquité ou aujourd’hui) peuvent faire faire de grands travaux de transformation et de transport. Ils peuvent rendre les autres dépendants des marchandises qu’ils contrôlent : c’est ce qu’on appelle conquérir des marchés. Ils peuvent acheter à bas prix les services des travailleurs. Commander une armée. Acheter les dirigeants politiques. Rien de tout cela n’existe chez les singes. Ils savent fabriquer des outils (80 sortes d’outils chez les chimpanzés) mais ils n’ont pas assez d’intelligence technique pour produire des richesses accumulables. Comme par ailleurs chaque adulte est capable de fabriquer lui-même ses outils et de se procurer seul sa subsistance, les singes se limitent à une « économie de la main à la bouche » et ne connaissent ni la division du travail ni l’accumulation de pouvoir économique. Ils pratiquent l’entraide, pas la coopération à grande échelle. Ils connaissent l’échange (ou plutôt le don réciproque qui crée un lien), pas le marché. Ils pratiquent l’extorsion, pas l’exploitation proprement dite : les singes dominants peuvent contraindre les dominés à leur donner de la nourriture qu’ils ont trouvée ; mais on n’observe pas chez les singes un contrôle de l’organisation du travail des dominés par les dominants. Si l’exploitation n’existe pas, en revanche l’exclusion existe chez les singes, comme conséquence de la domination et de la stratification sociale, comme chez les humains (dans la société humaine d’aujourd’hui, il est souvent pire d’être exclu que d’être exploité). Les enjeux des rapports sociaux chez les singes sont donc l’acquisition de nourriture (et non la production), et la sexualité et la reproduction. Chez les humains l’organisation de la production est un enjeu décisif.
La dialectique de la coopération et du pouvoir, qui ne peut pas se développer chez les singes, se développe chez les humains en ce que Marx appelle les rapports sociaux de production, c’est-à-dire des systèmes complexes de pouvoir dans la mise en œuvre des techniques, qui constituent le principal processus organisateur des sociétés humaines.
Action politique et instincts humains
Le contrôle des dirigeants, plus : le contrôle des rapports de pouvoir, passe par des mesures politiques et juridiques qui n’existent pas chez les singes (construire l’ONU par exemple) et par des changements dans les rapports de production (défaire le capitalisme, ou le confiner par des lois démocratiques). Cela pose des problèmes spécifiquement humains pour lesquels il n’y a pas de modèle chez les singes. Ce à quoi peut nous aider la primatologie, c’est à comprendre les instincts qui sous-tendent les luttes de pouvoir, et c’est aussi à mobiliser nos énergies émotionnelles et nos ressources instinctuelles pour chercher des solutions vivables et pour les imposer aux dominants.
Rien n’indique qu’il y ait des inhibitions naturelles à l’instinct de pouvoir (contrairement à l’agressivité et à la sexualité). Mais il y a des contrepoids. Non seulement des contrepoids institutionnels spécifiquement humains, mais aussi des contrepoids instinctuels. Nous avons vu les contrepoids quasi démocratiques qui existent chez les chimpanzés. Il y a des contrepoids moraux : quand un dominant frappe un plus petit que lui, les chimpanzés vont au secours du faible. C’est chez eux un instinct, comme chez les humains vraisemblablement. Un instinct moral de non-agression envers les faibles existe chez plusieurs espèces de primates. Il est fréquent par exemple qu’un chimpanzé adulte s’abstienne de frapper un jeune handicapé qui l’importune, alors qu’il frapperait un jeune normal. On a vu chez les macaques japonais une infirme être tolérée dans la bande pendant toute sa vie.
Chez les macaques rhésus on voit une forme d’organisation sociale à laquelle conduit l’absence de contrepoids à l’instinct de pouvoir. Il y a quasiment des classes sociales héréditaires, qui se constituent de la façon suivante. Les rhésus ont un instinct de solidarité au sein de la famille matrilinéaire, qui conduit à des rapports de domination entre les familles. Par ailleurs il y a un instinct de solidarité hiérarchique des dominants : contrairement à ce qui se passe chez les chimpanzés, quand un dominant a un conflit avec un dominé, ceux qui appartiennent à des familles plus élevées que le premier prennent son parti contre le second. En conséquence une famille, même si ses membres ont beaucoup de force physique individuellement, a peu de chances de monter dans la hiérarchie. (Toutefois, une coalition de guenons pour arrêter la violence d’un mâle a été observée chez des macaques en captivité). Le résultat ressemble au système des castes dans les sociétés humaines, l’idéologie en moins. Les familles en bas de la hiérarchie ont du mal à accéder à la nourriture. Si nous admettons que les humains ont, comme les chimpanzés, l’instinct de secourir les faibles, nous pouvons en conclure qu’une société humaine qui entretient l’inégalité ne peut fonctionner que si cet instinct moral est brisé par les nécessités de la survie, ou neutralisé par une idéologie inégalitaire, ou circonvenu par la distance géographique ou culturelle entre les différents groupes sociaux. Une morale de la solidarité est donc nécessaire pour contrer l’accumulation de pouvoir... mais elle a peu de force contre des inégalités reproduites par les rapports sociaux de production.
Nous avons vu plus haut qu’il y a chez les bonobos plus de contrepoids au pouvoir que chez les chimpanzés : inhibitions à la violence, notamment masculine, culture de l’amitié homosexuelle, de la séduction et de la réconciliation, solidarité féminine. Pourtant les bonobos sont très proches génétiquement des chimpanzés. Cela nous laisse espérer que les humains, qui sont juste un peu plus éloignés génétiquement de ces deux espèces, aient au moins autant de ressources instinctuelles pour contrer leur propre logique du pouvoir et de la violence.
Si l’on observe le comportement des humains, il semble qu’ils soient capables d’adopter des stratégies plutôt bonobo, mais qu’ils s’adonnent plus souvent à des stratégies plutôt chimpanzé.
Parlons maintenant de la relation entre l’agressivité et la sexualité dans la psychologie des primates.
La réconciliation par le sexe
Dans beaucoup d’espèces animales la sexualité ne sert pas seulement à la reproduction, mais également à donner du plaisir, et à créer un lien affectif qui permet la coopération, tout particulièrement la coopération dans les soins à la progéniture. Chez les primates la sexualité sert aussi à apaiser les conflits. Les singes, comme les humains, « se réconcilient sur l’oreiller ». En proposant un acte sexuel on crée un lien qui diminue l’agressivité, ou qui la réoriente vers le plaisir plutôt que vers la domination. Faites l’amour, pas la guerre : cette fonction sociale de la sexualité est très développée chez les bonobos, ce qui nous encourage à en faire de même chez les humains. Mais ce n’est pas si simple, car chez les humains la sexualité est beaucoup plus porteuse de conflit, et l’instinct de domination y est souvent présent.
Lien sexuel et jalousie
Sur cette question, commençons par observer ce qui se passe chez les chimpanzés. L’agressivité entre les mâles sert à conquérir un harem. Dans un groupe, le mâle dominant est celui qui a conquis un monopole sur les rapports sexuels avec les femelles, par la violence et l’intimidation, tant à l’égard des concurrents mâles que des guenons. Une partie de l’agressivité est donc liée à un instinct de jalousie possessive. Ce sont les rituels de soumission qui permettent l’apaisement de cette agressivité. L’harmonie de la vie sociale chez les chimpanzés est donc le résultat d’une combinaison d’agressivité et de soumission. Cette harmonie est toujours en équilibre instable. Il y a des conflits récurrents entre le mâle dominant jaloux et les autres mâles qui essaient d’approcher les guenons. Les guenons pratiquent volontiers l’adultère quand la surveillance du mâle dominant se relâche. Comme on l’a vu plus haut, une combinaison alternante de fidélité conjugale et d’adultère existe également chez les oiseaux monogames. C’est un exemple typique d’instincts opposés qui tous les deux sont utiles à la reproduction : d’un côté la stabilité conjugale est un facteur de paix dans le groupe ou la famille qui constitue un milieu nourricier et protecteur pour les petits, d’un autre côté l’adultère féminin accroît la probabilité de fécondation et la diversité de l’apport génétique, et l’adultère masculin accroît et diversifie la transmission des gènes du mâle. Chez les chimpanzés et chez les humains, ce double instinct est une source intarissable de conflits, et il est peu probable que se mettent en place des compromis paisibles entre ces deux instincts, du fait de la jalousie sexuelle, et du fait de l’instinct de domination. Parler d’un instinct de stabilité conjugale, c’est employer un concept-valise : cet instinct est probablement le résultat variable d’une combinaison entre plusieurs facteurs en partie hétérogènes : le désir de revivre en fantasme l’attachement du bébé à la mère, l’addiction sexuelle, le besoin de sécurité, la peur de l’inconnu, l’instinct de maternage qui même chez les chimpanzés n’est pas uniquement féminin, l’instinct d’appartenance à un groupe, enfin l’instinct de domination.
Ces exigences instinctuelles sont sans doute universelles.
Mais comme elles sont en partie hétérogènes on peut les satisfaire par des combinaisons diverses, notamment des régimes conjugaux polygamiques et monogamiques. Chaque société, avec son inventivité historique c’est-à-dire sa culture, et avec ses rapports de force, aménage des formes d’accomplissement diverses aux instincts.
L’exception confirme la règle. Voir le livre de l’ethnologue Cai Hua, Une Société sans père ni mari, les Na de Chine (Presses universitaires de France, collection ethnologies). Les Na, une minorité nationale du sud-ouest de la Chine, ne pratiquent pas le mariage et n’accordent aucune valeur sociale à la paternité. Mais leur régime familial et sexuel répond aux exigences instinctuelles auxquelles les autres sociétés répondent par le mariage.
Les Na vivent en familles matrilinéaires : les hommes restent toute leur vie avec leur mère, leurs sœurs et les enfants de leurs sœurs. Les rapports sexuels entre hommes et femmes des différentes familles se font par consentement mutuel qui reste du domaine privé. Chaque personne peut avoir une diversité de partenaires, il n’y a pas d’engagement à la fidélité, sauf temporaire. Seule est reconnue la filiation en ligne maternelle. Il n’y a aucun devoir mutuel ni sentiment entre les enfants et le père, qui souvent n’est pas connu. De fait ce sont les oncles (et les tantes et la grand-mère) qui jouent un rôle de père pour les enfants. Les fonctions de sécurité affective, économique et éducative remplies dans les autres sociétés par l’attachement conjugal sont remplies ici par la pérennité des liens familiaux matrilinéaires. Quand une famille manque de filles, elle en adopte une, ou si c’est impossible elle intègre une femme par mariage avec l’un des hommes. Le mariage est donc exceptionnel ; il n’était la norme que pour la famille royale, qui était patrilinéaire. Chez les Na l’attachement amoureux est mal vu : il est considéré comme une limitation à la liberté personnelle et comme un concurrent indésirable à l’attachement familial. La jalousie est rejetée comme un sentiment égoïste. Et pourtant l’amour romantique existe, comme dans toutes les sociétés : il arrive qu’un couple se déclare fidélité et s’isole de la société, mais c’est un comportement exceptionnel et contraire aux normes collectives. Le cas des Na montre l’universalité de l’amour, au sens d’un sentiment qui porte à l’attachement conjugal, puisqu’il existe même là où il est banni par la culture.
Le pouvoir des femmes dans la société Na est important. Il n’y a pas de domination masculine dans la famille. La prostitution est rare. La vie sociale est semble-t-il relativement non-violente, bien qu’il y ait des inégalités économiques. Ce qui n’empêche pas les Na de valoriser autant que d’autres le courage militaire chez les hommes.
La jalousie sexuelle est un instinct puissant chez les humains, et rares sont les sociétés qui comme les Na parviennent à désamorcer durablement son potentiel conflictuel. Les violences sexuelles sont fréquentes, presque toujours des hommes sur les femmes. Cette homologie avec les chimpanzés et les gorilles reste importante bien que les formes conjugales soient différentes : si la polygamie est fréquente chez les humains elle n’est pas le modèle unique. Heureusement, les humains préfèrent souvent exprimer leur jalousie par des mots plutôt que par des coups.
Il y a une spécificité de la sexualité humaine, comparée à celle des autres primates, c’est que l’acte sexuel a une plus grande intensité émotionnelle : il dure plus longtemps, se pratique plus souvent en face à face, et donne lieu à l’amour. Nous appelons amour avec un grand A un lien affectif intense fondé sur le désir sexuel (partiellement sublimé, parfois totalement). Ce sentiment ne semble pas jouer un rôle important chez les singes génétiquement les plus proches de l’homme. L’absence ou le peu d’importance de l’amour chez les chimpanzés, les bonobos et les gorilles est d’autant plus frappante que ces derniers manifestent d’autres sentiments habituels chez les humains : l’amitié, l’attachement entre la mère et l’enfant, entre frères et sœurs, et aussi quelque chose qui ressemble à la paternité : l’attachement entre un jeune et le partenaire sexuel de sa mère, ou son oncle, sa tante, sa grand-mère. L’amour n’est pas uniquement humain : Konrad Lorenz a décrit un comportement très analogue chez les oies et autres oiseaux qui vivent en couple pour s’occuper des œufs et des petits. Il est possible, mais j’ai peu de renseignements sur ces espèces, que l’amour existe aussi chez les quelques espèces de singes monogames comme les titis et les gibbons. Or il est clair que l’amour le plus souvent intensifie la jalousie possessive et donc la conflictualité. Utiliser la sexualité comme font les bonobos, c’est-à-dire comme un adjuvant hédoniste à la pacification quotidienne des rapports sociaux, ne serait peut-être pas une garantie contre la violence. La concorde sociale par l’érotisme ?... macache bonobo !
Cela dit, il existe chez les singes comme chez les humains des inhibitions à la jalousie. Quand un chimpanzé mâle est témoin d’un rapport sexuel entre une de ses guenons et un autre, il ne cherche pas toujours à chasser le rival : il peut aussi détourner les yeux et faire semblant de s’intéresser à autre chose. Ce comportement d’évitement est typique, il est souvent mis en œuvre par un dominant d’humeur pacifique, ou qui a des liens de camaraderie ou d’alliance politique avec son rival.
Chez les macaques tibétains, une espèce plus éloignée des humains, les liens de camaraderie sont plus importants, il y a peu d’agressions, et peu de jalousie sexuelle. De Waal suppose que ces dispositions débonnaires ont été sélectionnées par la nécessité de rester solidaires pour se défendre contre les grands félins prédateurs.
L’imaginaire phallocratique
Chez les humains, mais aussi chez les chimpanzés, si les rapports sexuels peuvent être égalitaires, ils restent fortement associés aux rapports de domination. Le modèle du rapport sexuel comme domination du mâle sur la femelle est très prégnant. D’ailleurs chez les chimpanzés le rituel de soumission-domination entre mâles comporte un simulacre de rapport sexuel : le dominé se laisse monter sur le dos par le dominant. Chez les humains le rôle sexuel masculin est aussi un symbole de domination : être courageux c’est « avoir des couilles » et être victime c’est « se faire baiser ». Le vocabulaire argotique des relations humaines dans les armées ne parle que de cela.
Par ses liens avec la sexualité, la domination, donc la violence, est ancrée dans l’affectivité des primates. C’est bien sûr une difficulté inévitable pour la non-violence.
En somme, les conflits liés à la sexualité sont pratiquement impossibles à éliminer. Cela dit, on peut les atténuer, et on sait les canaliser par des codes de bonne conduite et des normes juridiques. Et heureusement, cette cause de conflit, très importante dans les rapports sociaux de proximité, ne suffit pas par elle-même à créer des guerres de grande ampleur (sauf dans les sociétés de guerriers où les hommes faisaient la guerre pour ravir des femmes, comme nous le rappelle la légende de l’enlèvement des Sabines par la bande de Romulus et Rémus). Tout au plus sert-elle de prétexte, comme l’histoire d’Hélène pour la guerre de Troie. Étudier la relation entre l’agressivité et la sexualité chez les primates ne nous apprend pas grand-chose sur l’origine des guerres et leur prévention possible, mais plutôt sur la psychologie de la violence : les sociétés guerrières sont en général phallocratiques, et la guerre est toujours une occasion pour des viols impunis. De la guerre à l’esclavage, du système des castes au salariat, tous les rapports d’oppression s’accompagnent de violences sexuelles. Sur ce point les hommes ressemblent beaucoup aux chimpanzés et aux gorilles. Peut-on espérer qu’ils apprennent à socialiser leur sexualité comme le font les macaques tibétains ou les bonobos ? En ont-ils les capacités instinctuelles ? Au moins ont-ils les capacités culturelles pour intégrer dans leur vie sexuelle le respect des droits de personnes.
Éradiquer la violence ? Déconstruire les instincts ?
Vouloir supprimer les sources biologiques de l’agressivité (par des médicaments, de la chirurgie ou des manipulations génétiques) serait une entreprise probablement vouée à l’échec, et très dangereuse. Ce serait jouer les apprentis sorciers.
En revanche (si j’ose employer cette expression atavique !), il est possible par les méthodes de méditation, notamment bouddhistes, de défaire les habitus de violence par des moyens purement psychologiques et en toute autonomie de l’individu. Par la pratique de l’attention méthodique à son propre processus de pensée, on devient conscient de la façon dont se produisent nos désirs, par des enchaînements de prédispositions, sensations, souvenirs, fantasmes, réactions, renforcement ou modification des prédispositions, etc. Ces enchaînements mi-instinctifs mi-culturels, on peut s’entraîner à les décomposer. C’est ce que métaphorise l’idée de changer son karma. On peut notamment briser les cercles vicieux de l’agressivité et du désir de domination. On peut ainsi vivre les émotions autrement (et non moins intensément) que sur le mode des sentiments agressifs et du passage à l’acte violent. L’adoption de ces méthodes par la totalité de la population représenterait une grande avancée des capacités culturelles de l’humanité, et c’est un programme réalisable en quelques générations. Certes la méditation bouddhiste n’est pas un comportement spontané, elle nécessite beaucoup d’entraînement. Cela dit elle ne fait pas violence au fonctionnement naturel de l’être humain (autrement dit elle n’est pas mauvaise pour la santé physique et mentale). Faisons une comparaison : l’usage de l’écriture est maintenant en passe d’être adopté par la totalité de l’humanité, ce qui était impensable il y a quelques siècles, et a d’énormes conséquences psychologiques (entraînement à la réflexivité) et politiques (possibilité de débats politiques de masse sur de grandes échelles géographiques). Si la masse des gens ont pu adopter cette discipline parfois difficile, mais douce et libératrice, qu’est l’écriture, pourquoi n’adopteraient-ils pas la discipline de la méditation si elle était inscrite dans les programmes scolaires ? En attendant, et dans l’état actuel de la culture, la grande majorité des humains continueront à fonctionner le plus souvent avec une agressivité instinctive. Ce n’est pas une fatalité, mais c’est une forte probabilité biologique. En attendant de pouvoir défaire l’agressivité, la primatologie peut nous aider à la gérer et à la réorienter, en comprenant mieux comment elle fonctionne.
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Il n’existe pas de livre écrit directement par des singes.
Les ouvrages ci-dessous, souvent passionnants et pleins de rebondissements, peuvent être lus sans connaissances scientifiques spécialisées.
Le meilleur, à lire en premier :
![]() Frans DE WAAL, De la réconciliation chez les primates, Flammarion 2002.
Frans DE WAAL, De la réconciliation chez les primates, Flammarion 2002.
L’autre grand classique, souvent méconnu et calomnié :
![]() Konrad LORENZ, L’Agression, une histoire naturelle du mal, Flammarion 1977.
Konrad LORENZ, L’Agression, une histoire naturelle du mal, Flammarion 1977.
![]() Frans DE WAAL, Le Bon singe : les bases naturelles de la morale, Bayard 1997.
Frans DE WAAL, Le Bon singe : les bases naturelles de la morale, Bayard 1997.
Un remède contre le dogmatisme, au croisement de la psychanalyse, de la pharmacopsychiatrie, et de l’éthologie :
![]() Boris CYRULNIK, Mémoire de singe et paroles d’homme, Hachette 1983, 1998.
Boris CYRULNIK, Mémoire de singe et paroles d’homme, Hachette 1983, 1998.
Plein d’exemples inattendus :
![]() Frans DE WAAL, Quand les singes prennent le thé : de la culture animale, Fayard, 2001.
Frans DE WAAL, Quand les singes prennent le thé : de la culture animale, Fayard, 2001.
Un beau livre à offrir, avec des photos de Frans LANTING :
![]() Frans DE WAAL, Bonobos, le bonheur d’être singe, Fayard, 1999.
Frans DE WAAL, Bonobos, le bonheur d’être singe, Fayard, 1999.
Sur les rapports de pouvoir entre les sexes, une remarquable refondation du féminisme :
![]() Sarah BLAFFER HRDY, Les Instincts maternels, Éd. Payot, 2002, trad. de Mother Nature. A History of Mothers, Infants and Natural Selection, Pantheon books 1999.
Sarah BLAFFER HRDY, Les Instincts maternels, Éd. Payot, 2002, trad. de Mother Nature. A History of Mothers, Infants and Natural Selection, Pantheon books 1999.
Un livre que je n’ai pas lu :
![]() Richard WRANGHAM, Dale PETERSON, Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence, Boston, Hougton Mifflin, 1996.
Richard WRANGHAM, Dale PETERSON, Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence, Boston, Hougton Mifflin, 1996.
Sur la neurologie (peu de choses sur la primatologie), un peu difficile mais très rigoureux :
![]() Antonio R. DAMASIO, Le Sentiment même de soi, Éd. Odile Jacob, 1999, 2002.
Antonio R. DAMASIO, Le Sentiment même de soi, Éd. Odile Jacob, 1999, 2002.
Non primatologique, mais malheureusement indispensable (il existe probablement des ouvrages de synthèse comparables en français) :
![]() Frank CHALK, Kurt JONASSOHN, The History and Sociology of Genocide ; analyses and case studies, Yale University Press, 1990, en collaboration avec l’Institut Montréalais des Études sur le Génocide.
Frank CHALK, Kurt JONASSOHN, The History and Sociology of Genocide ; analyses and case studies, Yale University Press, 1990, en collaboration avec l’Institut Montréalais des Études sur le Génocide.
Arbre généalogique extrait de Frans DE WAAL
De la réconciliation chez les Primates, Flammarion 2002
Il y a environ 30 millions d’années, la lignée des primates de l’Ancien Monde s’est séparée en deux branches, les simiens et les anthropoïdes. Cette deuxième branche a donné naissance à l’ancêtre commun des hommes et des grands singes. On estime que la lignée humaine et la lignée des bonobos et des chimpanzés s’est divisée il y a 8 millions d’années. (Ce diagramme évolutionniste de Charles Sibley et Jon Ahlquist est fondé sur une comparaison de molécules d’ADN.)