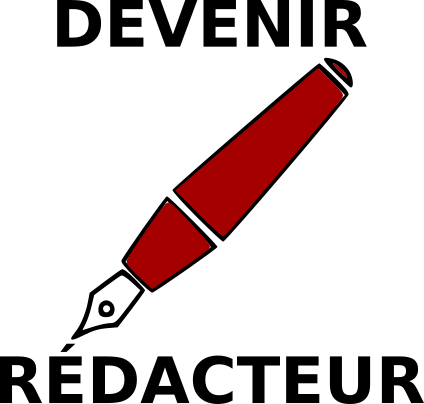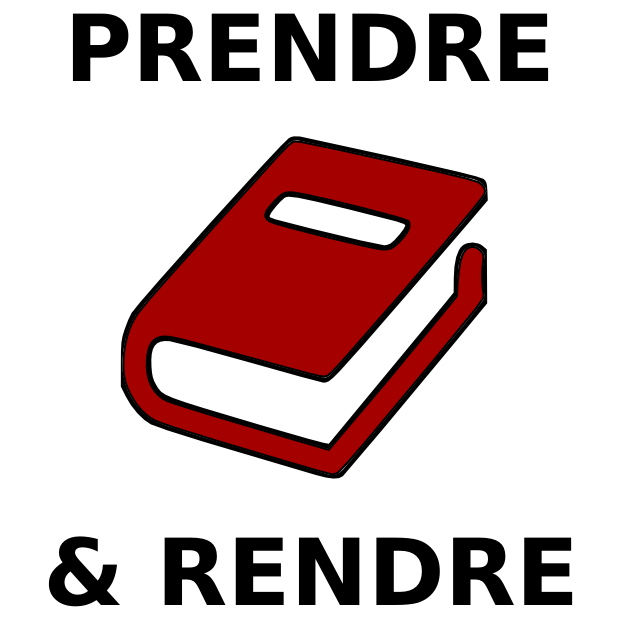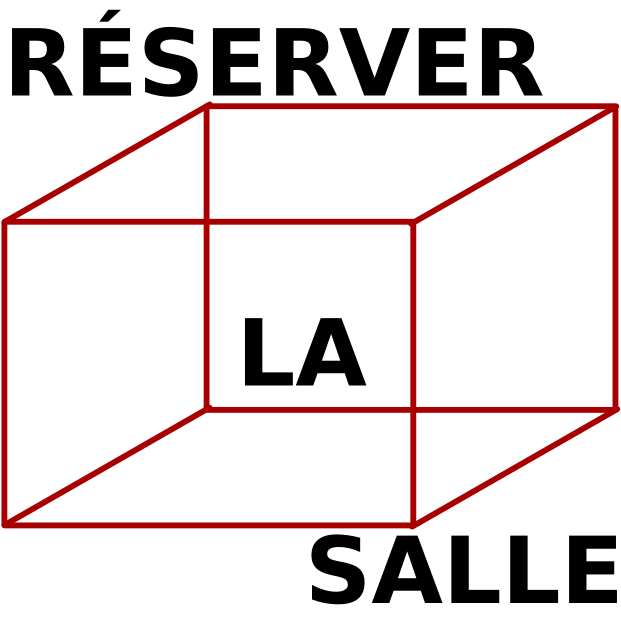Effet secondaire de l’examen en cours du projet de loi DADVSI (droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information), le ministre de la culture a divulgué le 9 mars les accords sectoriels conclus entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et les sociétés de gestion des droits dans les secteurs de la musique, de l’audiovisuel, de la presse, des arts visuels et de l’écrit (ADAMI, ADAGP, SACD, SACEM, PROCIREP, etc.). Alors que la directive européenne de 2001, que la loi française est censée adapter, recommandait l’application d’un fair use, ou usage équitable, inspiré des pratiques anglo-saxonnes, autrement dit une exception au droit d’auteur pour les usages d’enseignement et de recherche, le ministère de la culture a choisi d’imposer l’application d’un droit contractuel au sein des lycées et des facultés, qui transforme les contenus d’enseignement et de recherche en marchandises.
En pratique, chaque image, chaque extrait de film, chaque oeuvre musicale protégée utilisée dans les cours, examens, colloques, thèses, publications de recherche, etc., devra faire l’objet d’une demande, d’une déclaration, d’un paiement et d’un contrôle réglementaire assurant sa traçabilité. Les accords exigent notamment de limiter strictement la communication des oeuvres protégées aux seuls chercheurs et étudiants. Ils interdisent la projection d’oeuvres cinématographiques protégées dans leur entier. Ils limitent l’usage des films à ceux diffusés par voie hertzienne non payante, à l’exclusion des DVD ou VHS achetés dans le commerce par les enseignants. Ils interdisent de dépasser un quota de vingt images mises en ligne par cours ou travail de recherche, dans un format maximum de 400 pixels de côté. Ils interdisent pour les professeurs l’archivage, le classement dans des bases de données, l’indexation en ligne des contenus protégés, qui ne peuvent faire l’objet que d’un usage temporaire. Ils interdisent pour les élèves et les étudiants de copier ces contenus. Ils requièrent la communication des mots de passe des intranet et extranet scolaires et universitaires et confèrent aux représentant des sociétés de gestion le droit de vérifier le contenu des cours, communications, thèses, etc. Des limitations similaires sont énoncées pour l’usage des œuvres musicales ou de la presse.
Ces exigences sont tout à fait normales de la part des sociétés de gestion des droits dans un cadre commercial : ce sont les mêmes qui sont appliquées à la publication de photographies dans un magazine, à la diffusion de chansons par une radio ou de films par une chaîne de télévision. Elles se trouvent ici strictement transposées à l’univers académique, contre paiement en monnaie sonnante et trébuchante (les accords stipulent le versement de 4 millions d’euros à l’ensemble des sociétés de gestion pour les budgets 2007 et 2008), sans aucune adaptation à ses spécificités, ni aucune concertation avec ses acteurs. A une époque où les usages des contenus culturels dans l’enseignement comme leur analyse dans le cadre de la recherche connaît un heureux développement, n’importe quel professeur, n’importe quel chercheur aurait pu expliquer aux rédacteurs du ministère de la culture que ces dispositions sont simplement et strictement inapplicables. Mais elles sont aussi particulièrement dangeureuses. Outre qu’elles auront pour effet de freiner l’essor de ces domaines de recherche, au moment même où les cultural studies s’imposent largement dans le domaine anglo-saxon, elles vont aussi détourner les chercheurs et les enseignants des corpus français, au profit de sources notamment américaines, relevant par définition du fair use. Elles produiront une césure artificielle entre contenus libres de droits et contenus payants, en orientant les choix en fonction des ressources plutôt que des nécessités de l’analyse. Elles creuseront le fossé entre universités riches et universités pauvres. Elles ont enfin la caractéristique d’imposer le contrôle et la traçabilité des contenus d’enseignement et de recherche dans l’univers académique par des sociétés privées, ce qui place la France dans une situation unique parmi les pays développés.
L’usage des contenus audiovisuels requiert déjà suffisamment de travail et de soin de la part des professeurs et des étudiants, en supposant la maîtrise de technologies diverses, un accès compliqué aux sources, ou la disponibilité et le bon état de matériels de présentation, pour ne pas avoir besoin au surplus d’être criminalisé. Au contraire, cet usage a besoin d’être soutenu et protégé par des mesures propices et par l’application de l’exception pédagogique recommandée par la directive européenne du 22 mai 2001 et par la Conférence des présidents d’université (CPU).
A titre personnel, en tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, habitué à montrer plusieurs milliers d’images par an, je refuse :
![]() de limiter mes usages des images à quelque quota que ce soit, ou de remplir un formulaire de demande préalable chaque fois que j’aurai à analyser l’œuvre de Man Ray, Stieglitz, Moholy-Nagy, Rotdchenko, Kertesz, Gursky, Ruff, et tant d’autres.
de limiter mes usages des images à quelque quota que ce soit, ou de remplir un formulaire de demande préalable chaque fois que j’aurai à analyser l’œuvre de Man Ray, Stieglitz, Moholy-Nagy, Rotdchenko, Kertesz, Gursky, Ruff, et tant d’autres.
![]() En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse d’interdire l’accès à mes séminaires aux auditeurs libres.
En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse d’interdire l’accès à mes séminaires aux auditeurs libres.
![]() En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse d’employer les maigres subsides de la recherche publique à rémunérer de richissimes sociétés privées.
En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse d’employer les maigres subsides de la recherche publique à rémunérer de richissimes sociétés privées.
![]() En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse de trier au sein de l’iconographie utilisée pour mes recherches ou mes cours entre images libre de droits et images sous contrat, et à renoncer pour les secondes à l’archivage et au classement - ce qui interdit en pratique tout travail réel sur ces corpus.
En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse de trier au sein de l’iconographie utilisée pour mes recherches ou mes cours entre images libre de droits et images sous contrat, et à renoncer pour les secondes à l’archivage et au classement - ce qui interdit en pratique tout travail réel sur ces corpus.
![]() En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse avec la dernière énergie de voir mon cours, mon ordinateur ou mes abonnements internet contrôlés par des représentants de sociétés privées.
En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, je refuse avec la dernière énergie de voir mon cours, mon ordinateur ou mes abonnements internet contrôlés par des représentants de sociétés privées.
![]() En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, tant que ces accords seront appliqués, je recommande aux étudiants et chercheurs de renoncer à l’étude du patrimoine photographique français du XXe siècle, pour éviter de se trouver confrontés à d’inextricables difficultés dans la mise en œuvre de leur recherche comme dans sa valorisation. Je les encourage au contraire à se tourner vers des corpus libres de droits et vers les corpus américains, anglais, allemands, canadiens, etc., dont l’usage relève du fair use.
En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, tant que ces accords seront appliqués, je recommande aux étudiants et chercheurs de renoncer à l’étude du patrimoine photographique français du XXe siècle, pour éviter de se trouver confrontés à d’inextricables difficultés dans la mise en œuvre de leur recherche comme dans sa valorisation. Je les encourage au contraire à se tourner vers des corpus libres de droits et vers les corpus américains, anglais, allemands, canadiens, etc., dont l’usage relève du fair use.
![]() En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, j’encourage les chercheurs, enseignants et étudiants à militer de la façon qui leur semblera appropriée pour obtenir le retrait de ces accords et l’application de l’exception pédagogique, recommandée par la directive européenne du 22 mai 2001.
En tant que chercheur et enseignant en histoire visuelle, j’encourage les chercheurs, enseignants et étudiants à militer de la façon qui leur semblera appropriée pour obtenir le retrait de ces accords et l’application de l’exception pédagogique, recommandée par la directive européenne du 22 mai 2001.
Paris, 15 mars 2006
Lire la suite :
les études visuelles à la casse