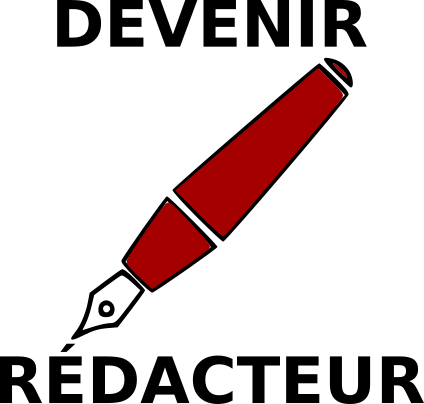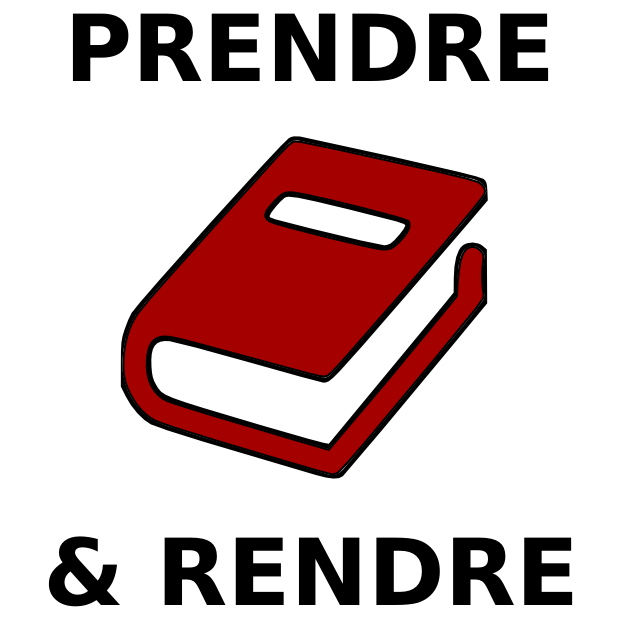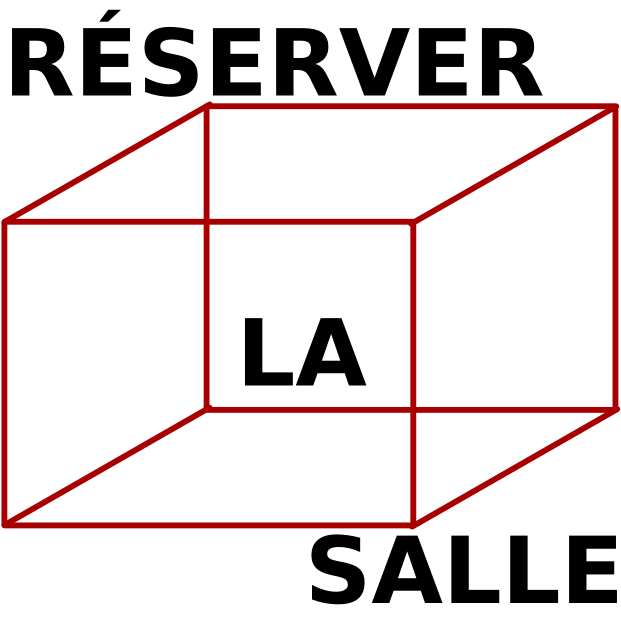Travail, mon ami, qu’est-ce qu’on a fait de toi !
Le travail, activité humaine par excellence, est supposé anoblir l’homme et participer à l’élaboration de son identité et à son insertion économique et sociale. Qu’en est-il aujourd’hui à l’heure de la mondialisa-tion libérale, de la concurrence exacerbée, de la marchandisation à tous crins, de la flexibilisation, de la précarisation, de l’intensification maximale du travail, de la déréglementation planifiée, du chômage de masse ? Autant de facteurs déterminants qui imposent leurs propres lois, en faisant peu de cas de la va-leur humaine inscrite en chacun de nous. Lois qui transforment le travail salarié actuel en travail aliéné, pollueur de corps et d’esprit, en travail assassin, destructeur de vie, de famille, de communauté, de soli-darité, créateur d’injustice, de mal-vivre, de dégâts, de gâchis humains. Comment a-t-on pu en arriver à un tel renversement, à une telle perversion de la fonction émancipatrice et formatrice de cette activité spécifiquement humaine ? Ceux qui arrivent à s’en faire une raison, invoquent-ils, peut-être, une fatalité, une punition divine : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ! » Il faudrait donc s’en faire une raison. « Cela à toujours était ainsi (ce qui est faux !) et sera toujours ainsi. » Moi qui - grâce à Dieu - ne suis pas croyant, cette explication ne me satisfait pas du tout ! J’ai beaucoup de mal à imaginer, qu’à son Niveau, Dieu puisse être aussi susceptible et rancunier. Tous ces malheurs pour une simple pomme ! Allons donc ! Mais alors, si tout cela n’est pas d’origine divine, ce ne serait donc que consécutif à l’action, à l’orgueil, à la cupidité, à la rapacité, à la soif de pouvoir, des Hommes ! Alors, l’Homme peut défaire ce que l’Homme a fait. Je préfère cette explication, non seulement parce qu’elle me paraît plus rationnelle, cartésienne et sensée mais surtout parce qu’elle permet de garder l’espoir et pousse à l’engagement plutôt qu’à la renonciation.
Oui, le travail peut-être une source de joie et d’épanouissement. J’aime à répéter qu’il est une mise en acte de la nature humaine qui englobe et restitue toute la complexité humaine. En ce sens, le travail est émancipateur, formateur, source de plaisir et de découverte, d’initiatives, de responsabilisation et de va-lorisation. K. MARX l’avait bien compris lorsqu’il écrivit que l’homme au travail « en même temps qu’il agit [...] sur la nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillent. » Mais, dans certaines situations et/ou conditions, il peut aussi se révéler, à l’origine d’un mal-être profond. Originellement, valeur ajoutée, l’activité humaine se dilue de plus en plus, dans l’anonymat au rythme des restructurations de société, des reprises successives, des choix stratégiques dévastateurs qui ne s’accompagnent d’aucune explication. Progressivement le travail, se retrouve vide de sens, pour les salariés. Et ceux-ci se trouvent exposés à toute sorte de dégâts du travail : Burn-out [1], harcèlement, injustice, non-reconnaissance, responsabilités croissantes et déstabilisantes, surcharge, violation du droit du travail, individualisation insupportable, effritement des solidarités et peur de perdre son d’emploi, stress et même sur-stress [2]... C’est pourquoi je parle de dégâts du travail, de fléau social et économique car au-delà des accidents et des maladies professionnelles, déclarées ou non - qui limitent la plupart des études sur ce sujet -, j’englobe toutes les autres altérations humaines qui découlent du travail et qui peuvent aller jusqu’au suicide. Et, le travail salarié, dans le contexte économique d’aujourd’hui, est loin d’être, dans la plupart des cas, une partie de plaisir et d’épanouissement.
Et c’est dommage et dommageable !
Le paradoxe à double entrée
Tout au long de mes quarante années professionnelles et syndicales, vécues au sein de l’industrie du Bâ-timent et des Travaux publics, j’ai été confronté aux dégâts des risques du travail. De ce fait, c’est pres-que tout naturellement, que mes activités universitaires, tant de recherches, d’études que d’enseignements, se sont centrées sur ce champ. À partir de cette expérience, diversifiée et ô combien complémentaire et mutuellement enrichissante, une situation paradoxale m’apparaît, dans l’espace de la prévention des risques professionnels. Ce paradoxe, est à double entrée et dans un premier temps, je le formule ainsi :
Dans les domaines du législatif, du réglementaire et de l’entreprise, nous constatons :
- Qu’un important et dynamique dispositif (règlements et structures) de prévention, est mis en place et fonctionne ; et ce depuis plus d’un siècle (loi du 8 avril 1898). Nous le montrerons dans notre deuxième chapitre.
- Qu’il existe un formidable consensus de l’ensemble des forces sociales en présence, pour limiter les « dégâts » du travail. Non seulement, aucune n’a intérêt à ce qu’il y ait des dégâts mais toutes ont intérêt à ce qu’il y en ait le moins possible. Précisons tout de suite, que c’est au niveau des résultats attendus que ce consensus existe, selon moi, mais pas assez au niveau des moyens, de toutes natures, à mettre en œuvre. Toutefois, cette affirmation est discutable et discutée. Elle de-mande donc des précisions que nous donnerons par la suite.
Chacune de ses prémisses devrait permettre une amélioration, alors pourquoi les deux ensembles n’y arrivent-elles pas ? Comment peut-on expliquer le manque d’efficacité constaté tant par les analyses que par les statistiques, voire une dégradation préoccupante dans de nombreux domaines ? Pourquoi toujours autant sinon plus : d’accidents, de maladies professionnelles reconnues ou non, de stress, de burn out, de vieillissement prématuré, de suicides, de cancers, de harcèlements, de violences, de maltraitances, de handicaps, avec leurs répercussions dramatiques sur les individus, la famille, l’entreprise, la société et l’économie. On ne peut rester insensible face à un tel gâchis et à tel fléau social ! Comment réagir ?
Là est la question ! Comment peut-on parvenir à ce que ces deux prémisses se conjuguent positivement et avec efficience ? Ce qui répondrait à une logique ! C’est l’objectif que se fixe cet ouvrage, en cours d’écriture.
Dans le cadre de ce texte-ci, je me limite à montrer l’ampleur de ces dégâts du travail et les conséquences économico-sociales de ces gâchis humains et sociaux. Par la suite, je vais m’efforcer, en mettant en dia-lectique de perspective et de complémentarité - dans le sens que le concevait Georges GURVITCH [3] - les obligations réglementaires actuelles en ce domaine et les avancées des sciences qui se préoccupent de l’Homme au travail et plus particulièrement de l’ergologie, pour apporter quelques pistes de solutions opérationnelles pour la maîtrise de ces dégâts du travail. En particulier en mettant en œuvre des « groupes de rencontres du travail », tel que le préconise l’ergologie.
Mais, qu’est-ce que l’ergologie ? Nous reviendrons, bien évidemment, en détail, sur cette démarche méthodologique innovante et féconde. Dans l’immédiat nous nous contenterons de dire que l’ergologie (qui signifie : étude de l’activité) est une approche pluridisciplinaire des situations de travail dont le but est de mieux connaître afin de mieux comprendre le travail en tant qu’activité humaine dans toute sa complexité. En effet, contrairement à une idée fausse mais largement répandue, le travail humain n’est pas quelque chose de simple ni même de simplifiable mais au contraire, il est complexe voire compliqué. Pourquoi ? Parce qu’il est toujours une rencontre singulière et jamais reproduite exactement à l’identique, entre :
![]() un objectif à atteindre (le travail stricto sensu) défini par des normes, des contraintes et des prescriptions parfaites connues et relativement stables,
un objectif à atteindre (le travail stricto sensu) défini par des normes, des contraintes et des prescriptions parfaites connues et relativement stables,
![]() avec une ou plusieurs personnes toujours singulières et qui évoluent dans l’espace et le temps,
avec une ou plusieurs personnes toujours singulières et qui évoluent dans l’espace et le temps,
![]() et un milieu toujours partiellement infidèle, incertain et instable.
et un milieu toujours partiellement infidèle, incertain et instable.
Le résultat de cette rencontre ne peut et ne pourra jamais être parfaitement maîtrisé par avance. Il y a, et il y aura toujours, un écart entre le travail tel qu’il a été prescrit et tel qui est, finalement, réalisé en prenant en compte ces variabilités combinatoires. Mais alors, comment prendre en considération cette infinie diversité combinatoire ? Pour ce faire, l’ergologie convoque, simultanément, toutes les disciplines scientifiques qui s’intéressent à l’Homme au travail : la philosophie, la psychologie, la sociologie, l’économie, l’ergonomie, la médecine, et bien d’autres. Et toutes ces disciplines scientifiques sont mises en dialectique, entre elles et aussi avec les savoirs investis dans l’expérience, par les acteurs eux-mêmes. Autrement dit, les savoirs constitués des disciplines scientifiques convoquent et sont convoqués par les savoirs investis, issus de l’expérience et de l’activité des acteurs, dans des « processus socratiques à double sens ». Ces deux formes de savoirs ont, pour les ergologues, même valeur et même importance. Et tout cela n’est pas simple à mettre en œuvre mais c’est à notre portée !
Toutefois, avant de nous intéresser aux solutions possibles - qui seront proposées dans les chapitres suivants de cet ouvrage -, ici, nous allons nous contenter de scruter ce fléau économique et social, pour appréhender son ampleur et nous convaincre de la nécessité et de l’urgence d’agir.
Quelques exemples significatifs de dégâts économiques et sociaux
Toulouse le 21 septembre 2001 [4]
À 10h17, un stock d’ammonitrate (engrais à base de nitrate d’ammonium) a explosé dans l’usine de ni-trate d’ammonium AZF (AZote Fertilisants), de Grande Paroisse, à Toulouse. Cette explosion a creusé un cratère de près de 30 mètres de diamètre et d’une dizaine de mètres de profondeur. Résultats : 30 morts, plus de 2 500 blessés graves et près de 8 000 blessés légers. Le site de l’usine est totalement dé-truit. Les alentours ont été soufflés à plusieurs centaines de mètres à la ronde. 2 500 Toulousains n’avaient plus de logement, tandis que 3 500 foyers étaient privés d’électricité et de gaz. Les dégâts ont été considérables à l’Est et au Sud de Toulouse. Le réseau national de surveillance sismique (ReNaSS) avait enregistré la secousse jusqu’à une distance de 500 km, avec une magnitude de 3,4 sur l’Échelle de Richter. Et pourtant, ce ne sont qu’environ 40 tonnes sur les 400 stockés, qui ont explosé.
Cette explosion a laissé des séquelles physiques et psychologiques durables, dans la population. Dix-huit mois après l’explosion, quelque 14 000 personnes étaient toujours sous traitement, pour pouvoir dormir, calmer leurs angoisses ou soigner une dépression. Cinq ans après la catastrophe, l’Institut de veille sanitaire (InVS) rendait publique, une étude soulignant « l’ampleur de l’impact sanitaire d’un tel accident sur la population, en termes de traumatismes physiques et psychiques, à moyen et long terme ». [5]
Comment une telle catastrophe industrielle, environnementale et sociale peut-elle survenir ?
L’usine de Grande Paroisse fabriquait des engrais azotés et plusieurs intermédiaires chimiques. Elle em-ployait 460 personnes. C’était une filiale à 80 % de ATOFINA, branche chimie du Groupe pétrolier To-talFinaElf. Le bâtiment 221, où l’explosion s’est produite, servait à entreposer différentes quantités de nitrate d’ammonium, déclassé et impropre à la commercialisation. D’où un certain désintérêt constaté, de la part de la direction de AZF, pour cet entrepôt. En fait, l’exploitation « du 221 » et tous les transferts et mouvements (entrant et sortants) des produits qui s’y trouvaient, étaient délégués à trois entreprises sous-traitantes, parmi les 25 qui intervenaient sur l’ensemble de ce site industriel.
À ce jour, les experts ne se sont toujours pas mis d’accord sur l’origine exacte de cette explosion, même si plusieurs hypothèses ont pu être avancées. Cependant, de nombreux dysfonctionnements ont été mis à jour par : la police judiciaire, le rapport d’enquête parlementaire, l’inspection du travail de la Haute-Garonne, l’expertise du CHSCT et les révélations de « La Dépêche du Midi ». À savoir et pour l’essentiel : risques industriels sous-estimés, mauvaise traçabilité des produits, conditions de stockages déficientes, non-conformité du bâtiment 221, sous-traitance trop importante, etc.. Autant de faits qui relèvent davantage de la banalité que de l’exceptionnel, dans le monde industriel d’aujourd’hui. De quoi nous donner froid dans le dos, non !
Tout cela, bien évidemment, est destiné à faire des économies. Au vu du résultat à Grande Paroisse, cela ne paraît pas évident. En effet :
![]() Le site industriel et ses alentours, dévastés, ont entièrement été rasés et sont en cours de dépollution ;
Le site industriel et ses alentours, dévastés, ont entièrement été rasés et sont en cours de dépollution ;
![]() Des informations judiciaires et des enquêtes administratives à n’en plus finir ;
Des informations judiciaires et des enquêtes administratives à n’en plus finir ;
![]() Des indemnisations lourdes, à verser (On estime globalement à 1,5 milliard d’euros, le coût de la catastrophe) ;
Des indemnisations lourdes, à verser (On estime globalement à 1,5 milliard d’euros, le coût de la catastrophe) ;
![]() La société Grande Paroisse et le directeur de l’usine, mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" ;
La société Grande Paroisse et le directeur de l’usine, mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" ;
![]() Une image de marque passablement entachée, comme c’est le cas, après chacune des catastrophes socio-économiques [6] et écologiques, sur terre ou sur mer, du groupe TotalFinaElf [7].
Une image de marque passablement entachée, comme c’est le cas, après chacune des catastrophes socio-économiques [6] et écologiques, sur terre ou sur mer, du groupe TotalFinaElf [7].
Finalement, c’est peut-être vrai que la prévention est un investissement avant d’être un coût ! Chez AZF, les responsables économiques devaient être diplômés-es « bouts-de-chandelles. »
Saint-Nazaire, le samedi 15 novembre 2003
À 14h22, sous le ciel pluvieux de Saint-Nazaire, une quarantaine de personnes monte à bord du Queen Mary 2, le luxueux paquebot géant, en phase de finition, aux Chantiers de l’Atlantique. Soudain, la pas-serelle cède, précipitant dans le vide les visiteurs. Les quelque quarante personnes présentes ont été en-traînées dans une chute de plus de quinze mètres et se sont écrasées au sol, sous les débris de la passe-relle. Le bilan de cet accident est très lourd. La société Alstom, propriétaire des chantiers, a annoncé la mort de 15 personnes. Près de trente autres ont été blessées, pour certaines, grièvement.
Cette passerelle, longue d’une dizaine de mètres, soutenue par des échafaudages, était pratiquement à l’horizontale. Elle avait été installée le vendredi 14, par une société sous-traitante spécialisée qui travail-lait depuis très longtemps pour la société Alstom. Cette passerelle avait été empruntée, par les ouvriers, dans la nuit de vendredi à samedi, puis le samedi matin. Elle était prévue, en principe, pour supporter des charges très lourdes.
Il s’agit d’un coup très dur pour les Chantiers de l’Atlantique et pour la ville de Saint-Nazaire qui vivait depuis de nombreuses années au rythme de la construction des navires. Jusqu’à ce samedi noir, le Queen Mary II, le plus grand et le plus luxueux paquebot du monde, était une source de prospérité et de fierté pour les habitants de la ville qui attendaient avec impatience la mise à l’eau définitive du bateau, au mois de décembre. Les festivités prévues à cette occasion ont été largement compromises car toutes les famil-les de Saint-Nazaire étaient touchées, de près ou de loin, par les conséquences de ce drame.
Le procureur de la République, a déclaré que « la chute de la passerelle était due à des causes techniques multiples ». Il a aussi confirmé qu’elle « avait été remplacée, vendredi, parce que la première ne corres-pondait pas au cahier des charges. Elle faisait 1,20 m de large au lieu du 1,40 m requis. Les Chantiers ont alors exigé l’application du marché. » Il a précisé que deux services avaient été saisis dans le cadre de cette enquête : Direction départementale de la sûreté publique et SRPJ. « Un expert commence à déter-miner les causes de cet accident, alors qu’un deuxième expert, adjoint au premier, a été désigné par le juge d’instruction. »
Toujours selon le procureur, « l’enquête porte sur le montage de la passerelle, mais aussi sur le fait de savoir si son usage était conforme à la destination qui en a été faite ». C’est-à-dire, comme un moyen d’accès au bateau, commun aux ouvriers et aux visiteurs.
Le 7 avril 2004, ce procureur de la République a requis la mise en examen pour « homicides et blessures involontaires les sociétés Endel et Chantiers de l’Atlantique, comme personnes morales ainsi que sept cadres de ces deux entreprises. » À ce jour, le procès n’a pas eu lieu.
Pour information et sans que cela soit lié directement avec cet accident (quoique...), Alstom a remercié, à moins de trois mois de la livraison du Queen Mary II, une de ses très nombreuses entreprises sous-traitantes du chantier de Saint-Nazaire. Il est vrai que dans cette entreprise, le droit du travail était igno-minieusement bafoué.
Officiellement, il s’agit pour les chantiers navals de Saint-Nazaire, de sanctionner des retards d’exécution du marché. Mais un porte-parole de Alstom a aussi invoqué les irrégularités so-ciales trop flagrantes, trop médiatisées aussi, rendant ce sous-traitant, de plus en plus indésirable. Comme dirait un Tartuffe actuel : « Cachez ce sous-traitant que je ne saurais voir ! »
Tout cela était de notoriété publique. Et pas seulement pour ce sous-traitant. Un film, réalisé par Marcel TRILLAT : « Les prolos. » a été diffusé sur France 2. Ce film, réalisé avec des caméras cachées, montrait entre autres, comment étaient traités et dans quelles conditions travaillaient, les salariés de ces sous-traitants, sur ce chantier naval de Saint-Nazaire. Les images et les commentaires étaient parfois insoute-nables. Il est difficile d’imaginer, tant qu’on ne l’a pas vu, que cette forme d’esclavage moderne puisse exister en France et au XXIe siècle. Un syndicaliste de l’union locale de St-Nazaire, déclarait [8] : « La précarité, la flexibilité et la déréglementation du droit du travail ont accompagné le développement de la sous-traitance. Un véritable laboratoire pour le Médef, dans un secteur où le travail s’attribue au moins disant social. »
Est-il nécessaire, dans ces conditions, de se poser beaucoup de questions au sujet de la prévention ?
Le téléphérique du Pic de Bure
Le 1er juillet 1999, 20 personnes prenaient place dans la cabine du téléphérique privé qui dessert l’observatoire du Pic de Bure (Hautes Alpes). Quelques minutes plus tard, la cabine et ses occupants (des techniciens et des ouvriers de l’observatoire et d’une entreprise régionale du BTP) qui allaient prendre leur service à 07H30, s’écrasaient 80 mètres plus bas, à la suite de la défaillance de l’attache assurant la liaison du chariot, supportant la cabine, au câble tracteur. Il n’y a pas eu de survivant.
Le tribunal correctionnel de Gap, au terme de treize jours d’audience, a condamné à des peines de 30 mois de prison avec sursis et à des amendes, trois des neuf prévenus poursuivis pour homicides involon-taires. Il s’agit du responsable de la maintenance du téléphérique, du responsable des contrôles de sécurité et du directeur de l’Observatoire du Pic de Bure, en poste au moment des faits. Cinq autres prévenus ont été relaxés.
L’expertise technique avait mis en lumière une succession de négligences. Une faute caractérisée avait été commise en prenant la décision, en 1985, de faire retirer le frein de chariot complémentaire du télé-phérique et de ne pas l’avoir remplacé par un autre système de sécurité. Ce frein avait été retiré treize ans avant l’accident. Il est donc difficile d’invoquer un manque de temps ! Un spécialiste a souligné au sujet de ce deuxième frein de secours : « Il était pourtant conçu pour sauver des vies. Le jour du drame, le cabinier, quelques secondes avant de mourir, aurait pu déclencher ce frein. Le véhicule aurait alors stoppé sans dommage, seulement avec quelques contusions pour les passagers. ». Le tribunal a, en outre, accordé aux 233 parties civiles, un cumul de 2 052 724 euros, pour préjudices moraux et 2 100 865 euros, pour les préjudices économiques et matériels. Deux autres personnes physiques ont été condamnées à de la prison avec sursis et à des amendes. Une amende de 200 000 euros a été infligée à la société d’exploitation de l’observatoire (IRAM).
Vu la relative clémence des peines, par rapport aux faits reprochés, aucun des prévenus condamnés, n’a fait appel. Et on les comprend !
En regard de tout cela, combien aurait pu coûter la réalisation et la mise en place d’un autre frein com-plémentaire ?
Les causes originelles des dégâts du travail
Nous pourrions encore citer beaucoup d’autres exemples, tout aussi accablants mais cela n’apporterait rien de plus à notre propos. Bien sûr, ce sont là, des exemples particulièrement dramatiques et exception-nels. Ils ont eu des répercussions qui ont largement débordé le cadre de l’entreprise. À tel point que certains pourraient se demander si c’est bien de ce type de dégâts que l’on parle, lorsqu’on s’interroge sur les risques du travail. Pour beaucoup, les risques du travail se limitent aux faits isolés et internes aux entreprises. Et pourtant, ces exemples - que l’on apparente plus à des catastrophes qu’à des risques du travail - si ce ne sont pas des résultats de risques du travail non maîtrisés, alors que sont-ils ? Ce ne sont pas les conséquences qui permettent de classer en risque du travail ou autre, mais les causes, les origines, les situations amonts.
Lorsqu’on analyse, a posteriori, les causes, les origines d’un processus fatal qui ont provoqué le dégât, quel qui soit (« catastrophe », AT, MP, stress, fatigue, rixe, etc.) nous rencontrons plusieurs niveaux :
- Le niveau immédiat ou de première analyse, proche du dégât causé. Il s’agit, presque toujours soit d’un facteur humain (on a fait, ou pas fait, quelque chose) soit d’une cause matérielle (produit, matériaux, outil, radiations, poussière, etc.).
- Des niveaux intermédiaires. Il s’agit des facteurs techniques rencontrés aux diverses étapes franchies, avant d’atteindre la fatale.
- Le niveau profond ou l’origine du processus enclenché. Il s’agit alors, invariablement d’un facteur organisationnel, d’une situation de travail mal maîtrisée, d’un danger ignoré ou négligé.
Malheureusement, la majorité des enquêtes s’arrêtent au premier niveau ou à un niveau intermédiaire proche, rarement au niveau originel. Cela peut s’expliquer :
- Le but de ces enquêtes, c’est souvent de déterminer une responsabilité. Il y a eu atteinte à une ou plusieurs personnes et/ou à des biens, il faut donc un coupable/responsable. On ne saurait être contre ! Et on y arrive assez vite et pour les assureurs, c’est suffisant. Mais cela ne l’est pas toujours pour améliorer la prévention. Ce sont sur les causes originelles qu’il faut intervenir, sinon, cela se reproduira, c’est évident ! Peut-être, le processus changera, puisqu’il se déroulera dans des situations/conditions différentes mais pas le résultat.
- Les causes profondes et originelles ne sont pas toujours accessibles aux enquêteurs, quels qui soient. Beaucoup d’éléments importants ont disparu. Les ergonomes les appellent : les facteurs volatiles. Exemples : Quel bruit, quel événement, etc., a perturbé le déroulement normal de la tâ-che ? Que regardait l’auteur du fait ? Est-ce que les témoignages recueillis sont fiables et suffi-sants ? etc..
Pour une prévention efficace, c’est presque toujours au niveau organisationnel qu’il faut agir.
Les causes soi-disant « économiques »
Mais pour trouver cette faille organisationnelle originelle, il ne faut pas s’arrêter un premier niveau d’analyse. Voici une petite anecdote, plutôt amusante et banale, pour illustrer cela. Elle fait partie de l’assortiment des « petites histoires » succulentes et ô combien explicites que mon ami Jacques DURAFFOURG, grand ergonome devant l’Éternel - s’ils en aient - narre pour imager et valider ses interventions et enseignements.
Appelé dans une entreprise pour aider la direction à comprendre et résoudre des problèmes récurrents de TMS, il aperçoit une ouvrière arc-boutée sur sa perceuse et en train de forcer durement pour agir. Il lui demande pourquoi elle se positionne ainsi ? La réponse fuse avec un brin de colère dans la voix ; « Depuis qu’on a ces nouvelles vis, elles ne tiennent pas et il faut forcer comme un âne, sinon c’est pas possible ! » Renseignement pris, en effet, l’employé chargé des achats, avait été démarché par un fournisseur concurrent et avait acheté ces nouvelles vis parce qu’elles étaient bien moins chères. De son poste, il ne pouvait apprécier les qualités mécaniques réelles de ces vis, sauf au travers ce que lui en a dit le futur fournisseur. Et selon celui-ci, elles étaient, bien évidemment, meilleures que celles de son concurrent. Alors pourquoi s’en priver ! Bien entendu, lorsque J. Duraffourg lui a demandé s’il s’était renseigné au-près de celles qui devaient s’en servir, il a ouvert de grands yeux ébahis, en se demandant comment on pouvait poser des questions aussi sottes. Si, à chaque fois, il devait le faire, mais il ne pourrait plus travailler ! M’enfin ! C’est évident !
Conclusion : Sans cette intervention rapide mais perspicace de l’ergonome, on aurait continué à faire suivre à ces ouvrières, des stages de gestes et postures - comme cela se fait toujours, dans ces cas-là - pour leur apprendre, malgré leur ancienneté et leur expérience, comment il faut s’y prendre pour percer. C’est ce que l’on aurait conclu en se contentant d’observer le geste et la position dangereuse de ses ouvrières. C’est-à-dire, en arrêtant l’analyse au premier niveau. En persistant et en remontant un peu la chaîne de l’arbre des causes - mais pas trop tout de même, on n’a pas que ça à faire dans une entreprise ! - on aurait pu en déduire une certaine immaturité et entêtement de ces ouvrières bornées qui ne com-prennent pas que quand on leur dit de se tenir autrement, c’est pour leur bien ! En fait, en allant jusqu’au bout, on voit que la vraie cause est d’origine économique, brevetée, ici aussi, « bouts-de-chandelles » car l’économie réalisée avec l’achat de ces nouvelles vis était loin, très loin, de compenser les dépenses ma-ladies et arrêts de travail. Et encore, on ne se préoccupe pas, ici, des conséquences humaines.
Je comprends et j’admets que certains puissent estimer que ce genre d’anecdotes est d’une banalité affligeante et ne mérite pas cette publicité. À ceux-là, il me serait facile de leur rétorquer que ce genre d’exemple est certainement simple, mais seulement une fois la réponse trouvée. Un peu comme le fil à couper le beurre ou l’œuf de C. COLOMB. Mais elles sont pléthores dans les entreprises et leurs incidences sont très loin d’être négligeables. N’importe quel intervenant pourrait en témoigner et apporter son lot d’anecdotes personnelles de même tonneau. Souvent, ce n’est pas plus compliqué que cela, mais les conséquences, elles, peuvent être bien pires.
Mais revenons à nos exemples extrêmes ci-dessus et voyons si là aussi, il s’agit bien, à chaque fois, et en dernière analyse, d’une prévention prise à défaut ou inadaptée voire carrément, inexistante puisque jugée inutile, dans cette situation de travail.
La direction de Grande Paroisse, répète à l’envi, y compris aujourd’hui, que « dans des conditions normales, le nitrate d’ammonium ne peut pas exploser de lui-même. » C’est théoriquement impossible. (Ah boooon ! Comme quoi, il ne faut vraiment pas se fier aux apparences, hein !) [9] Alors, pourquoi prendre des précautions sur le « B 221 » ! L’inspecteur du travail a constaté qu’aucune identification des dangers ainsi qu’aucune évaluation des risques, n’avaient été réalisées. Pourtant, depuis la loi du 31/12/91, c’est-à-dire depuis 10 années, cela était obligatoire ; même s’il n’était encore obligatoire de le transcrire dans « le document unique. » Mais, puisque selon la direction, il n’y avait aucun risque, pourquoi perdre du temps avec toutes ses obligations tracassières et administratives inutiles et qui plus est, finissent par revenir chers ! Lors de cette évaluation des risques, le collectif concerné se serait aperçu de l’état de délabrement et de non-conformité tous azimuts, du B 221. Il aurait certainement souligné, comme un risque, la non-compétence des salariés sous-traitants, dans le domaine de la chimie et de ses risques d’explosion, lors de certaines proximités de produits. C’est à ce niveau que se situent les origines de cette explosion. Les experts, et c’est leur rôle, cherchent à montrer comment cela a pu exploser. La bonne question n’est-elle pas : Pourquoi cela a pu exploser ? Et ce pourquoi, ne faut-il pas le chercher dans l’organisation du travail, au sein de ce B 221 ?
Concernant le téléphérique du Pic de Bure, le deuxième frein de chariot qui devait agir en cas de rupture du premier, avait été enlevé parce qu’à l’usage, celui-ci s’avérait plus problématique que sécurisant. Concernant les téléphériques recevant du public, la réglementation est très claire : Il faut deux freins de chariot. Mais concernant les téléphériques à usage privé, la loi, sur ce sujet, est interprétable. Alors, pourquoi s’embêter à en concevoir un autre ? « Un frein, c’est bien suffisant, non ! » L’avenir leur prou-va que non !
Dans un tout autre registre, selon, le constructeur, l’architecte naval et bien sûr l’armateur, le Titanic, réputé insubmersible, ne pouvait pas couler. C’était une évidence, clamée haut et fort et relayée par tous les médias de l’époque. Le commandant du bord y croyait aussi « dur comme fer. » De ce fait et selon les enquêtes réalisées depuis, il avait bien d’autres choses à faire de plus important, à ses yeux, qu’à se pré-occuper des icebergs. En autres choses, il consacrait beaucoup de temps à satisfaire les passagers de première classe. À tel point, que le radio du bord, devait donner la priorité aux communications privées des passagers. De ce fait, il « ‘oublia’ de transmettre plusieurs messages signalant la présence d’icebergs, sur la route empruntée par le Titanic. » Selon les analyses réalisées, la catastrophe n’a pas été simplement causée par une défaillance du bateau ou par une erreur de pilotage. Plusieurs éléments simultanés ont causé la perte du navire : Le navire virait trop lentement ; La négligence de l’opérateur radio, mobilisé pour les messages privés des passagers ; La mer était trop calme pour permettre de voir l’iceberg assez tôt. Il aurait donc fallu renforcer la surveillance ; Les vigies n’avaient pas de jumelles (seuls, les officiers en possédaient) ; Le navire filait trop vite (20 nœuds). Tout cela renvoie bien à des situations et/ou des conditions de travail, non ! « Il semble maintenant confirmé que le capitaine SMITH avait trop confiance dans son bateau. » [10]
Comme nous venons de le voir, dans le domaine de la prévention, il faut, surtout, s’intéresser aux causes, aux origines, aux facteurs déclenchant. Il est bien évident que leurs conséquences sont et doivent être, également, évaluées. Mais comme M. de LAPALISSE aurait pu le dire, un quart d’heure avant sa mort : si l’on maîtrise bien les causes, il n’y aura pas de conséquence !
Que l’on évoque le Titanic, Tchernobyl ou un « simple » (Avez-vous remarqué les guillemets ?) AT mortel ou non, un suicide, un cancer ou une entorse, etc., c’est toujours, en dernière analyse, une situation de travail qui est en cause. Et ceci est vérifié quels que soient leurs impacts, leurs intérêts médiati-ques et médiatisés, quel que soit le nombre de leurs victimes, leur coût, etc...
Parmi les grandes causes originelles des dégâts du travail, nous rencontrons la nature du statut salarial.
La précarité, la flexibilité et la sous-traitance : des dangers identifiés.
L’évolution des formes d’emploi précaires - trop souvent soutenues et encouragées par des mesures gouvernementales - associé à une intensification du travail et à des cumuls de risques plutôt réservés aux salariés avec ces statuts fragiles, a créé les conditions d’une dangerosité accrue du travail. La peur du licenciement et la souffrance au travail sont deux composantes importantes du rapport au travail, de ces salariés.
Voici une anecdote pour illustrer cette affirmation.
J’ai été appelé dans un centre de vacances, à Megève, pour une formation à la sécurité des salariés chargés de l’entretien et de la maintenance. En tant qu’ergologue, je suis convaincu qu’on ne peut parler du travail, uniquement dans une salle de cours. Il était donc prévu des séances de formation sur les lieux du travail. Ceci me paraît absolument indispensable si l’on veut s’extirper, se désembourber de la seule approche du travail tel qu’il a été prescrit et apercevoir les écarts et comprendre les transgressions effec-tuées. Et partant de là, concevoir des mesures préventives adaptées à la réalité de ce travail. Ce sont dans ces écarts que se nichent la plupart des risques. _ Pour deux raisons au moins :
La première, parce que dans le travail prescrit, le risque, s’il existe, est maîtrisé par les concepteurs. Au-trement dit, si tout se passe comme prévu, il ne peut y avoir de risque. Enfin, en principe !
La deuxième, parce que l’écart est inanticipable, par définition. La seule chose dont on peut être sûr, à l’expérience et à l’observation, c’est qu’il y aura un écart, aussi minime soit-il, entre le travail tel qu’il a été prescrit et tel qu’il se réalisera in fine. C’est dans la nature, depuis toujours, du travail humain. L’ergonomie l’a constaté et l’ergologie l’a érigé en un concept ontogénique. Je reviendrai, plus en détail, par la suite, sur ce sujet d’une extrême importance. Donc, si cet écart - imprévisible dans sa nature mais certain quant à sa survenue - ne peut être pas maîtrisé par les concepteurs et que les moyens de le faire ne sont, de ce fait, pas prévus, la seule manière de le maîtriser, c’est avec « les moyens du bord » et la professionnalité de l’exécutant. Ce qui se passe très bien dans l’énorme majorité des cas. Et c’est heureux et personne n’y trouve à redire. Mais quand cela ne se passe pas bien, alors là, haro sur le baudet, et tous « Les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés » (cf. : G. Brassens) de se demander : « Mais pourquoi n’a-t-il pas fait comme prévu ? » La réponse est simple : parce que ce n’était pas possible ou, tout au moins, pas judicieux de réaliser ainsi cette tâche, compte tenu des circonstances rencontrées « ici et maintenant ». D’où l’importance, comme l’exige la réglementation actuelle, de concevoir la prévention à partir du travail réel et non seulement du travail prescrit.
Mais revenons à notre anecdote. Lors d’une de ces séances, il était question d’élaguer un arbre. Cet arbre se trouvait au sommet d’une pente très raide, d’une dizaine de mètres et qui se terminait sur une route ou des voitures circulaient dans les deux sens. J’écoutais les explications que me donnaient les salariés concernant tout ce qu’il fallait faire avant et pendant l’exécution de cette tâche, banale pour eux. Je leur pose la question : « Est-ce que ce travail vous l’exécutez tout seul ? Parce que, une main pour la tronçonneuse et l’autre pour vous tenir, si vous glissez ou si la branche à laquelle vous vous tenez casse, vous dégringolez jusque sur la route, avec la tronçonneuse en marche et en bas les voitures, bonjour les dégâts ! » Un ouvrier me répondit aussi sec : « Moi, pas question. Je vais demander, au directeur, que quelqu’un m’assure. C’est trop dangereux ! » Un autre répliqua : « Moi, je ferme ma gueule et je fais le boulot. Comme je suis saisonnier, je sais très bien que si je vais dire cela au directeur, je vais passer pour un pénible et l’année prochaine, je ne serai pas rappelé. »
Conclusion : Le danger était bien perçu, mais sa maîtrise dépendait du statut salarial.
Et si ce saisonnier avait réalisé ce travail et qu’il lui soit arrivé l’accident évoqué, nous aurions, très certainement entendu « tous les gens bien intentionnés » s’exclamer : « Mais pourquoi, bon sang, n’a-t-il demandé que quelqu’un vienne l’assurer ? » Et, ils en auront certainement conclu que ce salarié n’était pas conscient du danger, sinon il aurait demandé de l’aide. Il faut les comprendre, s’ils n’arrivent pas à se donner bonne conscience, cela devient invivable.
Face à ce danger reconnu et validé par les statistiques, que constatons-nous : que le statut salarial précaire tend de plus en plus à devenir la norme, alors que les CDI deviennent, presque l’exception.
« La précarité de l’emploi ne cesse de se développer en France comme dans d’autres pays européens ; l’on entend par précarité l’ensemble des formes atypiques d’emploi, essentiellement les contrats à durée déterminée et l’intérim, mais également les contrats de qualification et d’adaptation, et même les formes d’emploi n’assurant pas un revenu égal au SMIC, à savoir principalement les CDI à temps partiel subi.
En dix ans, le nombre d’emplois en intérim a connu une croissance de 160 % et celui des CDD une aug-mentation de 60 %, alors que le nombre de CDI n’augmentait que de 2 %. Les contrats à durée détermi-née représentaient 6,28 % des emplois salariés, en 2000, et leur taux de progression annuel, depuis 1995, est de 6 à 7 %. L’emploi à temps partiel représente aujourd’hui 18 % des emplois contre 8 % au début des années 70. » [11] Et depuis, cela c’est plutôt aggravé.
La précarité du travail
Quand on évoque la précarité et sa dangerosité, confirmée par les statistiques, on pense évidemment à la précarité de l’emploi. C’est évident ! Cependant, la précarité du travail ne doit pas être, pour autant, négligé. Et je pense en particulier aux salariés de la sous-traitance, toujours obligés « de travailler chez les autres », comme ils disent, eux-mêmes [12]. Toujours contraints de s’adapter à des situations, à des environnements et des collectifs changeants, rarement accueillants et même souvent hostiles. Même lorsqu’ils constatent une situation problématique, ils ne peuvent rien changer « puisqu’on n’est pas chez nous. » C‘est certainement ce que devaient se dire les sous-traitants du B221, de Grande Paroisse, qui voyaient bien l’état de délabrement de ce hangar. Mais que pouvaient-ils y faire ?
Exploser avec, c’est tout ! Et c’est ce qui s’est réellement passé.
L’AMPLEUR DE CE FLÉAU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Pour bien comprendre un objet de préoccupation afin de pouvoir tenter de l’améliorer, il faut, d’abord, bien le connaître. Que représentent, globalement, les dégâts du travail, en France ? Nous aborderons cette question à partir de trois entrées :
![]() L’aspect financier ;
L’aspect financier ;
![]() L’aspect humain et social ;
L’aspect humain et social ;
![]() L’aspect judiciaire.
L’aspect judiciaire.
L’aspect financier des dégâts du travail
Nous débutons par cet aspect, non parce qu’il nous apparaît comme le plus important des trois mais parce qu’il semble être le plus controversé. Combien de fois, n’avons-nous pas entendu dire : « La prévention ça n’a pas de prix mais elle a un coût ! » Ou bien, la même chose mais dite différemment : « Il faut choisir : soit être performant et concurrentiel ou bien faire de la prévention ! » Nous voudrions, ci-après, convaincre que la prévention intelligente et efficace non seulement « c’est pas trop cher, c’est pas forcément difficile mais ça peut rapporter gros. »
Les exemples extrêmes de dégâts du travail, développés ci-dessus, apportent déjà une première réponse. Mais, sans vouloir se faire peur en évoquant seulement de tels extrêmes, voyons d’abord ce que coûtent les dégâts du travail « banals » (Eh oh ! Je ne vais pas vous faire remarquer les guillemets à chaque fois !) afin de mesurer ce qu’une prévention efficace peut faire économiser, à l’entreprise et à la nation. Ce qui, par contre coup, retournera pour une part non négligeable, à l’entreprise. Une entreprise ne vit que mieux dans une économie assainie, dans une paix sociale et où l’argent circule plus aisément.
De qui parle-t-on exactement ?
Les démonstrations qui suivent, se rapportent uniquement aux salariés assujettis à la Sécurité sociale. C’est-à-dire, à l’assureur solidaire de quatre personnes sur cinq, en France. Il ne s’agira donc que d’environ 80 % des dépenses de santé totale. Gardons cela toujours en mémoire.
Pour information, les autres régimes sont :
![]() Le régime agricole : Il couvre les exploitants et les salariés agricoles. Il est géré par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (M.S.A.).
Le régime agricole : Il couvre les exploitants et les salariés agricoles. Il est géré par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (M.S.A.).
![]() Le régime social des indépendants : Il couvre les artisans, commerçants, industriels et professions libérales. Il est géré par différents organismes, notamment la Caisse nationale d’Assurance maladie des professions indépendantes.
Le régime social des indépendants : Il couvre les artisans, commerçants, industriels et professions libérales. Il est géré par différents organismes, notamment la Caisse nationale d’Assurance maladie des professions indépendantes.
![]() Les autres régimes dits « spéciaux » : Régimes : des marins et inscrits maritimes (ENIM) ; des Mines ; de la SNCF ; de la RATP ; d’EDF. - GDF ; de la Banque de France ; de l’Assemblée nationale ; du Sénat ; des clercs et employés de notaire ; des ministres du culte ; etc..
Les autres régimes dits « spéciaux » : Régimes : des marins et inscrits maritimes (ENIM) ; des Mines ; de la SNCF ; de la RATP ; d’EDF. - GDF ; de la Banque de France ; de l’Assemblée nationale ; du Sénat ; des clercs et employés de notaire ; des ministres du culte ; etc..
Gâchis financiers et dégâts collatéraux
J’utilise le terme « collatéraux » parce que ça fait mode, plus exactement ça fait in. Et puis cela m’évite d’avoir recours au cliché éculé de l’iceberg. Bien que, finalement, la parabole de l’iceberg soit très idoine. Mais bon, faut vivre avec son époque, non !
En 2004, les accidents du travail et maladies professionnelles, relevant de la seule Caisse Nationale d’Assurance Maladie - Travailleurs salariés (CNAM-TS), ont entraîné :
![]() Le versement de 6 719 millions d’euros aux victimes ;
Le versement de 6 719 millions d’euros aux victimes ;
![]() La perte d’environ 48 millions de journées de travail (ce qui équivaut à la fermeture d’une entreprise de plus de 130 000 salariés, pendant 1 an).
La perte d’environ 48 millions de journées de travail (ce qui équivaut à la fermeture d’une entreprise de plus de 130 000 salariés, pendant 1 an).
Pas mal, non !
Et encore, il ne s’agit que là que de 80 % de la totalité !
Et encore, il ne s’agit là que de ce qu’on appelle : les coûts directs. C’est-à-dire, l’intégralité du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles (indemnités journalières, frais médicaux et hos-pitaliers, rentes...) qui est supportée, par les entreprises, via les cotisations de sécurité sociale. Pour avoir les coûts réels, qui incombent à l’entreprise, il faut y ajouter les coûts « collatéraux », entre autres :
![]() Le temps passé pour secourir la victime.
Le temps passé pour secourir la victime.
![]() Le temps passé pour les formalités (enquêtes, déclarations, aspects juridiques, etc.).
Le temps passé pour les formalités (enquêtes, déclarations, aspects juridiques, etc.).
![]() La perturbation du personnel avec baisse de la productivité et de la qualité voire grève de protestation et/ou de soutien.
La perturbation du personnel avec baisse de la productivité et de la qualité voire grève de protestation et/ou de soutien.
![]() Le recours à du personnel d’appoint, pour remplacer les accidentés.
Le recours à du personnel d’appoint, pour remplacer les accidentés.
![]() La casse de matériels.
La casse de matériels.
![]() Les délais de production allongés, voire l’arrêt de la production.
Les délais de production allongés, voire l’arrêt de la production.
![]() La dégradation de l’image de l’entreprise.
La dégradation de l’image de l’entreprise.
![]() Etc..
Etc..
Toutes les études consacrées à cet aspect financier, s’accordent pour reconnaître que les coûts réels représentent entre trois et quatre fois les coûts directs, suivant les circonstances de l’accident et des corps de métier concernés. Ne peut-on faire sérieusement l’hypothèse qu’une meilleure connaissance des coûts réels, pourrait amener les gestionnaires à réaliser, chiffres à l’appui, que ces dégâts coûtent encore plus cher qu’ils ne le croient ? Ce qui les inciterait peut-être, à rechercher comment réduire ces gâchis, en investissant et surtout, en s’investissant, dans la prévention.
Et encore, encore, il ne s’agit là que des AT déclarés et des MP reconnues. C’est-à-dire que si l’on veut mesurer le coût total des dégâts du travail supporté par la nation, il faut ajouter, à ce coût - déjà bien corsé - toutes les maladies ayant une origine professionnelle mais non reconnues par la Sécurité sociale, et tout les AT non déclarés. [13] Ce coût est supporté par le régime général de la Sécurité sociale, c’est-à-dire, par : Les salariés, les entreprises et les contribuables via la CSG. C’est-à-dire : par nous ! En effet, les cotisations dites « patronales » ne sont qu’un salaire différé, un salaire social, qui sera répercuté sur les prix. Je n’ai jamais très bien compris ce qu’il y avait de « patronal » dans ces cotisations. À part le fait que ce soit l’employeur qui est chargé de les verser. La belle affaire !
Ces transferts de charge, d’une caisse SS à l’autre, creuse d’autant le fameux « trou abyssal » du régime général qu’on ne sait comment combler. Imaginons ce que permettrait d’économiser nationalement, par une prévention mieux appliquée et surtout plus efficace, ne serait-ce qu’une amélioration de 10 % de ces sommes faramineuses ! Et surtout, ce qu’on pourrait en faire ! Et nous ne sommes toujours que sur le plan financier de ses dégâts !
Ça vaut le coup d’essayer, non ! Certains y pensent ! Mais à leurs façons. C’est-à-dire en essayant de tricher. La preuve ci-dessous.
La non-déclaration des AT et MP
Le Journal l’Humanité, du 11 août 2005, sous la signature de Yves HOUSSON [14], commentait un rapport d’une commission officielle, non publié, remis au ministre de la Sécurité sociale, mais dont ce journal avait pu se procurer un exemplaire. Selon ce document, désormais, chaque année depuis 1996, le Parlement impose à la branche AT-MP, un reversement à la branche maladie, au titre des maladies et accidents non déclarés. Son montant est fixé sur la base du rapport d’une commission, nommée par le gouvernement, présidée par un magistrat de la Cour des comptes et chargée de faire le point régulièrement, sur l’évolution du problème. « Il semble qu’au minimum un cas de cancer professionnel sur deux, chez les hommes, ne soit pas reconnu. » Au lieu des 1 466 cas admis en 2002, cette affection aurait ainsi fait entre « 3 400 et 6 800 » victimes, parmi les assurés du régime général. Beaucoup plus même, si l’on prend en compte l’ensemble des cancérogènes avérés en milieu de travail, et non seulement ceux qui sont répertoriés dans les tableaux de la branche AT-MP : Un cancer professionnel sur sept seulement, serait reconnu.
Sous-déclaration massive également (50 %) pour les troubles musculo-squelettiques (TMS). S’agissant des troubles psychosociaux, totalement absents des affections du travail reconnues, le rapport fait état d’une étude chiffrant entre 220 500 et 335 000, le nombre de personnes touchées par une pathologie (maladie cardio-vasculaire, dépression, TMS...) « liée au stress professionnel. » La non-prise en compte de ce problème a, avertit le rapport, « des incidences graves » : Elle « favorise les insuffisances de diagnostic sur les origines des troubles psychiques, par là même, l’inadaptation des soins, la surconsommation de psychotropes et, in fine, la chronicisation de la maladie ». Selon l’estimation de l’INVS, il y aurait de 5 % à 10 % de cancers d’origine professionnelle, sur un total annuel de 280 000 cancers. Soit de 14 000 à 28 000 cas, au lieu des quelque 1 500 reconnus. Le coût moyen du traitement de cette pathologie est de 250 000 euros. Ça fait réfléchir, non !
Dans la même veine mais dans un autre journal, sur le site Internet de Libération, du 15 janvier 2007, dans un article signé : F. PONS, nous lisons [15] :
« Pour faire baisser les statistiques des accidents et des maladies professionnelles, d’ici à 2009, Gérard LARCHER, le ministre délégué à l’Emploi, a présenté en février 2005, son plan santé au travail (PST). [...] Le plus préoccupant, aux yeux des syndicats, réside dans la « sous-déclaration » [16] des accidents professionnels par les employeurs. Accusant les caisses régionales d’assurance maladie de se livrer à ce petit jeu, la CFDT estime que « tout est fait par les patrons, pour que les accidents du travail ne soient pas déclarés. C’est un véritable parcours du combattant, pour le salarié, pour les faire reconnaître, alors que leur nombre et leur taux de gravité augmentent ». Même son de cloche à la CGT : « La baisse des acci-dents du travail déclarés vient de la pression directe sur les salariés, mais aussi de la stratégie de contesta-tion systématique, par les employeurs, des accidents déclarés aux caisses d’assurance maladie. »
En tout cas, après avoir atteint l’équilibre en 2006, la branche « accidents du travail » du budget de la Sécu, devrait terminer cette année avec un excédent de 100 millions d’euros. »
Et pour cause ! Concernant seulement l’amiante, Maître TEISSONNIÈRE, avocat des victimes de l’amiante, déclarait, lors de son audition par la commission d’enquête de l’Assemblé nationale [17], consacrée au drame de l’amiante - que cette commission qualifiait de « crime sociétal » : « ... Nous sommes le pays dans lequel la catastrophe de l’amiante a coûté le moins cher à ses responsables, la sécurité sociale ayant finalement servi d’amortisseur. »
Ajoutons, pour enfoncer un peu plus le clou, qu’en mars 2003, le rapport IMBERTON de l’INVS : « santé et travail » [18] , estimait que :
- 5 à 10 % des cancers, soit environ 20 000 par an, seraient d’origine professionnelle ;
- Au moins un million de salariés sont exposés à des substances reconnues cancérogènes, quatre millions à d’autres toxiques variés et non encore évalués, pour leurs risques ;
- La sous-déclaration et la sous-estimation de ces cas, serait énorme. Par exemple, sur environ mille nouveaux cas annuels de cancers de la vessie d’origine professionnelle possible, seulement seize (moins de 2 %) seront reconnus.
Par ailleurs, ce rapport confirme que la mortalité ouvrière prématurée entre 25 et 54 ans, est trois fois plus élevée que chez les cadres, mais une infime partie de ces décès pourtant, est reconnue conséquence du travail.
Quelques éléments significatifs et explicatifs de ce gâchis.
Voici quelques matières à réflexion qui apportent de l’eau à notre moulin et qui renforcent l’idée que la prévention est plus un investissement qu’un coût.
Coûts moyens « directs » supportés par les entreprises, en 2004.
Source de données : Cram Rhône-Alpes, Prévention des Risques Professionnels
Coût moyen d’un accident du travail reconnu :
- AT avec arrêt 3 760 €
- AT avec incapacité Permanente 42 000 €
- AT mortel 704 200 €
Au total, en 2004, la branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM-TS) a indemnisé 1,4 millions accidents du travail. Parmi ces accidents près de 700 000 ont donné lieu à un arrêt de travail et 626 furent mortels, auxquels il convient d’ajouter les 607 AT mortels de trajets/déplacements (en 2004) Et encore, on ne parle pas des suicides réussis ou non. Nous le verrons plus loin.
Nota : Rappelons que pour connaître les coûts réels, il faut multiplier ces sommes par 3 ou 4.
![]() Le risque routier.
Le risque routier.
Les accidents mortels du travail de la circulation ont lieu lors de l’utilisation de véhicules très divers (voitures, camions, engins de travail, avions,...), soit en trajet-travail soit à l’occasion du travail. En 2005 [19], 28,5 % des accidents mortels du travail se sont produits sur la route (134 AT mortels). Si l’on ajoute les 389 AT mortels trajet/travail, ce pourcentage atteint 57 % du total des AT mortels du travail. Ce risque du travail routier, souvent sous-estimé, voire ignoré, est un risque qui s’apparente, à tort, dans la perception courante, à la sphère du privé et non à celle du travail. Il est, la plupart du temps, perçu comme relevant de la fatalité ou de la maladresse et de la négligence du conducteur. Or, il est un risque professionnel, au même titre que les autres, pour lesquels, les conditions de travail pèsent pour beaucoup (organisation des déplacements, état des véhicules, fatigue, urgence, retards, stress, etc.). Le risque du travail routier, véritable enjeu économique, social et humain, est un efficace révélateur des dysfonctionnements de l’entreprise, qui induit des coûts directs et indirects. Selon INRS, le traitement de ce risque dans l’entreprise passe par la déclinaison de quatre managements : management des déplacements, des véhicules, des communications mobiles (téléphones portables) et enfin celui des compétences. (Voir : « Les risques routiers en mission » un guide de l’INRS.)
En 2005, 76 860 accidents routiers du travail recensés, au sein du seul régime général de la Sécurité so-ciale, ont donné lieu à un arrêt de travail et 523 furent mortels.
Coût moyen d’une maladie professionnelle reconnue :
- Affections dues à l’amiante 257 700 €
- Surdité professionnelle 121 000 €
- Troubles musculo-squelettiques 33 480 €
- Tous tableaux confondus 57 700 €
L’amiante : ce crime sociétal.
Le coût d’une MP due à l’amiante est 8 fois celui d’un trouble musculo-squelettique.
Cette fibre minérale est un puissant cancérogène qui est déjà responsable de 35 000 décès survenus entre 1965 et 1995, en France, et qui tuera 60 000 à 100 000 personnes dans les 25 ans à venir, d’après le rapport du Sénat, du 26 octobre 2005. Rappelons que ce rapport soutien que 90 % de ces cancers sont d’origine professionnelle.
Rien qu’en Europe de l’Ouest, les experts de l’U E ont calculé que les cancers causés par l’amiante seront à l’origine d’environ 500 000 décès, au cours des trente premières années du XXI è siècle.
L’amiante est interdit depuis seulement 1997, en France. Mais il en reste des millions de tonnes dissémi-nées dans les usines, les écoles, les universités (Jussieu, entre autres), les immeubles et même sur le Clemenceau que l’on n’a pas réussi à envoyer empoisonner les Indous. Des maladies souvent graves frappe-ront longtemps encore ceux qui ont respiré ces fibres assassines.
Le coût annuel de l’indemnisation de l’ensemble des pathologies liées à l’amiante (hors dispositif de cessation anticipée d’activité) serait compris entre 584 millions et 1,1 milliard d’euros, par an, en moyenne et le coût total sur vingt ans, compris entre 11,7 et 22 milliards d’euros. L’essentiel de l’écart entre les hypothèses basse et haute s’explique par les écarts dans les prévisions épidémiologiques qui sont particulièrement importantes pour les cancers broncho-pulmonaires.
Mais il n’y a pas que l’amiante comme danger cancérogène. En 2003, en France, 2 370 000 personnes, soit 13,5 % des salariés sont exposés à des produits cancérogènes. Le nombre de cancers de la vessie imputables annuellement à une exposition professionnelle, chez les hommes, est estimé à plusieurs cen-taines (600 à 1 000). Et là encore, les estimations obtenues montrent toujours une nette sous indemnisa-tion des cancers d’origine professionnelle.
Le stress : ce mal moderne.
28% des salariés européens déclarent « souffrir » de stress lié au travail (Source Fondation de Dublin 1995 et 2000). En Europe, le stress serait à l’origine de : 30% des arrêt de travail et 50% à 60% de l’ensemble des journées de travail perdues et coûterait, aux États membres, au moins 20 milliards d’euros, chaque année.
En France : 47% des salariés déclarent éprouver Qu’est-ce que cela représentait comme coût, en 2000 ?souvent du stress au travail (source Liaisons Sociales).
« ...sur une population active de 23,53 millions de personnes, 220 500 à 335 000 personnes (1 % à 1,4 %) sont touchées par une pathologie liée au stress professionnel. Selon les hypothèses posées (basses ou hautes), le coût social du stress au travail est compris entre 830 et 1 656 millions d’euros, ce qui équi-vaut à 10 à 20 % des dépenses de la branche Accidents du travail / Maladies professionnelles, de la Sécurité sociale. » [20]
Et c’est pas tout !
Notons, enfin et pour information que d’autres calamités dont les origines professionnelles sont souvent majoritaires ou tout au moins très rarement étrangères, telles que les surdités (5 millions de sourds, en France) et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou BPCO qui frappe entre 5 et 10 % de la population adulte des pays industrialisés. En France, le nombre de malades se situe entre 2,5 et 4,5 millions de personnes, mais le diagnostic n’est connu que chez 1/3 environ de ces malades. Pourtant, le nombre de décès par BPCO, dans l’hexagone, excède largement celui des accidents de la route : 16 000 par an. Et le nombre de personnes souffrant d’une insuffisance respiratoire chronique, responsable d’un handicap majeur et nécessitant de recevoir de l’oxygène en permanence au domicile, s’élève à 60 000 [21] .
Et encore, en France, nous ne sommes pas les plus mal lotis, paraît-il. La situation mondiale, concernant ces dégâts du travail s’apparente à une pandémie, peut-être pire que le sida.
La situation dans le monde
Sur le plan mondial, la situation est des plus préoccupante. Il est vrai, que sur le plan international, en ce moment, on peut se demander qu’est-ce qui va vers le mieux !
Pour une population active de 2,7 milliards, il y aurait d’avoué et par an [22] :
- Accidents du travail : 270 millions (10 %).
- Décès : 2,2 millions dont 1,7 millions de maladies professionnelles.
- Maladies professionnelles : 160 millions (dont 10 rien que pour l’U E).
- Coût annuel : 1 250 milliards de $, soit 4 % du PIB mondial.
Pour le BIT et l’OMS, les éléments dont on dispose montrent qu’un peu partout dans le monde, des centaines de millions de personnes travaillent dans des conditions d’insécurité qui conduisent à des problèmes de santé.
Pour information, en 1992, les coûts directs et indirects, associés aux traumatismes et maladies liés au travail, aux États-Unis d’Amérique, ont été estimés au total à US $ 171 milliards, c’est-à-dire plus que ceux du SIDA et autant que ceux du cancer et des cardiopathies. En 1994, on a estimé le coût global, pour l’économie britannique, de tous les accidents du travail et problèmes de santé liés à l’activité professionnelle, entre 6 et 12 milliards de livres sterling. [23]
Des chiffres ci-dessus, nous constatons que :
- Le risque de maladie professionnelle serait aujourd’hui le plus grand danger mortel auquel seraient exposés les travailleurs sur leur lieu de travail (1,7 millions de décès, par an.) Ce qui donne un rapport de quatre décès causés par une maladie professionnelle pour un décès causé par un accident. Ces 160 millions de nouveaux cas annuels, avoués, de maladies liées au travail, dans le monde, sont, notamment : des maladies respiratoires et cardio-vasculaires, des cancers, des atteintes auditives, des atteintes ostéo-articulaires et musculaires, des troubles de la reproduction et des maladies mentales et neurologiques.
- Le coût des maladies et traumatismes professionnels est énorme. 4 % du PNB mondial.
Peut-on continuer encore longtemps, dans cette voie ?
Conclusion sur cet aspect financier
Si après tous ces exemples, tous ces chiffres (un peu trop, peut-être ! Mais qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour essayer de vous convaincre !) vous n’êtes toujours pas convaincus de l’immense gâchis financier que les dégâts du travail représentent, tant pour la nation que pour l’entreprise, il est inutile d’insister. On n’y arrivera pas ! Mission impossible !
Cependant, après une telle énumération, si on a une vision, hélas ! plus réaliste sur ce fléau, des questions méritent d’être posées.
![]() Pourquoi dérouter une partie des coûts des dégâts du travail, logiquement à la charge des entreprises, vers le régime général ? Bonjour le « trou » ! Ne serait-il préférable et plus socialement compréhensible - si on le voulait bien - de développer, enfin, sérieusement la prévention, pour réduire ces coûts et ces gâchis tant financiers qu’humains ? Pourquoi ne le fait-on pas ? Quels sont les arguments invoqués ? Financiers, peut-être ? Mais pour qui ? D’autant que, cette déresponsabilisation financière du patronat, ne les motive pas du tout, en faveur d’un effort de prévention. Au contraire ! Alors que l’inverse, y contribuerait certainement. Les drames humains et sociaux qui en découlent, seraient-ils négligeables, aux yeux des décideurs ?
Pourquoi dérouter une partie des coûts des dégâts du travail, logiquement à la charge des entreprises, vers le régime général ? Bonjour le « trou » ! Ne serait-il préférable et plus socialement compréhensible - si on le voulait bien - de développer, enfin, sérieusement la prévention, pour réduire ces coûts et ces gâchis tant financiers qu’humains ? Pourquoi ne le fait-on pas ? Quels sont les arguments invoqués ? Financiers, peut-être ? Mais pour qui ? D’autant que, cette déresponsabilisation financière du patronat, ne les motive pas du tout, en faveur d’un effort de prévention. Au contraire ! Alors que l’inverse, y contribuerait certainement. Les drames humains et sociaux qui en découlent, seraient-ils négligeables, aux yeux des décideurs ?
![]() Dans le système économique actuel, peut-on espérer que les dirigeants d’entreprise puissent avoir une vision éclairée et citoyenne du rôle et de la fonction d’une entreprise ? Peuvent-ils comprendre et admettre que leur entreprise n’est pas une île déserte, isolée de son environnement ; qu’au contraire, elle ne peut qu’être dépendante du contexte économique environnant. Et qu’être un bon gestionnaire, cela consiste à se préoccuper, aussi, des répercussions de sa gestion, sur l’économie nationale et la paix sociale, d’avoir un minimum de souci du bien commun ? Confronter comme ils le sont, à la logique et à la concurrence capitaliste (appelons un chat, un chat !) Peuvent-ils agir différemment ? Si la réponse est non, alors quitte à consterner un peu plus, les tenants d’un libéralisme partisan « du moins d’État possible », c’est aux instances étatiques, aux syndicats (patronaux et ouvriers) et à la société civile de s’en charger ?
Dans le système économique actuel, peut-on espérer que les dirigeants d’entreprise puissent avoir une vision éclairée et citoyenne du rôle et de la fonction d’une entreprise ? Peuvent-ils comprendre et admettre que leur entreprise n’est pas une île déserte, isolée de son environnement ; qu’au contraire, elle ne peut qu’être dépendante du contexte économique environnant. Et qu’être un bon gestionnaire, cela consiste à se préoccuper, aussi, des répercussions de sa gestion, sur l’économie nationale et la paix sociale, d’avoir un minimum de souci du bien commun ? Confronter comme ils le sont, à la logique et à la concurrence capitaliste (appelons un chat, un chat !) Peuvent-ils agir différemment ? Si la réponse est non, alors quitte à consterner un peu plus, les tenants d’un libéralisme partisan « du moins d’État possible », c’est aux instances étatiques, aux syndicats (patronaux et ouvriers) et à la société civile de s’en charger ?
![]() Pourrait-on, enfin, clouer le bec avec suffisamment de persuasion, à tous ceux qui, fidèles à l’apostrophe coluchienne : « chacun sa merde ! », se posent encore la question, déjà citée ci-dessus : « Il faut choisir : Soit être performant et concurrentiel ou bien faire de la prévention ! » ? Pourtant, tant que les responsables d’entreprise se poseront ce genre de question, ils se persuaderont, concurrence oblige mais aussi leur confort idéologique et culturel, que le meilleur choix pour l’avenir de l’entreprise, c’est : « Être performant et concurrentiel. »
Pourrait-on, enfin, clouer le bec avec suffisamment de persuasion, à tous ceux qui, fidèles à l’apostrophe coluchienne : « chacun sa merde ! », se posent encore la question, déjà citée ci-dessus : « Il faut choisir : Soit être performant et concurrentiel ou bien faire de la prévention ! » ? Pourtant, tant que les responsables d’entreprise se poseront ce genre de question, ils se persuaderont, concurrence oblige mais aussi leur confort idéologique et culturel, que le meilleur choix pour l’avenir de l’entreprise, c’est : « Être performant et concurrentiel. »
Comme l’on fait, entre autres, les dirigeants de AZF. C.Q.F.D. !
L’aspect social et humain des dégâts du travail
Il est bien évident que cet aspect apparaît, traverse et transpire par tous les pores du paragraphe précédent. Faut-il vraiment le développer ? Comment pourrait-on admettre que tous ces gâchis financiers n’entraînent pas des gâchis, des drames, des malheurs, dans les corps et dans les vies de toutes ses victimes et de leur entourage ? Derrière toutes ces statistiques froides et impersonnelles, derrière tous ces chiffres alignés, il n’y a pas que de la comptabilité ; il y a des êtres humains, des familles, des commu-nautés parentèles et amicales. Et personne ne peut en rester indifférent ! Et d’ailleurs, personne n’en reste indifférent.
Nonobstant ce qui précède, je souhaite tout de même aborder deux thèmes qui se rapportent à cet aspect social et humain et qui illustre bien les répercussions sociales de ce fléau économico-social :
- Les suicides liés au travail ;
- Les impacts émotionnels que soulèvent les dégâts du travail.
Les suicides liés au travail
La bataille pour l’emploi.
À la télévision, France 3 a diffusé, en novembre 2005, un téléfilm de Maurice FAILLEVIC, intitulé : « Jusqu’au bout » inspiré du conflit salarial Cellatex. Ce téléfilm, a été réalisé à partir du livre : « Cellatex, quand l’acide a coulé. » (Éditions Syllepses), 2001), qui est le récit de cette grève, écrit par le secrétaire, à l’époque, du syndicat CGT du textile, Christian LAROSE, un des principaux participants. Tourné sur place avec des anciens protagonistes du conflit comme acteurs, ce téléfilm, selon de nombreux témoignages, retrace très bien la réalité de ce qu’ont vraiment vécu ces salariés.
En quoi ce conflit peut-il motiver un téléfilm ? En juillet 2000, les 153 salariés de la Cellatex, une filature de rayonne, dans le quartier de la Soie, à Givet (Ardennes), viennent d’apprendre la liquidation judiciaire de leur entreprise et que leur dernier patron a « filé » sans laisser d’adresse. En désespoir, ils sonnent le tocsin, menacent de faire sauter leur usine classée Seveso et de déverser de l’acide dans la Meuse. Ils alertent les pouvoirs publics et l’opinion pour tenter de toucher, au moins, des compensations financières, assurés qu’ils sont, pour la plupart, de ne pas pouvoir retrouver un emploi dans cette région ardennaise particulièrement déshéritée. Pour attirer l’attention et comme ils ont compris comment fonctionnent les médias, ils n’hésitent pas à menacer d’utiliser le stock de 46 tonnes de sulfure de carbone, hautement détonnant, qui se trouvent dans l’usine. 900 personnes (leurs parents, leurs voisins et amis) ont été évacuées, en raison des menaces d’explosion qui pesaient sur le site de Cellatex. Ainsi, durant plusieurs semaines d’été, en plein Tour de France, ils font la une des JT, à l’heure des retours de plage. L’impact médiatique fut payant. Ils eurent une bonne part de leurs revendications de satisfaites. Cependant, ce conflit salarial qui dura quatre années, fut très dur ; il laissa des traces profondes chez tous les protagonistes : couples et familles disloqués, des relations de voisinage et d’amitiés mises à mal ; son bilan humain, au-delà des compensations salariales obtenues, fut dramatique : Une quarantaine de tentatives de suicide, sans même parler des dépressions nerveuses, des conduites alcooliques verbalisées, des rixes et le suicide d’une jeune femme.
Conflits sociaux et relations au travail sont souvent cités comme facteurs de risque de la crise suicidaire. À tous les échelons, le stress fait des dégâts. La privation d’emploi, devenue monnaie courante, plonge l’individu dans le désarroi, l’isolement, tandis quelle lui ôte toute chance de surmonter cette épreuve, faute d’une reconversion programmée. Toxicomanies, alcoolisme, accès de violence, tentatives de suicide, signent alors la souffrance de ces individus dépossédés, humiliés qui après avoir perdu le contrôle de leur situation, perdent celui de leurs nerfs et trop souvent, de leur vie.
Les suicides en France
Les médias évoquent, ces derniers temps, trois suicides en quelques mois, sur leur lieu de travail, chez Renault Guyancourt [24], dans les Yvelines. Ce qui a amené 500 ouvriers, à participer à une marche silencieuse. À l’arsenal de Toulon, une étude a été commandée, à un cabinet spécialisé, à la suite d’un suicide et d’une tentative, qui ne seraient pas totalement étranger du passage au privé, de cette entreprise nationalisée, avec un management plus dur. À la centrale nucléaire de Chinon, le suicide d’un quatrième agent de l’EDF, en moins de trois ans, suscite des interrogations. Pourquoi et comment en arrive-t-on à de tels extrêmes, à tant de colère, à tant de désespoir ?
« Bernard avait perdu son emploi et passait ses journées dehors. Son chômage, il n’avait pas été capable d’en parler à ses enfants. "Trop douloureux", disait-il. Lorsque ses beaux-parents ont commencé à aider financièrement sa femme, ce fut le moment de crise. Une seule idée devenait envahissante : celle de se suicider. Bernard est venu consulter au Centre Popincourt, à Paris. "D’avoir pu dire les choses lui a permis ensuite d’en parler à sa famille", raconte Vincent LAPIERRE, l’un des psychologues de ce centre thérapeutique spécialisé dans la lutte contre l’isolement et la prévention du suicide.
Des hommes et des femmes cassés par le chômage, cette structure en reçoit régulièrement depuis la mise en place d’un partenariat avec l’ANPE. "Les conseillers de l’agence nous adressent des personnes en recherche d’emploi lorsqu’ils ont le sentiment qu’elles vont très mal", explique M. LAPIERRE. Elles sont suivies pendant six mois.
Selon les derniers chiffres de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 10 798 personnes se sont tuées, en France, en 2004 (dont 6 248 âgées de 30 à 59 ans) et près de 150 000 ont tenté de le faire. Si le suicide a diminué de 36 % depuis 1993, chez les 15-24 ans et de 18 % chez les plus de 60 ans, il continue d’augmenter parmi les 30-59 ans (+ 6 % depuis 2001) et touche surtout les hommes. » [25]
Et encore, tous les suicides, pour de nombreuses et diverses raisons, ne sont pas répertoriés en tant que tel (religion, assurance, le « qu’en-dira-t-on », etc.). Malgré ce, depuis près de 15 ans, il y a plus de décès par suicide avoué que par accident de la circulation.
Concernant les 150 000 tentatives de suicide, il s’agit là d’une estimation minimale, dans la mesure où les tentatives de suicide ne sont pas systématiquement recensées et où un certain nombre d’entre elles ne font pas l’objet d’une hospitalisation. 80 % d’entre elles se font par intoxication médicamenteuse, mais on retrouve aussi des moyens violents et radicaux : pendaison, arme à feu, saut depuis un lieu élevé, passage sous un train, etc...
Selon l’INED [26] , il n’y a pas de lien de cause à effet, vraiment établi, entre la plupart des suicides et/ou tentatives et les conditions de travail et/ou de non-travail (chômage, licenciements, mise à pied, etc.). Cependant, certaines études ont établi qu’à chaque fois que le taux de chômage augmente de 1 %, on constate une hausse des suicides de 4 à 5 % (source AES). Certaines victimes de licenciement, plus attachées parfois à leurs collègues de travail qu’à leur famille, réagissent par la colère : détresse psychique, violence, acte de vandalisme, incendie provoqué, séquestration, tendance suicidaire ponctuent alors leur descente aux enfers, dominée par l’absence de toute perspective possible. Face à un avenir professionnel assombri, la famille et le couple ne peuvent pas toujours jouer leur fonction de rempart. Le suicide devient alors l’ultime étape d’une spirale de la dégradation, de la dépréciation et de la dépersonnalisation.
Suicides et travail et suicides au travail.
Lorsqu’on analyse un suicide ou une tentative, on ne rencontre pas que des facteurs liés aux conditions de travail. Mais aussi : Deuil, surendettement, divorce, détérioration de l’environnement familial, maladie, nature de l’orientation sexuelle (homophobie), solitude, tendances suicidaires héréditaires, etc.. Cependant, la vie au travail et les situations de chômage, ne sont jamais totalement étrangères à l’aggravation de ces facteurs. « On perçoit bien que : humiliations plus impuissance plus manque de perspective plus absence de dialogue et d’interlocuteur, le tout sur fond de manque de qualification : ce cumul fabrique un cocktail détonant. » [27] Tous ces facteurs de vie privée et de travail, s’entremêlent, se nourrissent et s’aggravent mutuellement. Nous retrouvons là, la métaphore de l’œuf et de la poule. Comment discerner qui est à l’origine ?
Par ailleurs, on constate que 300 à 400 salariés se suicident, en France, chaque année, sur leur lieu de travail [28]. Impossible, dans ces cas-là, de ne pas faire le rapprochement entre souffrance et situation professionnelle. Le suicide dans l’enceinte de l’entreprise est pour Christophe DEJOURS - psychiatre et directeur du Laboratoire de psychologie du travail et de l’action, au CNAM Paris - l’ultime témoignage de la souffrance au travail. Un fléau émergeant et des plus préoccupant, qui touche toutes les catégories socioprofessionnelles, des ouvriers aux cadres. « ... Ce phénomène est récent, cliniquement nouveau. Il est apparu, il y a une huitaine d’années. Avant cela, il touchait exclusivement les agriculteurs et salariés agricoles acculés par les dettes et dont : lieux de vie et de travail se confondaient. En dehors d’eux, si l’on se réfère aux archives de la médecine du travail, les suicides se commettaient généralement dans l’espace privé. Il était donc difficile de démontrer que le rapport au travail pouvait être en cause. » Pour ce psychiatre du travail : « Un des éléments déclencheurs est la dégradation profonde du « vivre ensem-ble », les gens sont très seuls face à l’arbitraire. Il y a toujours eu de l’injustice ou du harcèlement, dans l’entreprise, mais autrefois, les syndicats, entre autres, scellaient les solidarités. Aujourd’hui, avec l’effritement de ces solidarités et la peur de la perte d’emploi, la convivialité ordinaire, elle-même, est contaminée par des jeux stratégiques qui ruinent les relations de confiance et colonisent l’espace privé. Notamment chez les cadres, dont la vie tout entière est tendue par une lutte pour progresser dans leur carrière ou pour ne pas perdre leur position. »
Les cadres et les seniors touchés
On ne dispose pas de statistiques spécifiques concernant les suicides de cette catégorie socio professionnelle. Cependant, nous constatons que les cadres ne sont pas épargnés et souffrent autant, sinon plus, des nouvelles orientations qu’adopte le management. Plus isolés que les salariés finalement mieux défendus, constamment malmenés, soumis à une politique d’humiliation et à des stress non négligeables, ils font les frais de ces nouvelles exigences. Ils subissent une pression importante découlant des exigences de rentabilité, de compétition. L’arrivée sur le marché de jeunes diplômés fragilise leur position, dans l’entreprise. L’avancée en âge contribue à les exclure progressivement des structures dans lesquelles ils se montraient opérationnels. Force est de constater que toutes les sphères sont désormais concernées par l’ampleur de ces mutations industrielles, facteurs non négligeables de suicides. Une enquête récente de la CGC, révèle que 73 % des cadres sondés, ont le sentiment d’avoir une charge de travail plus lourde qu’il y a quelques années et 79 % une accélération du rythme de travail.
Le suicide social.
Une approche réaliste de ce développement suicidaire, ne peut se limiter à la prise en compte que des suicides mortels, réussis ou non. Il y a bien d’autres formes de suicides et ils sont loin d’être négligeables. Il s’agit de ce que j’appellerais : les suicides sociaux. C’est-à-dire, une autre façon de se détruire, quand on se sent au bout du rouleau, sans pour autant attenter à sa vie mais en se détruisant, petit à petit et en s’enfonçant dans la marginalité : par l’alcool, la drogue, la fuite sociale qui débouche souvent sur le statut de SDF.
« La France compte, au bas mot, 86 500 sans-abri et 200 000 personnes sans logement fixe. Issus du quart-monde pour la plupart, non qualifiés, isolés, ces hommes et ces femmes se retrouvent dans cette situation au terme d’une descente sociale alimentée par la crise de l’emploi et du logement et le déman-tèlement de l’État providence » [29].
Combien parmi ceux-ci, en sont arrivés là, suite à des problèmes liés au travail et/ou non-travail ?
« Depuis la crise économique des années 80, le problème de la grande précarité est réapparu d’autant plus fort que le nombre de chômeurs augmentait. L’apparition du terme nouveaux pauvres est significa-tive. Des personnes qui étaient socialement bien intégrées, se sont retrouvées isolées suite à leur perte d’emploi ou à l’augmentation du coût du logement. Des drames familiaux, l’augmentation du nombre des divorces, des problèmes d’alcool ou de drogue contribuent aussi à l’accroissement du phénomène. On assiste de plus, dans cette population, à un afflux de jeunes n’ayant encore jamais travaillé, et ayant coupé les ponts avec leur milieu d’origine familial et géographique. C’est dans ce contexte de croissance du phénomène et de l’apparition de nouveaux sans abris que le terme SDF, s’est répandu dans le public français et le langage courant. » [30]
Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi tant de dégâts physiques, moraux et sociaux, tant de souffrances et de drames engendrés par ce fléau économico-social ? Est-ce vraiment cela le progrès qu’on nous a promis ? Existe-t-il des perspectives/alternatives ou devons-nous continuer à subir ?
Les impacts émotionnels que soulèvent les dégâts du travail
Dans le cadre d’un contrat de recherche pour la DRTEFP de Paca, j’ai été chargé d’animer un collectif chargé de proposer des pistes, pour mieux maîtriser les risques du travail inhérents à la sous-traitance [31]. En tant qu’ergologue, j’ai mis en place ce que depuis nous appelons des « groupes de rencontre du travail ». Il s’agit de mettre en situation de recherche, dans le cadre d’une méthodologie précise : le dispositif dynamique à trois pôles (Le DD3P, pour les intimes), un ensemble diversifié de personnes concernées par le sujet de cette recherche, afin de réaliser des « processus socratiques à double sens » en confrontant des « savoirs constitués » avec des « savoirs investis. » Eh oh ! Attendez un peu ! Pas de panique ! Bien sûr, je reviendrai, plus loin, sur tous ces concepts méthodologiques et opérationnels. Mais, « revenons à nos moutons. »
Ce collectif regroupait donc, des représentants des donneurs d’ordre et des sous-traitants (dirigeants, syndicalistes, SHE, DRH), des médecins du travail, des institutionnels et des chercheurs. Parmi eux, il y avait le directeur régional d’une grande entreprise nationale de sous-traitance. Il a été très assidu et actif tout au long de nos travaux ; Il apportait tout le savoir et toute l’aide que son poste de direction pouvait nous offrir, comme, par exemple et entre autres, nous recevoir, avec bienveillance, dans les locaux de l’entreprise qu’il dirigeait, lorsque les locaux de la DDTEFP, d’Aix-les- Milles, étaient occupés.
Nos travaux préliminaires ont été restitués au cours d’une grand-messe (plus de 200 participants) le 08/11/2000, à Martigues [32], dans le cadre des assises régionales 2000 de la prévention. Bien évidemment, ce directeur régional était à la tribune, lors d’une table ronde. Il fut harangué vertement, par un auditeur qui lui a « balancé » : « Qu’est-ce que vous faites à cette tribune, puisque vous, en tant que patron, vous avez tous les pouvoirs en mains pour faire de la prévention ? » Dans sa réponse, il a déclaré, avec émotion et entre autres : « J’ai appris, il y a peu de temps, qu’un de mes ouvriers, père de deux enfants, venait de décéder d’une leucémie, contractée sur un poste de travail sur lequel je l’avais envoyé. J’ignorais le danger qu’il encourrait, mais je vous assure que depuis, je ne dors plus très bien chaque nuit. Et si je peux faire quelque chose pour que cela ne se reproduise plus, je le ferai ! »
Personnellement, dans l’entreprise où je travaillais, lorsqu’en Comité d’entreprise ou en CHSCT, on évoquait le cas douloureux d’un AT ou d’une maladie, tout le monde était sincèrement consterné. Il n’y avait plus, autour de la table, à cet instant, de patron, de cadres ou de syndicalistes mais des êtres humains. C’est qu’il s’agissait de quelqu’un que nous connaissions, que nous avions côtoyé voire estimé. Devant les yeux, nous n’avions pas une statistique mais un visage. Tous, nous nous sentions un peu responsable pour avoir fait - ou n’avoir pas fait - ce qu’il fallait pour éviter ce drame.
Qui n’a pas dans son entourage immédiat, une de ces victimes ? Est-il vraiment nécessaire d’insister, pour vous expliquer ce que ressentent les autres, ce qu’ils vivent ? Si nous voulons avancer sérieusement, dans notre lutte - ô combien justifiée ! - contre ce gâchis, ce fléau, cette catastrophe économique et sociale, nous n’avons pas le droit d’occulter cet aspect des choses. Personne ne peut rester et ne reste, in-sensible à ces drames.
La vraie question c’est : « comment faire ? » On ne peut résoudre un problème aussi complexe, que sous-tendent autant d’enjeux : financier, idéologique, politique, hiérarchique, même d’orgueil, sans parler des idées reçues et confortables (c’est la faute des autres, de l’autre !) sans accepter de se remettre, tous, en cause, pour une bonne part. D’accepter d’écouter l’autre et surtout de l’entendre. Sa vision des choses, même différente de la nôtre, n’est pas forcément dénuée d’intérêt et de raison. Elle contient, très certai-nement, une part de la solution mais pas toute, bien évidemment. Comme la nôtre, d’ailleurs ! Peut-on cesser de se prendre pour des Dieux ? D’être le seul - ou les seuls - détenteur de la Vérité et du Savoir immanent ? C’est difficile, il est vrai. Mais hors de cela, point de salut !
Plus loin, dans cet ouvrage, à partir des obligations légales actuelles et des avancées des sciences humai-nes et plus particulièrement de l’ergologie, nous tenterons d’apporter quelques pistes d’action. Mais il ne faudra pas s’attendre à quelque chose de simple. Cet immense fléau économico-social ne peut se résoudre à coup de : « Y-a qu’à ! », « Faut qu’on... » ni de « suffit de... ». Mais nous en avons les moyens et les capacités, il suffit de le vouloir et de le vouloir sérieusement, quelles que soient notre position et notre idéologie, dans l’échiquier de la prévention.
L’aspect judiciaire des dégâts du travail
Le banc d’infamie
Pour avoir côtoyé, dans l’entreprise qui m’employait, des responsables hiérarchiques de haut niveau, qui avaient été frappés par des sanctions judiciaires, je peux témoigner que ce risque est pris très au sérieux. Même s’il ne s’agit que de peine d’emprisonnement avec sursis, c’est tout de même une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. La fois d’après, c’est la prison ferme. Et le risque qu’il y ait une autre fois, n’est pas à sous estimer. Quant aux amendes, aussi élevées soit-elles, elles ne représentent pas de problème. C’est l’entreprise qui paie. Et, dans sa comptabilité, elles comptent pour du beurre. Mais au-delà de ce risque d’emprisonnement, il y a d’autres aspects à considérer, et non des moindres.
L’effet produit sur leur famille et leurs proches. Les articles de presse qui font état de leur procès, laissent beaucoup de traces. Mais aussi, toutes les démarches, tout le temps passé, toutes les préoccupations morales et intellectuelles, causés par l’enquête qui précède le procès et la préparation de leur défense.
L’image de marque de l’entreprise. Souvent, après une condamnation, un avis stipulant la condamnation, est placardé, pendant un mois, par les gendarmes, sur la porte d’entrée de l’entreprise et bien en vue des visiteurs. Les gendarmes, vérifient assez souvent, s’il est toujours affiché. Le dernier jour de cette infamie, le DRH se pointe, dans le hall d’entrée, bien cinq minutes avant la fin du délai imparti. Il regarde sa montre à plusieurs reprises et, à la seconde près, il arrache furieusement l’avis infamant. Pas une seconde de plus ! Les délégués syndicaux assistaient toujours, amusés, à cette scène.
La peur du gendarme
Dans la législation française, trois Codes interviennent pour légiférer dans le champ du travail :
- Le Code du travail qui regroupe les obligations relatives au contrat de travail, individuel et/ou collectif ;
- Le Code de la Sécurité sociale qui regroupe les obligations relatives à l’indemnisation des conséquences des risques du travail et à la prévention ;
- Le Code pénal pour tout ce qui relève du trouble à l’ordre public et social, à savoir, les infractions relatives aux atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique et le délit de mise en danger d’autrui.
Depuis 1994, l’évolution du Code pénal et de la jurisprudence a aggravé les sanctions encourues par les employeurs, en cas d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. En particulier la faute inexcusable est désormais reconnue dans le cas de manquement à l’obligation de sécurité de résultat (obligation de l’employeur envers ses salariés, voir ci-dessous la jurisprudence).
En 2004 [33], le rapport de l’inspection du travail révèle que : 277 055 interventions ont été effectuées en entreprises. Au cours desquelles, 886 413 observations, mises en demeure et infractions (+17 % par rapport à l’année 2003, et + 40 % par rapport à 2002) ont été relevées par lettres ou procès-verbal et signifiées aux chefs d’entreprise. L’évolution la plus importante concerne les observations, puisque 858 658 observations ont été signifiées (+17 % par rapport à 2003, et + 40 % par rapport à 2002). Ces observations se limitent à l’envoi d’une lettre, à l’employeur, lui signifiant les manquements à ses obligations et lui ordonnant d’y remédier, sous peine de poursuites. 51 % de ces observations relèvent de la santé au travail.
Environ 3 %, de ces infractions totales, représentent ce que, dans le jargon de l’inspection, on appelle : Les pénalités coercitives. C’est-à-dire, celles qui peuvent entraîner des poursuites judiciaires. De ces pénalités, 29 % relèvent de la santé au travail. Parmi l’ensemble :
- Le nombre des mises en demeure, 10 009 est marginal. Cette procédure réservée à un nombre relativement limité de situations, est en forte augmentation par rapport à 2003 (+47%).
- Le nombre d’infractions relevées par voie de procès-verbal, a été de 18 746. Également en forte augmentation par rapport à 2003 (+19%).
- Enfin, 73 procédures de référés ont été introduites, aux fins d’obtenir du juge des référés qu’il fasse cesser des travaux présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
De plus, 5 120 décisions d’arrêt ou de reprise de chantier du BTP (+ 60 % par rapport à l’année 2003, et +98 % par rapport à 2002) ont été prises, face à une cause de danger grave et imminent, résultant soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, contre les risques d’ensevelissement (plus de 98 % du total) ou contre les risques d’inhalation de poussières d’amiante, liés aux opérations de confinement ou de retrait de l’amiante (moins de 2 % du total).
Malgré le manque d’effectif reconnu, d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, ce bilan est significatif d’une situation dégradée généralisée.
La responsabilité pénale de l’employeur
La loi est dure mais c’est la loi ! Enfin, en principe !
Article L.230-2, de la loi du 31/12/1991
« I. Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris des travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’application de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises, sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène, à la santé, selon les conditions et les modalités définies par décret en Conseil d’état. »
La jurisprudence confirme cette systématique responsabilité de l’employeur, par les décisions suivantes :
![]() Concernant les maladies professionnelles :
Concernant les maladies professionnelles :
Cass. Soc., 28 février 2002 : « L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
![]() Concernant les accidents du travail :
Concernant les accidents du travail :
Cass. Soc., 11 avril 2002 : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Désormais, on peut dire que dès qu’il y a un accident du travail et/ou la survenue d’une maladie professionnelle, cela présume un manquement à une obligation de sécurité, puisque ceux-ci sont le résultat de ce manquement.
Lorsqu’il y a procès, la question n’est plus de déterminer la responsabilité de l’employeur, puisqu’elle systématiquement reconnue, en vertu de la loi du 31/12/1991 et de la jurisprudence. Il ne reste, aux juges, qu’à définir la peine.
Les contacts que je peux avoir avec des employeurs ou des organisations d’employeurs me permettent de témoigner que cette responsabilisation pénale récente, les préoccupe énormément. Pourtant, lorsqu’on suit des procès en la matière et que l’on lit les délibérés et les attendus et que l’on voit, à côté de cela, les peines octroyées, on est tenté de se dire que face à la justice actuelle, il vaut mieux être un dirigeant délinquant, responsable de plusieurs morts, plutôt qu’un jeune des banlieues, « chapardeur de poules », un tantinet basané et ne s’exprimant pas en un français châtié. Précisons, honnêtement : aux amendes infligées près. Mais on a vu, ci-dessus, qu’elles ne posent pas de gros problèmes, à ces dirigeants délinquants.
Il n’est pas question ici, de faire le procès de la justice française. Chacun fait ce qui peut, en son âme et conscience et surtout en fonction de son environnement hiérarchique. Mais je dois reconnaître que je suis quelque peu agacé par toutes ces déclarations tonitruantes et médiatisées de certains personnages officiels, concernant le laxisme supposé et condamné, de certains magistrats chargés de juger « des jeunes de banlieue » et, par ailleurs, leur silence assourdissant quand ils prennent connaissance des résultats des procès intentés à ces dirigeants délinquants. Ce qui est, me semble-t-il, faire injure à la devise, si belle, de notre pays : liberté, égalité, fraternité. De par leur fonction, ils ont en charge de la faire respecter et non de la bafouer. Cela me laisse comme un sentiment d’iniquité insupportable. Je sais bien que ce type de coup de gueule ne change rien à la situation, mais, putain ! que ça fait du bien de pouvoir le crier !
CONCLUSIONS
Alors, que fait-on ? Laisse-t-on faire ou se mobilise-t-on ? Selon les tendances actuelles, telles qu’elles apparaissent au travers des études et documents récents, si on laisse faire, cela va encore s’aggraver. Nous voici informés ! La politique de l’autruche est-elle toujours de mise, face à une telle hécatombe, face à un fléau économico-social de cette ampleur ? Et quelle ampleur !
En 2004, en France, nous avons subi 1 233 accidents mortels, y compris les routiers (environ 5/jours ouvrés). Si l’on y ajoute les quelque 20 000 morts, a minima, de maladie d’origine professionnelle, reconnue ou non (selon INVS) ; si on y ajoute les plus de 10 000 suicides réussis dont on sait que la plupart ne sont pas étrangers à des facteurs liés au travail ou au non-travail ; si on y ajoute tous les infirmes, les estropiés dans leur chair et/ou dans leur être, nous constatons, consternés, une véritable hécatombe de morts et de détruits au champ du déshonneur du travail tel qu’il est advenu. Et tout cela pourquoi ? Pour enrichir un peu plus une minorité de gens déjà très riches. Car ce n’est pas le travail, en lui-même, qui en est responsable mais les conditions dans lesquels on nous fait travailler. Et dans quels buts ? Il convient de ne pas confondre le travail avec son exploitation salariale actuelle. Arrêtons d’accuser un innocent : le travail, dont la fonction fondamentale est tout autre voire son contraire, pour camoufler et innocenter le véritable coupable : cette soif de profits et de pouvoirs de certains adorateurs du veau d’or qui est de plus en plus debout. C’est intolérable !
Devant une telle tuerie, comment ne pas rugir violemment quand on entend des dirigeants d’entreprise se plaindre des « tracasseries administratives et judiciaires » du personnel de contrôle ou des juges - pourtant in fine plus gentils que méchants, comme l’actualité judiciaire le montre. Comment rester impassible quand on les entend dire : « Dans ces conditions, on ne peut plus travailler ! » Et tous ces morts ou invalides, est-ce qu’ils peuvent encore travailler, eux !
Je reconnais et admets que l’on puisse me reprocher d’avoir instruit ce réquisitoire essentiellement à charge. Si tel est l’impression générale, je plaide les circonstances atténuantes. J’ai tellement vécu, connu et supporté de ces situations dramatiques, tout au long de ma vie familiale, professionnelle et syndicale et maintenant en tant que chercheur, que j’ai envie de crier : « Basta ! Ça suffit ! C’est trop injuste et c’est insupportable ! »
Si à mes yeux, ce réquisitoire à charge se justifie du fait des résultats globaux, il est évident que dans certaines entreprises, la prévention des risques est prise au sérieux et que des résultats encourageants sont obtenus. Le nier, relèverait de la mauvaise foi. Mais les exemples me manquent, pour les citer. Ceci est, me semble-t-il, le résultat d’une certaine culture qui refuse de s’intéresser aux trains qui arrivent à l’heure et sans dommage. Lorsque tout se passe bien, cela ne semble captiver personne. Ou plus exactement, cela n’intéresse pas les médias. « Circulez ! y-a rien à voir ! » Et c’est dommage car il y a beaucoup à apprendre des réussites. Je suis même, personnellement convaincu, qu’il y a plus d’enseignements à tirer des réussites que des échecs. C’est pour cela, qu’en annexe de ce livre, je propose une enquête que j’avais réalisée et insérée dans mon premier ouvrage [34], sur les « diables rouges de la réparation navale marseillaise ». Si je rediffuse ce texte, c’est bien pour montrer et préserver l’exemple d’une maîtrise des risques professionnels réussie, dans une corporation particulièrement dangereuse : la réparation navale. Ce qui me scandalise, c’est de voir comment cet exemple, immensément riche en enseignements, est tombé dans les oubliettes de l’histoire. Et ce, uniquement pour des raisons idéologiques, de toutes parts. Côté patronal, il s’agissait là d’une « soviétisation de l’entreprise » ; côté syndical, ce fut analysé comme de la « collaboration de classe » doublée d’une « auto exploitation ». Les incontestables résultats obtenus, tant dans le domaine de la santé/sécurité que sur le plan économique, sont considérés comme négligeables à côté des risques idéologiques encourus, selon certains décideurs. Désolant !
À mon humble avis, lorsque les vrais décideurs sont à proximité des lieux de production, ils s’aperçoivent, généralement et assez vite, que plus les conditions de travail sont bonnes et acceptées, plus les salariés, cadres y compris, sont motivés, s’autonomisent et renforcent leur efficacité et leur productivité. Ces réactions positives découlent de la nature profonde et de la fonction ontogénique du travail humain. Ce qui renvoie à une judicieuse mise en valeur des ressources humaines qui rentrent, pour une part non négligeable et non négligée, dans la productivité d’une entreprise. Conditions de travail, qualité du travail, santé/sécurité et productivité, sont indissociables [35]. Mais, lorsque les vrais décideurs sont à des centaines de kilomètres, lorsque tout ce qu’ils comprennent et connaissent du travail de leurs salariés, ce sont des colonnes de chiffres (surtout celles de gauche), des ratios et autres ingrédients capitalistiques, leurs perceptions de la réalité du travail est faussée, déformée voire caricaturale. Alors, si ces ingrédients capitalistiques ne répondent pas à leurs objectifs, ils en déduisent vite, et sans chercher plus loin, que cela provient d’un laxisme, d’une démobilisation, d’un laisser-aller, etc.. Et la solution que leur préconise leur idéologie, via tous leurs intermédiaires, c’est, comme nous disons dans le BTP, de « faire suer encore plus, le burnous ». Et à partir de là, s’enclenche la spirale infernale. Plus on serre la vis, plus les condi-tions de travail se détériorent, plus les dégâts du travail s’aggravent, la qualité se dégrade, les ingrédients capitalistiques virent au rouge, etc., etc.. Et l’on repart pour un tour, jusqu’à ce que, de guerre lasse, la décision de délocaliser s’impose à eux. Et « les usines voyagent » parce qu’ailleurs les conditions d’exploitation sont plus favorables aux « lecteurs de colonnes. » Mais jusqu’où pourra-t-on aller ainsi ? Qu’est-ce que l’on va trouver au bout de cette logique infernale ?
Peut-on espérer, encore, envisager des solutions plus pertinentes et surtout plus humaines ? À quelles conditions ? Des solutions simples d’application, certainement pas. Si elles existaient nous n’en serions pas là. Mais à l’orée de ce XXIe siècle, l’Homme a montré qu’il pouvait, quand il le voulait vraiment, résoudre des problèmes autrement plus ardus. Mais voilà, le voulons-nous vraiment ?
Pourtant non seulement ces solutions existent mais, qui plus est, elles sont imposées par la loi. C’est ce que j’aimerai essayer de montrer, par la suite.
Pierre TRINQUET
Sociologue/Ergologue
Département Institut d’Ergologie/APST
Université de Provence