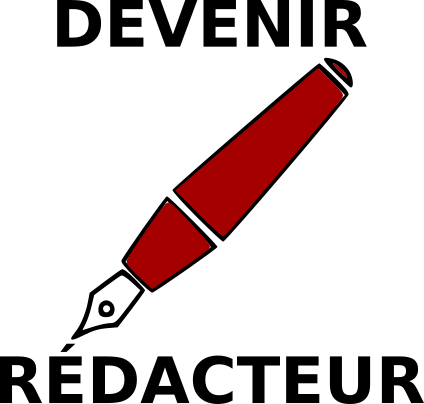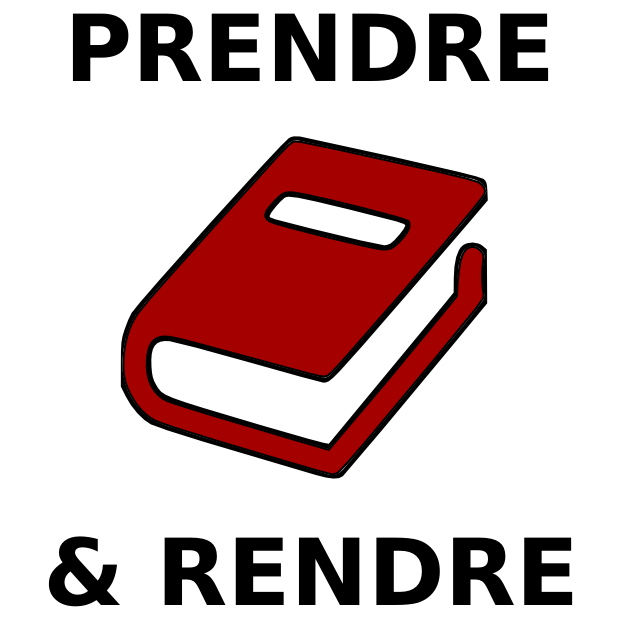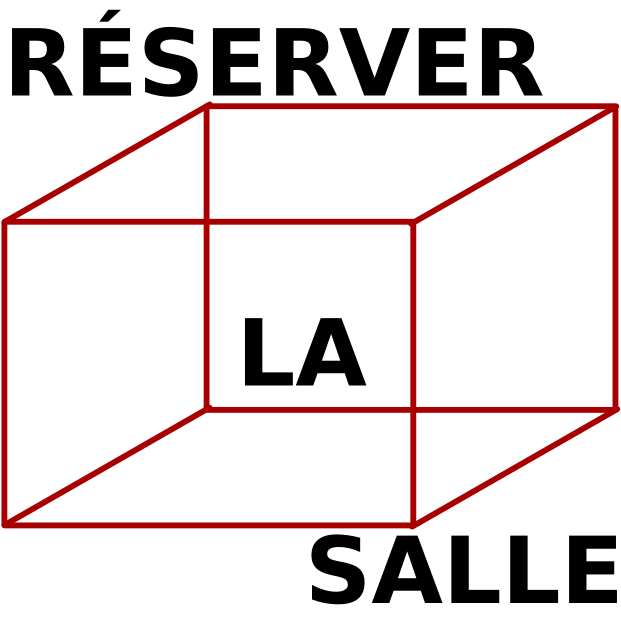L’école de la République
Michel est d’une famille d’instits, comme marquée par le destin.
Son grand-père, Jean, qui était né en 1903 – Le siècle avait 3 ans, disait-il souvent pour paraphraser Victor Hugo -, avait été un des hussards de la République, et il en était fier. Trop jeune pour faire la guerre de 14 – 18, trop vieux pour participer à la débâcle militaire de 39, frais et dispos dans les manifestations de 36, Jean avait été toute sa vie l’instit, le maître vénéré, à l’école comme à la maison. Michel ne l’avait jamais vraiment connu en exercice puisque ce grand-père avait pris sa retraite 2 ans après sa naissance. Il l’avait plus connu comme jardinier, chasseur et pêcheur, et comme donnant toujours des explications sur toute chose comme s’il les donnait à un parterre d’élèves du certificat d’étude. Jean avait rempli sa mission, pour lui s’en était une, pendant presque toute sa carrière dans un village de campagne où il avait la classe des garçons, puis avait terminé comme directeur dans une école un peu plus grosse du chef lieu de canton. Il racontait pendant des heures le poêle à allumer, les enfants arrivant en galoches, été comme hiver, certains ayant fait 4 à 5 kilomètres à travers la campagne, certains même avec déjà un peu de gnole dans le sang pour tenir le coup sous le vent qui bisaillait. Beaucoup savaient à peine parler français, s’exprimant le plus souvent en patois, sorte de franco-provençal qu’il apprit à comprendre. Et durant des années et des années, Jean apprit le français à ces petits paysans qui ne venaient souvent à l’école que de novembre à mai. Si Michel l’interrogeait sur le fait que pendant cette troisième république, l’école avait été un instrument très efficace pour tuer toutes les langues locales et si cela le gênait d’avoir été un des bras de cette unification, Jean hésitait un peu, puis répondait non, qu’il donnait aussi la culture et les moyens de se débrouiller dans la vie, mais qu’effectivement il aurait été sans doute mieux de ne pas dénigrer cette culture locale ni la tuer, mais faire cohabiter les deux, que l’homme était comme ça, que chaque fois qu’un pays s’installe quelque part, il tue le culture indigène ou carrément les indigènes eux-mêmes. Quand Michel faisait remarquer à Jean que malgré cette culture enseignée, malgré toutes les leçons de morale insufflées qui paraissent maintenant un modèle, malgré le patriotisme instillé, malgré tout cela, il y avait eu la guerre, la collaboration ou la passivité de bon nombre de français, il y avait eu de ces anciens élèves qui savaient aider et les quelques maquisards et les autres pour naviguer au plus près du porte monnaie ou se préparer ou la vie sauve ou des lendemains chantants, celui-ci se taisait. Longuement, il regardait la fumée de sa cigarette s’échapper entre ses doigts, cigarette roulée avec du Bergerac, très fine, puis soupirait un grand coup comme pour chasser un mauvais rêve. Ils se regardaient et Jean murmurait que c’était un autre temps, dur à comprendre. Quant à sa pédagogie, on sentait que ça n’avait pas été une préoccupation ni un sujet de débat ou de discussion. Les élèves étaient là pour apprendre, lui était là pour leur apprendre avec patience, fermeté, affection souvent, mais toujours avec un ordre parfait, une discipline imposée qui allait de soi. Jean disait aussi que de son temps, l’instituteur était considéré, que son salaire équivalait à celui d’un général dans l’armée alors que maintenant il devait être à la hauteur d’un simple sergent, que tout cela montrait bien que la société avait changé, qu’elle ne mettait plus en avant les mêmes valeurs, les mêmes priorité.
Ses parents étaient un couple d’instit, François et Anne, dans la pure tradition, avec MAIF, CAMIF, MGEN, AUTONOME, SNI et GCU. Ils s’étaient connus lorsqu’ils étaient à l’Ecole Normale de Lyon, l’un à celle de garçons, l’autre à celle de filles. Le plateau de la Croix Rousse avait vu nombre de leurs déambulations amoureuses. Tous les deux avaient opté dès la 3ème pour cette filière. Ils s’étaient installés dans une petite ville de la périphérie de Lyon où chacun avait un poste dans une école différente car ils ne voulaient pas travailler dans la même école, comme ils avaient tenu à ce que leurs enfants soient scolarisés dans une école autre que la leur. Ils étaient très croyants et faisaient parti de ce que l’on appelait à l’époque les chrétiens de gauche, très à gauche, impliqués dans les mouvements contre la guerre d’Algérie, contre la torture, dans les mouvements anti militaristes, dans toutes les luttes sociales. Il avait vu défilé aux repas à la maison tous les prêtres ouvriers qui étaient nommés dans cette paroisse. Mais ils étaient farouchement pour un respect de la laïcité, et notamment à l’école. Michel avait toujours vu ses parents lire Témoignage Chrétien et soutenir financièrement ce journal. Des personnes donc très engagées politiquement dans la société et qui avaient une rigueur morale à toute épreuve. Ils suivaient toutes les grèves de leur syndicat, le SNI, et se battait par exemple pour la revalorisation de leur métier qui se dégradait de jour en jour, ce qui entrainait une féminisation grandissante du corps des instituteurs. Anne choisit assez vite de travailler en maternelle et y fit presque toute sa carrière. François fit à peu près tous les niveaux de classe pour choisir finalement les CM2, puis, en plus, devint directeur de son école. A sa retraite, Anne s’occupa d’elle, de ses enfants et petits enfants. François continua à militer, fut correspondant de la CASDEN, siégea au conseil d’administration de la MAIF et fut aussi de longues années un DDEN assidu. A l’école aussi c’était la rigueur. L’élève était là pour apprendre et eux pour leur apprendre. Mais avec le temps, François avait installé au fond de sa classe des fichiers autocorrectifs pour ceux qui avaient fini avant les autres, faisaient parfois de travail de groupe et avait créé dans son école une coopérative scolaire. Les discussions pédagogiques se terminaient très vite.
Michel eut le privilège, avant que certains meurent, de discuter avec deux générations d’instits, lui constituant la troisième. Un des grands débats était sur la soi disant baisse de niveau. Jean disait souvent :
C’est un leurre, une erreur, de croire que le niveau scolaire à mon époque était plus élevé. Il faut comparer ce qui est comparable. Beaucoup d’enfants ne faisaient pas un temps plein à l’école, très peu poussaient leurs études au-delà du certificat et de leurs 14 ans. Globalement, la population était beaucoup moins savante qu’aujourd’hui. Il suffit de constater comment lisent ou écrivent une grande partie des gens, surtout en milieu rural. C’est très très médiocre.
François ajoutait :
Les médias s’emparent de chiffres qui ne veulent rien dire, sont souvent faux dans leur formulation et ne correspondent à rien. On nous dit qu’il y a de plus en plus d’élèves en difficulté scolaire. Ce n’est pas sûr. On les voit plus, ça c’est certain, parce que la société actuelle ne leur offre plus rien en termes de travail. Avec le plein emploi, tous ceux qui ne réussissaient pas à l’école trouvaient du travail sans problème et beaucoup ont même pu, après, monter dans la hiérarchie. Du coup ils n’étaient pas un problème et on ne s’en souciait guère. Ils me font rire avec leur valorisation du travail, alors que les exemples qu’on monte en épingles, les héros modernes, ce sont les sportifs ou certains acteurs qui gagnent un argent fou sans trop se prendre la tête, ou même tous ces spéculateurs qui gagnent des sommes phénoménales sans rien faire. Tant que l’argent sera la valeur numéro un, il est tout-à-fait hypocrite de parler de la valeur travail.
Et tous ces jeux à la télé ou à gratter, fulminait François ? Pourquoi chercher du travail ou travailler à l’école puisqu’on peut espérer gagner des millions sans faire grand-chose. On ajoute sans arrêt l’immoralité aux mauvais exemples. Et après on s’étonne que les enfants n’aient pas envie de travailler.
Michel disait alors qu’il s’en fichait un peu de cette histoire de baisse de niveau, réelle ou pas, et que l’école telle qu’elle fonctionnait générait de l’échec par rapport à ses normes, qu’elle s’en nourrissait même puisqu’elle était basée sur la compétition entre individus, la valorisation individuelle, et qu’il fallait bien des élèves en échec pour valoriser les autres, qu’il fallait bien des contre exemples pour que le discours des enseignants et des parents ait un semblant de vérité quand ils disaient des phrases du genre « travaille bien à l’école pour avoir un bon métier » ou « si tu continues à ne pas travailler, tu videras les poubelles ». Il parlait d’une école qui appliquait les méthodes d’une entreprise libérale, qui niait le groupe, qui niait l’enfant, qui créait de la violence et qu’il fallait changer tout cela.
Son père et son grand-père poussaient des soupirs, s’obstinant à penser que c’était la société qu’il fallait changer, que l’école n’y était pour rien et que Michel culpabilisait les enseignants qui faisaient leur travail consciencieusement. Le cendrier était plein, un peu de fumée s’en dégageait encore, les doigts se croisaient et se décroisaient et Michel ressentait avec une douleur diffuse le poids des certitudes fortifiées par une vie. Il voyait dans leurs regards un peu fatigués, dans une certaine façon de faire bouger d’épais sourcils blanchis, dans d’imperceptibles rictus accentuant quelques sillons de rides, dans des mains épaisses posées à plat sur la table ou sur les cuisses, il voyait, comme tracée par le temps, l’impossibilité à remettre en cause ce qui avait fait leurs combats et leur vie quotidienne, cette couche de réponses uniques qui forge l’apaisement des hommes et qui résiste comme l’armure d’un chevalier de l’existence.
Michel n’avait pas eu la vocation d’être instit. Ce mot vocation d’ailleurs n’évoquait rien pour lui, à part des images plutôt négatives. Révoltés assez vite par ce qu’on appelait la société de consommation, il voulait agir, agir tout de suite, militer pour que les choses changent. Au lycée déjà il avait créé plusieurs journaux. Il s’était lancé dans des études de médecine qu’il abandonna vite pour avoir du temps pour changer le monde. Il se rendit vite compte qu’il ne pouvait pas prêcher la bonne parole sur les marchés, dans des réunions, des rencontres, mener des combats politiques, écrire des articles, manifester, se battre, en continuant des études longues et assidues. Il décida alors de passer le concours de l’école normale qu’il réussit assez facilement. Voilà pourquoi il s’est trouvé et se trouve encore lancé dans cette aventure de l’école. Quand il y repense, il ne trouve pas très glorieux comme motivation par rapport à l’importance du rôle, en pensant aussi aux motivations de ses parents et grands-parents, mais c’est comme ça.
Comme il ne concevait pas sa vie en tranche, il était évident pour lui que sa pratique à l’école devait faire un tout cohérent avec ses combats et ses idées. Il ne comprenait pas que tous ces enseignants syndiqués, comme Jean et François, de toutes les batailles politiques, de toutes les grandes idées sur le devenir de la société, étaient incapables de réaliser que par leurs pratiques qu’ils ne changeaient pas d’un iota, ils réduisaient à néant leurs espoirs, que beaucoup se passait là, dans leurs classes, et que le mode d’acquisition des connaissances façonnait un mode de pensée, une norme sociale, des attitudes qui renforçaient la société qu’ils combattaient. A l’heure actuelle, il comprend peut-être pourquoi, mais ne l’accepte toujours pas. Une hypocrisie, presque une escroquerie intellectuelle. Il lut alors beaucoup à propos de pédagogie, rencontra ce qu’il cherchait chez Célestin Freinet, visita des classes, fit des stages pendant les vacances, rencontra des gens formidables, qui, dans leur coin, sans faire de bruit, donnait à la vie beaucoup plus de chance que s’ils avaient passé leur temps sur de petites barricades bourgeoises.
Au bout de luttes perdues et de paroles vaines, de confrontations musclées avec les forces de l’ordre sur des champs nucléaires, il se lança, comme il savait le faire, pleinement, dans la pédagogie et dans le vivre chaque jour ce qu’on pense.
Il pressentit que le lieu qui était fait pour cela, l’espace qui avait gardé un peu de liberté dans une institution qui se donnait l’illusion de bâillonner ses ouailles, lesquelles ouailles étant bien contentes de jouer le jeu et d’en profiter pour ne pas prendre, justement, de liberté, l’endroit où l’école pouvait vivre en osmose avec son village, c’était une classe unique. Au mouvement, il ne demanda que des classes uniques, à un moment où il en existait encore un certain nombre. Il pressentait une aventure possible et enthousiasmante, il ne pouvait pas imaginer ce que ce choix allait lui donner.
Petit village perché à plus de 800 mètres d’altitude, ni beau, ni laid, posé en pleine nature sur un socle granitique, pour bien montrer la rudesse des lieux et la solidité des hommes. Des maisons de pierres rouges, avides d’histoires, de secrets de famille, de solidarité et de haines, de trahisons et d’amour, de religion païenne. Ils arrivent au mois d’août, accueillis par un brouillard tenace et des cris de corbeaux perchés sur un clocher qui vous débite des angélus trois fois par jour, lui le nouvel instit et sa femme enceinte de leur deuxième enfant. L’école, vieux bâtiment fatigué dans l’ombre de l’église, est à une extrémité du village, au bout d’un bout de ciel. 14 élèves de 5 ans à 11 ans, dans une seule pièce de 35 mètres carré, un peu sombre, et l’appartement au dessus. C’est ainsi qu’une tranche de vie commence.
Quelques années plus tard, il publie cet article dans une revue pédagogique, comme un résumé de son évolution.
_ Le plan de travail n’est pas un contrat
Dans une classe, comme dans la vie d’ailleurs, nous devons choisir, parfois bien inconsciemment, entre la liberté et la sécurité, avec tous les stades intermédiaires possibles et imaginables.
Selon que l’on cherche ou construit une structure tendant vers la sécurité de nous-mêmes et de l’Institution, ou vers une libéralisation du système scolaire aussi bien dans son organisation que dans ses rapports humains ou son approche du mode d’acquisition des savoirs, les outils que nous allons utiliser ne seront pas les mêmes. Chaque enseignant qui, à un moment ou à un autre, s’est posé véritablement des questions sur son fonctionnement pédagogique et l’a fait évoluer au cours du temps, peut observer et analyser l’évolution des outils employés ou l’évolution de leur utilisation.
Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à ce qu’on nomme, dans la lignée des enseignants « Freinet », le plan de travail, mais en donnant un sens très large à cette dénomination : tout document qui aide, montre, évalue, accompagne, soutient... le travail d’une classe, d’un enfant, d’un enseignant... Il est donc tout à fait révélateur du degré de liberté ou de sécurité où nous nous trouvons à un moment donné, et de l’évolution de la structure classe et de sa vie. Son évolution par rapport à l’évolution de cette structure, et les interactions entre structure et plan de travail seront intéressantes à observer.
Le plan de travail est également le révélateur de la manière dont nous abordons le problème du temps, qui est, à mon sens, un élément majeur dans notre capacité à faire évoluer notre pédagogie :
- privilège donné au seul temps présent, à l’instantané, et donc au paraître, au résultat immédiat et non durable, à la rentabilité, au saucissonnage...
- privilège donné au temps de l’histoire (passé, présent, futur), et donc à la durée, au long terme, au respect du rythme de chacun, à la « perte de temps », aux chemins de traverse...
La structure joue alors, bien sûr, un rôle important dans les possibilités qu’elle donne dans son appréciation du temps. L’observation du plan de travail d’une classe unique, d’une classe à deux cours ou d’une classe homogène à un seul cours peut être assez révélatrice.
_ 1.Dans un enseignement de type frontal
Dans cette situation d’enseignement, la plupart des initiatives viennent du « maître », lui seul possède un plan de travail, en grande partie dicté par l’administration : il semble décider de tout... et finalement ne décide de pas grand chose.
Son plan de travail se compose :
- d’un emploi du temps, où le temps de chaque journée est fractionné en tranches très exactement limitées, suivant les instructions officielles définissant le nombre d’heures imparties à chaque discipline. Toutes les semaines se suivent et se ressemblent. Il est affiché (C’est d’ailleurs une obligation) ;
- d’un cahier journal où est relevée en détail la préparation de chaque cours. C’est un élément essentiel de vérification du travail du maître par ses supérieurs.
- les différents cahiers d’élèves, qui, en fait, sont les cahiers... du maître, et n’ont de valeur que par la griffe mis par celui-ci chaque jour (note, appréciation, arrachage de page...). Ils sont la vitrine du travail du maître pour les parents et pour ses supérieurs. Ils servent soi-disant à l’évaluation des élèves par le maître ; ils sont soi-disant le support de la réussite ou de l’échec des élèves. En fait, ils servent à l’évaluation du maître, de support à sa réussite ou à son échec dans la transmission des savoirs du programme, de faire-valoir de sa « capacité » pédagogique (le cahier doit être bien tenu, l’écriture correcte, sans taches...). Les cahiers sont le miroir de la conscience professionnelle du maître. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont épluchés soigneusement en cas d’inspection ;
- des livrets scolaires et autres carnets de notes qui officialisent cette réussite ou cet échec, et qui deviennent, à intervalles réguliers, le miroir de la conscience des parents...
- le carnet de devoirs et de leçons ;
- les livres scolaires et leurs progressions, préparations, corrections... toutes faites.
Ici, l’enfant n’a pas besoin de plan de travail puisqu’il n’a aucune responsabilité dans aucun maillon de la vie scolaire. Il est passif et suit les consignes. Son seul plan de travail, il l’a dans sa tête, avec d’éventuels projets de chahuts, indiscipline, farces...
Tous ces outils ne servent qu’à la gestion de la sécurité : suivi des programmes, des horaires, des élèves qui ne sont que des éléments statistiques ; sécurité du maître, de l’institution, de toute la société qui les ont mis au point pour la préservation d’un état, d’un ordre établi.
2.L’hétérogénéité peut ouvrir la brèche …
A partir de ce cas limite, mais largement répandu dans l’Education nationale, d’une organisation où tout repose sur le sacro-saint maître qui, par sécurité, n’a d’autre plan de travail que celui proposé/imposé par l’administration, l’institution, le pouvoir économique (éditeurs) et le poids du conformisme sociétal et parental, nous pouvons escalader l’échelle sécurité/liberté degré par degré. Notons que, dans ce cas limite (tout en bas de l’échelle), l’espace-temps école est une structure morte, fermée, réservée aux spécialistes, incapable d’évoluer parce que, justement, évoluant dans un temps irréel, le temps de l’illusion.
Ce sont souvent les circonstances qui amènent à escalader un échelon. Nous voyons là pointer le nez de l’hétérogénéité facteur de déstabilisation. Une de ces circonstances sera le fait d’être dans une classe à plusieurs cours ou dans une classe où les différences de niveau entre les enfants sont telles que quelques espaces de liberté possible vont se dégager pour certains d’entre eux (malheureusement, en général « les meilleurs »). La liberté se traduira par la possibilité pour certains de faire un dessin ou lire un livre, sans qu’il y ait de matérialisation ou de valorisation de cette activité.
Cette première brèche ne se traduira par un changement dans la notion de plan de travail que si l’effet « structure hétérogène » s’accompagne ou provoque une réflexion pédagogique, c’est-à-dire une première acceptation de déstabilisation, de remise en cause du processus frontal d’acquisition des connaissances.
Les mouvements pédagogiques qui ont pris naissance essentiellement dans la première moitié du XXe siècle ont permis cette réflexion pédagogique en montrant que ces espaces de liberté révélaient une autre approche de l’acte pédagogique, et que l’acquisition des connaissances par un enfant pouvait être bien plus complexe que ce que l’on supposait. Les notions d’autonomie, de coopération et surtout de tâtonnement expérimental pointaient leur nez, principalement avec le mouvement Freinet, inventeur, si l’on peut dire, de ce terme de plan de travail.
Ces moments de liberté, subis à cause des circonstances, pouvaient s’agrandir, concerner ce que l’on nomme sans doute fort injustement « les matières fondamentales », et devenir majoritaires dans le temps de la classe, devenir la vie de la classe.
Apparaissent alors des outils nouveaux qui vont constituer un nouveau plan de travail, prenant petit à petit la place de l’ancien, les deux se mêlant suivant l’échelon sur lequel on se trouve.
_ 3.… A un nouveau plan de travail
Essayons de voir comment se transforme l’ancien plan de travail cité précédemment :
- un élément nouveau apparaît : ce document nommé en général « plan de travail individuel » c’est-à-dire propre à chaque élève, sera le reflet du travail individuel de chacun, pouvant servir de repère pour l’enfant lui-même, pour l’enseignant, pour les parents et pour l’institution ;
- les cahiers d’élèves deviennent plus personnalisés puisqu’y apparaissent des travaux différents suivant les enfants ;
- les livres sont plus ou moins remplacés par des outils genre fichiers autocorrectifs, conçus pour permettre aux enfants d’acquérir des notions de façon autonome, avec un certain tâtonnement possible, et permettant à chacun de suivre son rythme. Apparaissent également toutes sortes de fiches suscitant ou provoquant des pistes de recherche.
- l’expression de chacun étant suscitée, favorisée ou provoquée, apparaissent des supports de cette expression : journaux scolaires, correspondance, albums... qui sont les éléments du plan de travail général appartenant vraiment aux enfants, mais en même temps éléments démontrant à l’extérieur une activité.
- les documents d’évaluation deviennent plus personnalisés, et arrivent à être faits par les enfants eux-mêmes par une auto-évaluation prenant la forme de tests autocorrectifs, brevets, ceintures..., jugements du groupe... exposables aussi à l’extérieur.
Cette nouvelle organisation va, bien sûr, entraîner une autre organisation de l’espace. Des coins ateliers apparaissent alors. Le caractère figé de la classe s’anime.
En est-on pour autant au point où la liberté l’emporte sur la sécurité ? _ Est-on certains que ce nouveau plan de travail n’est pas encore essentiellement celui du maître et de l’institution ?
Le point de départ est encore d’énoncer ce raisonnement : l’école existe pour apprendre telles notions, acquérir telles compétences, savoir-faire, connaissances définies par des programmes. Toutes les activités faites à l’école doivent tendre vers cela. Le degré de liberté instillé est alors très relatif. L’acte pédagogique sera fait pour, en vue de... et le travail individualisé, le tâtonnement de chaque enfant sera orienté, canalisé vers ce but. Cela se retrouve dans la persistance de l’emploi du temps qui balise, lui aussi, les temps réservés aux ateliers et aux activités dites libres et individuelles. Persiste souvent aussi une sorte de cahier-journal où sont notées chaque jour, répertoriées, les activités, les connaissances acquises...
Le document proprement appelé « plan de travail » n’est autre qu’un contrat (il en a même parfois réellement le nom) passé entre le maître et... l’institution. Souvent, il est demandé à chaque enfant de faire, dans un laps de temps donné, tant de fiches d’orthographe, d’opérations, de lecture... et même tant de textes libres..., d’aller obligatoirement vers tel atelier... Et même si cela est discuté entre le maître et les élèves, c’est un contrat biaisé au départ parce que, encore une fois, c’est d’abord un contrat entre le maître et l’institution.
_Et même si tous ces fichiers sont un progrès terrible par rapport aux livres, même s’ils permettent à chaque enfant d’avoir une démarche autonome, d’avoir un certain tâtonnement individuel, ce sont quand même des exercices conçus pour remplir ce contrat.
La sécurité et le besoin de sécurité ont encore une belle place toute chaude.
Les différences entre les enfants étant telles, il faut ensuite prévoir deux parties dans le plan de travail :
— une obligatoire (le minimum à réaliser dans la semaine)
— une partie facultative qui ne peut être abordée qu’après que le contrat minimum ait été rempli.
De la sorte, il est possible à chacun de parvenir à s’organiser à son rythme. Chaque semaine, le plan est signé par les parents. Un tel plan est toujours en évolution, les rubriques changeant au fur et à mesure des travaux en cours.
_ 4.La communication ne se planifie pas !
C’est, je crois, l’acceptation de vivre l’aventure de la communication qui permet de sortir de l’enlisement sécuritaire, je dirai plutôt des communications qui sont le tâtonnement expérimental par excellence... Cela n’est possible qu’avec du temps, le temps d’en perdre. Cela ne peut se faire dans un temps rentable et réduit au présent. C’est sans doute pour cela qu’il est plus facile de s’embarquer dans cette aventure dans une classe à plusieurs cours et, encore plus, en classe unique.
Lorsque le groupe classe est une vraie structure où les interrelations sont nombreuses entre les êtres qui la composent ou entre ces êtres et leur environnement matériel ou vivant, que ces communications sont sources d’interrogations, de désirs de recherche ou de créations, si l’on veut leur laisser libre cours, leur donner le temps d’éclore, de retomber, de renaître, de rebondir... le plan de travail précédent est violé. Peut-on encore tout prévoir à l’avance, réduire ce tâtonnement véritable qu’est la communication à certaines plages horaires bien définies ? Peut-on le faire et faire aussi des fiches ou autres exercices ? Cela s’avère impossible.
Lorsque ce groupe classe ou « école structure vivante intérieurement », s’ouvre sur l’extérieur et reçoit des lettres de France et d’ailleurs ainsi que des journaux, il s’avère impossible de s’y plonger vraiment et de faire son « contrat » de travail.
Lorsque la messagerie électronique et internet viennent amplifier ce flux d’informations reçues et multiplier les envies de tâtonnement, il est impossible d’accepter cette vie et continuer à s’accrocher au schéma plan/contrat de travail.
5.Le plan de travail n’est plus un contrat…
Que devient le plan de travail ?
Il n’est plus celui du maître et de l’institution, il devient véritablement celui du groupe et de chaque enfant :
l’emploi du temps devient impossible à faire, ainsi que le saucissonnage des différentes matières en quantités d’heures précises. Toute progression préétablie devient caduque. Le cahier journal peut subsister pour le maître, dans lequel il essayera de transcrire chaque jour la vie déroulée (mais quel boulot, à mon avis impossible, trop de choses nous échappent) ;
les livres d’exercices, les fiches autocorrectives se recouvrent de poussière ;
la feuille « plan de travail » ne peut plus être un contrat (contrat sur l’inconnu ?). Elle se dénude pour devenir un pense-bête, un lieu où l’on note ce qu’on prévoit de faire et ce qu’on a fait. Elle peut permettre de montrer à l’extérieur (parents, institution...) l’activité de chacun ;
les cahiers deviennent vraiment la propriété individuelle de chaque enfant, sur lesquels il mettra ses textes libres français et math, ses recherches... Le classeur devient le repère où viennent se loger les lettres, les messages,...
le journal hebdomadaire, écrit, tapé, mis en page par les enfants est placé sur le site internet , expédié par eux à d’autres écoles de France ou à l’étranger, il peut être couplé avec un mensuel vendu dans le village.
les murs deviennent des éléments du plan de travail, avec courriers, photos, articles, souvenirs, créations... Tout l’espace devient plan de travail, les ateliers disséminés aux quatre coins de l’immeuble école, le village, la nature, les autres, soi-même...
Les éléments d’évaluation deviennent inutiles. La communication, tout en étant tâtonnement expérimental permanent, est auto-évaluation permanente.
_ 6.… mais un agenda historique
Pour arriver à se sortir de cette béquille sécuritaire qu’est le plan de travail/contrat, encore une fois contrat entre le maître et l’institution en dehors de tout sens réel de la vie du groupe, il faut sortir de cette fausse évidence de départ qui consiste à dire que l’école existe pour apprendre telles et telles choses définies dans des programmes.
L’école est une structure parmi bien d’autres (famille, médias, nature...) ayant de nombreuses intersections avec ces autres structures. Comme toutes structures, elle se définira plus ou moins morte ou vivante par le nombre d’interrelations existant entre ses membres permanents ou occasionnels.
Le rôle de la collectivité est de faire en sorte que cette structure puisse être la plus riche possible en aménageant un espace suffisamment grand et équipé pour permettre la plus grande diversité possible de communications. Ce n’est pas de prédéfinir ce que sera le résultat immédiat de ces communications.
Le plan de travail est alors bien un moyen d’aider à l’organisation de ces communications, aide individuelle si besoin est, aide collective pour tout le groupe, et non pas un balisage pour mener les enfants sur les chemins que l’on veut (maître ou institution), au moment que l’on a décidé (maître, spécialistes, institution...).
En laissant le temps à cette structure de se construire, de vivre, de créer de l’ordre, puis du désordre, puis de l’ordre..., de s’inventer une vraie histoire, d’évoluer dans un temps réel passé, présent et avenir, elle permet à chacun qui la traverse de se fabriquer homme, citoyen responsable. Elle donne le temps et des moyens privilégiés à chacun de découvrir, malaxer, torturer, acquérir les langages multiples, supports des communications, ayant comme noms savants français, mathématiques, sciences, arts, langues...
Le terme même de plan de travail désignant le document propre « plan de travail » devient, à mon sens, inexact et ne reflète pas ce qu’il est vraiment. Je proposerais peut-être alors un nouveau terme moins ambigu : l’agenda historique.
Ses parents et son grand-père n’étaient plus là pour lire cet article. Il aurait aimé qu’ils puissent le faire. Qu’en auraient-ils pensé ? Lui ressentait vraiment que le fonctionnement qui s’était institué dans sa classe était ce que l’école devait être. Il en ressentait aussi les effets sur les enfants qui restaient 7 à 8 ans avec lui, et quand ils les voyaient manipuler tous les langages avec autant de passion et d’intérêt, il percevait de la beauté. On va bien me prendre pour un fou, se disait-il, à parler de beauté là où on voudrait qu’il ne soit question que de performance, efficacité, réussite personnelle, évaluation, un fou ou un révolutionnaire. Et bien soit, qu’il en soit ainsi, gueulait-il dans sa classe vide, imitant quelque tribun ridicule et vide, alors que la nuit envahissait cet espace de vraie vie.
Chapitre suivant : Osmose