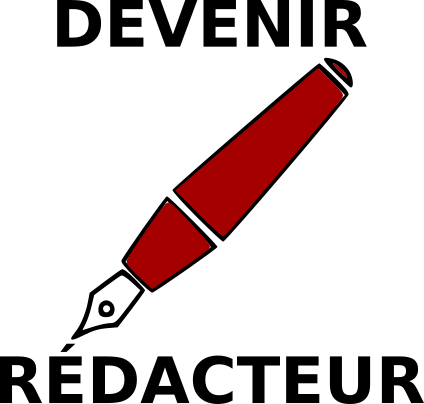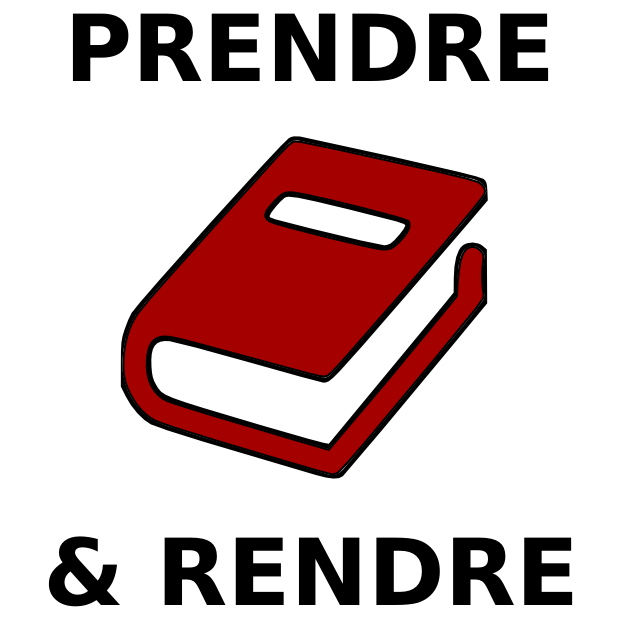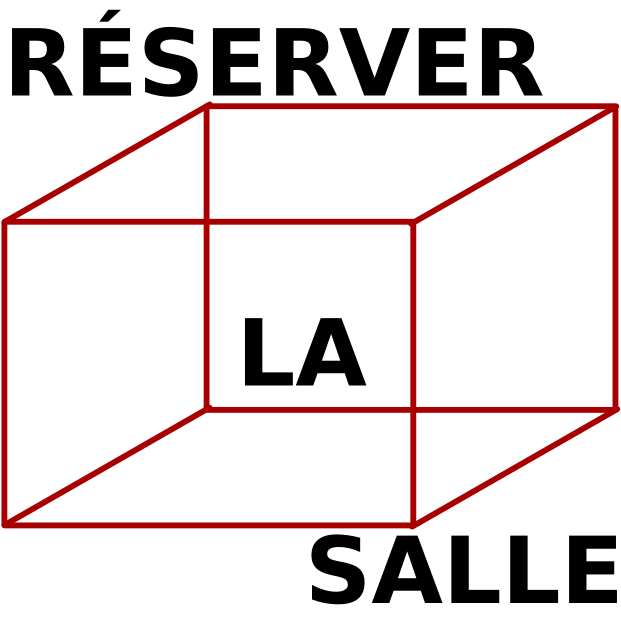Que reste-t-il alors à faire au colonisé ? Ne pouvant quitter sa condition dans l’accord et la communion avec le colonisateur, il essaiera de se libérer contre lui : il va se révolter.
Loin de s’étonner des révoltes colonisées, on peut être surpris, au contraire, qu’elles ne soient pas plus fréquentes et plus violentes. En vérité, le colonisateur y veille : stérilisation continue des élites, destruction périodique de celles qui arrivent malgré tout à surgir, par corruption ou oppression policière ; avortement par provocation de tout mouvement populaire et son écrasement brutal et rapide. Nous avons noté aussi l’hésitation du colonisé lui-même, l’insuffisance et l’ambiguïté d’une agressivité de vaincu qui, malgré soi, admire son vainqueur, l’espoir longtemps tenace que la toute-puissance du colonisateur accoucherait d’une toute-bonté.
Mais la révolte est la seule issue à la situation coloniale, qui ne soit pas un trompe-l’oeil, et le colonisé le découvre tôt ou tard. Sa condition est absolue et réclame une solution absolue, une rupture et non un compromis. Il a été arraché de son passé et stoppé dans son avenir, ses traditions agonisent et il perd l’espoir d’acquérir une nouvelle culture, il n’a ni langue, ni drapeau, ni technique, ni existence nationale ni internationale, ni droits, ni devoirs : il ne possède rien, n’est plus rien et n’espère plus rien. De plus, la solution est tous les jours plus urgente, tous les jours nécessairement plus radicale. Le mécanisme de néantisation du
colonisé, mis en marche par le colonisateur, ne peut que s’aggraver
tous les jours. Plus l’oppression augmente, plus le colonisateur a
besoin de justification, plus il doit avilir le colonisé, plus il se sent
coupable, plus il doit se justifier, etc. Comment en sortir sinon par
la rupture, l’éclatement, tous les jours plus explosif, de ce cercle
infernal ? La situation coloniale, par sa propre fatalité intérieure,
appelle la révolte. Car la condition coloniale ne peut être aménagée ;
tel un carcan, elle ne peut qu’être brisée.
...............
S’acceptant comme colonisateur, le colonialiste accepte en même
temps, même s’il a décidé de passer outre, ce que ce rôle implique
de blâme, aux yeux des autres et aux siens propres. Cette décision
ne lui rapporte nullement une bienheureuse et définitive tranquillité
d’âme. Au contraire, l’effort qu’il fera pour surmonter cette ambiguïté
nous donnera une des clefs de sa compréhension. Et les relations
humaines en colonie auraient peut-être été meilleures, moins
accablantes pour le colonisé, si le colonialiste avait été convaincu
de sa légitimité. En somme, le problème posé au colonisateur qui
se refuse est le même que pour celui qui s’accepte. Seules leurs
solutions diffèrent : celle du colonisateur qui s’accepte le transforme
immanquablement en colonialiste.
De cette assomption de soi-même et de sa situation, vont découler
en effet plusieurs traits que l’on peut grouper en un ensemble cohérent.
Cette constellation, nous proposons de l’appeler : le rôle de l’usurpateur
(ou encore le complexe de Néron).
S’accepter comme colonisateur, ce serait essentiellement, avons-
nous dit, s’accepter comme privilégié non légitime, c’est-à-dire comme
usurpateur. L’usurpateur, certes, revendique sa place, et, au besoin,
la défendra par tous les moyens. Mais, il l’admet, il revendique une
place usurpée. C’est dire qu’au moment même où il triomphe,
il admet que triomphe de lui une image qu’il condamne. Sa victoire
de fait ne le comblera donc jamais : il lui reste à l’inscrire dans les
lois et dans la morale. Il lui faudrait pour cela en convaincre les autres,
sinon lui-même. Il a besoin, en somme, pour en jouir complètement,
de se laver de sa victoire, et des conditions dans lesquelles elle fut
obtenue. D’où son acharnement, étonnant chez un vainqueur, sur
d’apparentes futilités : il s’efforce de falsifier l’histoire, il fait récrire
les textes, il éteindrait des mémoires. N’importe quoi, pour arriver
à transformer son usurpation en légitimité.
Comment ? Comment l’usurpation peut-elle essayer de passer
pour légitimité ? Deux démarches semblent possibles : démontrer
les mérites de l’usurpateur, si éminents qu’ils appellent une telle
récompense ; ou insister sur les démérites de l’usurpé, si profonds
qu’ils ne peuvent que susciter une telle disgrâce. Et ces deux efforts
sont en fait inséparables. Son inquiétude, sa soif de justification
exigent de l’usurpateur, à la fois, qu’il se porte lui-même aux nues,
et qu’il enfonce l’usurpé plus bas que terre.
En outre, cette complémentarité n’épuise pas la relation complexe
de ces deux mouvements. Il faut ajouter que plus l’usurpé est écrasé,
plus l’usurpateur triomphe dans l’usurpation ; et, par suite, se confirme
dans sa culpabilité et sa propre condamnation : donc plus le jeu du
mécanisme s’accentue, sans cesse entraîné, aggravé par son propre
rythme. A la limite, l’usurpateur tendrait à faire disparaître l’usurpé,
dont la seule existence le pose en usurpateur, dont l’oppression
de plus en plus lourde le rend lui-même de plus en plus oppresseur.
Néron, figure exemplaire de l’usurpateur, est ainsi amené à persécuter
rageusement Britannicus, à le poursuivre. Mais plus il lui fera de mal,
plus il coïncidera avec ce rôle atroce qu’il s’est choisi. Et plus il
s’enfoncera dans l’injustice, plus il haïra Britannicus et cherchera
à atteindre davantage sa victime, qui le transforme en bourreau.
Non content de lui avoir volé son trône, il essayera de lui ravir
le seul bien qui lui reste, l’amour de Junie. Ce n’est ni jalousie
pure ni perversité, mais cette fatalité intérieure de l’usurpation,
qui l’entraîne irrésistiblement vers cette suprême tentation : la
suppression morale et physique de l’usurpé.
...............
Ce qu’est véritablement le colonisé importe peu au colonisateur.
Loin de vouloir saisir le colonisé dans sa réalité, il est préoccupé
de lui faire subir cette indispensable transformation. Et le
mécanisme de ce repétrissage du colonisé est lui-même éclairant.
Il consiste d’abord en une série de négations. Le colonisé n’est
pas ceci, n’est pas cela. Jamais il n’est considéré positivement ;
ou s’il l’est, la qualité concédée relève d’un manque psychologique
ou éthique. Ainsi pour l’hospitalité arabe, qui peut difficilement
passer pour un trait négatif. Si l’on y prend garde on découvre
que la louange est le fait de touristes, d’Européens de passage,
et non de colonisateurs, c’est-à-dire d’Européens installés en
colonie. Aussitôt en place, l’Européen ne profite plus de cette
hospitalité, arrête les échanges, contribue aux barrières.
Rapidement, il change de palette pour peindre le colonisé,
qui devient jaloux, retiré sur soi, exclusif, fanatique. Que devient
la fameuse hospitalité ? Puisqu’il ne peut la nier, le colonisateur
en fait alors ressortir les ombres, et les conséquences désastreuses.
(...) Ainsi s’effritent, l’une après l’autre, toutes les qualités qui
font du colonisé un homme. Et l’humanité du colonisé, refusée
par le colonisateur, lui devient en effet opaque. Il est vain,
prétend-il, de chercher à prévoir les conduites du colonisé
(« Ils sont imprévisibles ! » ... « Avec eux, on ne sait jamais ! »).
Une étrange et inquiétante impulsivité lui semble commander
le colonisé. Il faut que le colonisé soit bien étrange, en vérité,
pour qu’il demeure si mystérieux après tant d’années de
cohabitation... ou il faut penser que le colonisateur a de fortes
raisons de tenir à cette illisibilité.
(...) Enfin le colonisateur dénie au colonisé le droit le plus précieux
reconnu à la majorité des hommes : la liberté. Les conditions de
vie faites au colonisé par la colonisation n’en tiennent aucun
compte, ne la supposent même pas. Le colonisé ne dispose
d’aucune issue pour quitter son état de malheur : ni d’une issue
juridique (la naturalisation) ni d’une issue mystique (la conversion
religieuse) : le colonisé n’est pas libre de se choisir colonisé ou
non colonisé. Que peut-il lui rester, au terme de cette effort obstiné
de dénaturation ? Il n’est sûrement plus qu’un alter ego du
colonisateur. C’est à peine encore un être humain. Il tend
rapidement vers l’objet. A la limite, ambition suprême du
colonisateur, il devrait ne plus exister qu’en fonction des besoins
du colonisateur, c’est-à-dire s’être transformé en colonisé pur.
On voit l’extraordinaire efficacité de cette opération. Quel devoir
sérieux a-t-on envers un animal ou une chose, à quoi ressemble
de plus en plus le colonisé ? On comprend alors que le colonisateur
puisse se permettre des attitudes, des jugements tellement
scandaleux. Un colonisé conduisant une voiture est un spectacle
auquel le colonisateur refuse de s’habituer ; il lui dénie toute
normalité, comme pour une pantomime simiesque. Un accident,
même grave, qui atteint le colonisé, fait presque rire. Une mitraillade
dans une foule colonisée lui fait hausser les épaules. D’ailleurs,
une mère indigène pleurant la mort de son fils, une femme indigène
pleurant son mari, ne lui rappellent que vaguement la douleur d’une
mère ou d’une épouse. Ces cris désordonnés, ces gestes insolites,
suffiraient à refroidir sa compassion, si elle venait à naître.
Dernièrement, un auteur nous racontait avec drôlerie comment,
à l’instar du gibier, on rabattait vers de grandes cages les indigènes
révoltés. Que l’on ait imaginé puis osé construire ces cages, et,
peut-être plus encore, que l’on ait laissé les reporters photographier
les prises, prouve bien que, dans l’esprit de ses organisateurs, le
spectacle n’avait plus rien d’humain.
...............
Il est remarquable que le racisme fasse partie de tous les
colonialismes, sous toutes les latitudes. Ce n’est pas une
coïncidence : le racisme résume et symbolise la relation
fondamentale qui unit colonialiste et colonisé.
Il ne s’agit guère d’un racisme doctrinal. Ce serait d’ailleurs
difficile ; le colonialiste n’aime pas la théorie et les théoriciens.
Celui qui se sait en mauvaise posture idéologique ou éthique
se targue en général d’être une homme d’action, qui puise ses
leçons dans l’expérience. Le colonialiste a trop de mal à construire
son système de compensation pour ne pas se méfier de la
discussion. Son racisme est vécu, quotidien ; mais il n’y perd
pas pour autant. A côté du racisme colonial, celui des doctrinaires
européens apparaît comme transparent, gelé en idées, à première
vue presque sans passion. Ensemble de conduites, de réflexes
appris, exercés depuis la toute première enfance, fixé, valorisé
par l’éducation, le racisme colonial est si spontanément
incorporé aux gestes, aux paroles, même les plus banales,
qu’il semble constituer une des structures les plus solides de
la personnalité colonialiste. La fréquence de son intervention,
son intensité dans les relations coloniales serait stupéfiante,
cependant, si l’on ne savait à quel point il aide à vivre le
colonialiste, et permet son insertion sociale. Un effort constant
du colonialiste consiste à expliquer, justifier et maintenir,
par le verbe comme par la conduite, la place et le sort du
colonisé, son partenaire dans le drame colonial. C’est-à-dire,
en définitive, à expliquer, justifier et maintenir le système
colonial, et donc sa propre place. Or l’analyse de l’attitude
raciste révèle trois éléments importants :
1. Découvrir et mettre en évidence les différences entre
colonisateur et colonisé.
2. Valoriser ces différences, au profit du colonisateur et
au détriment du colonisé.
3. Porter ces différences à l’absolu, en affirmant qu’elles
sont définitives, et en agissant pour qu’elles le deviennent.
La première démarche n’est pas la plus révélatrice de
l’attitude mentale du colonialiste. Etre à l’affût du trait
différentiel entre deux populations n’est pas une
caractéristique raciste en soi. Mais elle occupe sa place
et prend un sens particulier dans un contexte raciste.
Loin de recherche ce qui pourrait atténuer son dépaysement,
le rapprocher du colonisé, et contribuer à la fondation
d’une cité commune, le colonialiste appuie au contraire
sur tout ce qui l’en sépare. Et dans ces différences,
toujours infamantes pour le colonisé, glorieuses pour lui,
il trouve justification de son refus. Mais voici peut-être
le plus important : une fois isolé le trait de moeurs, fait
historique ou géographique, qui caractérise le colonisé
et l’oppose au colonisateur, il faut empêcher que le
fossé ne puisse être comblé. Le colonialiste sortira le
fait de l’histoire, du temps, et donc d’une évolution possible,
Le fait sociologique est baptisé biologique ou mieux
métaphysique. Il est déclaré appartenir à l’essence du
colonisé. Du coup, la relation entre le colonisé et le
colonisateur, fondée sur la manière d’être, essentielle,
des deux protagonistes, devient une catégorie définitive.
Elle est ce qu’elle est parce qu’ils sont ce qu’ils sont,
et ni l’un ni l’autre ne changeront jamais.
...............
En bref, l’homme de gauche ne retrouve dans la lutte du
colonisé, qu’il soutient a priori, ni les moyens traditionnels
ni les buts derniers de cette gauche dont il fait partie. Et bien
entendu, cette inquiétude, ce dépaysement sont singulièrement
aggravés chez le colonisateur de gauche, c’est-à-dire l’homme
de gauche qui vit en colonie et fait ménage quotidien avec
ce nationalisme.
Prenons un exemple parmi les moyens utilisés dans cette
lutte : le terrorisme. On sait que la tradition de gauche condamne
le terrorisme et l’assassinat politique. Lorsque les colonisés
en vinrent à les employer, l’embarras du colonisateur de gauche
fut très grave. Il s’efforce de les détacher de l’action volontaire
du colonisé, d’en faire un épiphénomène de sa lutte : ce sont,
assure-t-il, des explosions spontanées de masses trop longtemps
opprimées, ou mieux des agissements d’éléments instables,
douteux, difficilement contrôlables par la tête du mouvement.
Bien rare furent ceux, même en Europe, qui aperçurent et
admirent, osèrent dire que l’écrasement du colonisé était tel,
telle était la disproportion des forces, qu’il en était venu,
moralement à tort ou à raison, à utiliser volontairement ces
moyens. Le colonisateur de gauche avait beau faire des
efforts, certains actes lui parurent incompréhensibles,
scandaleux et politiquement absurdes ; par exemple la mort
d’enfants ou d’étrangers à la lutte, ou même de colonisés
qui, sans s’opposer au fond, désapprouvaient tel détail de
l’entreprise. Au début, il fut tellement troublé qu’il ne trouvait
pas mieux que de nier de tels actes ; ils ne pouvaient trouver
aucune place, en effet, dans sa perspective du problème.
Que ce soit la cruauté de l’oppression qui explique
l’aveuglement de la réaction lui parut à peine un argument :
il ne peut approuver chez le colonisé ce qu’il combat dans
la colonisation, ce pourquoi précisément il condamne la
colonisation.
Puis, après avoir soupçonné à chaque fois la nouvelle
d’être fausse, il dit, en désespoir de cause, que de tels
agissements sont des erreurs, c’est-à-dire qu’ils ne
devraient pas faire partie de l’essence du mouvement.
Les chefs certainement les désapprouvent, affirme-t-il
courageusement. Un journaliste qui a toujours soutenu
la cause des colonisés, las d’attendre des condamnations
qui ne venaient pas, finit un jour par mettre publiquement
en demeure certains chefs de prendre position contre
les attentats. Bien entendu, il ne reçut aucune réponse ;
il n’eut pas la naïveté supplémentaire d’insister.
...............
La servitude du colonisé ayant paru scandaleuse au colonisateur,
il lui fallait l’expliquer, sous peine d’en conclure au scandale
et à l’insécurité de sa propre existence. Grâce à une double
reconstruction du colonisé et de lui-même, il va du même coup
se justifier et se rassurer.
Porteur des valeurs de la civilisation et de l’histoire, il accomplit
une mission : il a l’immense mérite d’éclairer les ténèbres infamantes
du colonisé. Que ce rôle lui rapporte avantages et respect n’est
que justice : la colonisation est légitime, dans tous ses sens et
conséquences.
Par ailleurs, la servitude étant inscrite dans la nature du colonisé,
et la domination dans la sienne, il n’y aura pas de dénouement.
Aux délices de la vertu récompensée, il ajoute la nécessité des
lois naturelles. La colonisation est éternelle, il peut envisager
son avenir sans inquiétude aucune.
Après quoi, tout deviendrait possible et prendrait un sens
nouveau. Le colonialiste pourrait se permettre de vivre presque
détendu, bienveillant et même bienfaiteur. Le colonisé ne pourrait
que lui être reconnaissant de rabattre de ce qui lui revient. C’est
ici que s’inscrit l’étonnante attitude mentale dite paternaliste.
Le paternaliste est celui qui se veut généreux par-delà, et une
fois admis, le racisme et l’inégalité. C’est, si l’on veut, un
racisme charitable - qui n’est pas le moins habile ni le moins
rentable. Car le paternalisme le plus ouvert se cabre dès que
le colonisé réclame, ses droits syndicaux par exemple. S’il
relève la paye, si sa femme soigne le colonisé, il s’agit de
dons et jamais de devoirs. S’il se reconnaissait des devoirs,
il lui faudrait admettre que le colonisé a des droits. Or il est
entendu, par tout ce qui précède, que le colonisé n’a pas
de droits.
Ayant instauré ce nouvel ordre moral où par définition il est
maître et innocent, le colonialiste se serait enfin donné
l’absolution. Faut-il encore que cet ordre ne soit pas remis
en question par les autres, et surtout par le colonisé.
Albert Memmi | Portrait du colonisé | 1957