Le premier atelier du 19/03 autour du Manifeste, a permis de soulever un certain nombre de questions. Comme le compte rendu l’atteste, les champs de réflexion sont étendus et complexe. Afin de ne pas se perdre dans d’infinies digressions et discussions, les participants du premier atelier ont décidé de se retrouver autour d’une lecture collective du premier chapitre du Manifeste. Cette lecture collective permettra de partir de définitions claires rendant possible une problématisation avec la situation actuelle. Cette lecture collective du 1er chapitre pourrait s’articuler autour des axes d’interrogations suivants :
Le Manifeste nous dit « le capitalisme produit son fossoyeur : la classe ouvrière » et nous propose la définition suivante : La « classe ouvrière » est composée de ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre. Cette classe est face à ceux qui possèdent les moyens de production. Il existe donc des intérêts antagonistes liés à l’exploitation des seconds par les premiers. Ceci ferait de cette « classe ouvrière », une classe révolutionnaire puisqu’elle pourrait non pas renverser le système capitaliste mais supprimer la société de classe en tant que telle. Vaste programme.
Regardons le monde actuel à l’aune de ces définitions de principes. Qu’est ce que la bourgeoisie aujourd’hui ? Le haut-fonctionnaire ? L’élu ? Le grand patron ? Le petit patron ? Qu’est ce que la « classe ouvrière » ? Le prolétariat ? Le sous-prolétariat ? les salariés ? Les définitions du manifeste sont-elles toujours applicables ? Faut il complexifier ces définitions a minima par la fonction qu’on occupe dans l’appareil productif (ouvrier de l’industrie, agent de nettoyage, employé de bureau, instit, travailleur social, maton, flic...) ou son statut (fonctionnaire , salarié, exécutant vs dirigeant, chômeur...) ? Dans la société actuelle la multiplicité des situations sociales dans le salariat ne brouille-t-elle pas la lecture que l’on peut en avoir ? Si les ouvriers de l’industrie constituaient aux yeux des auteurs du Manifeste la seule classe révolutionnaire en devenir en 1848, capable de détruire le capital, comment qualifier actuellement les salariés du tertiaire ? Si le projet communiste s’adresse de manière indéterminée aux prolétaires, aux ouvriers, à la classe ouvrière, il n’est guère étonnant que, subjectivement, les salariés du tertiaire ne puissent se sentir concernés.
A partir de ces constats et si nous réussissons à donner du sens à notre expérience prolétarienne s’il en est, comment entrer en action ? Le siècle et demi qui a suivi la rédaction du manifeste se traduit par un échec cuisant de la classe exploitée soi-disant révolutionnaire. Comment l’expliquer ?
Aujourd’hui comment construire le conflit de classe ? Et ce dans un contexte où la conscience de classe est ensevelie sous le fétichisme de la marchandise. C’est-à-dire une croyance dans les principes économiques, sociaux et culturels capitalistes étendue. Une aliénation contre laquelle il faut lutter, mais comment ?
Pourtant des idées simples comme « un humain n’est pas une chose » ou « nous ne valons pas que notre temps de travail socialement nécessaire »… sont purement anticapitalistes et communistes. Pourtant cette perspective fait peur à beaucoup d’entre nous. Le lieu du travail est-il alors toujours le lieu de la conflictualité de classe ?
Beaucoup de questions donc mais des axes à travailler au regard de la lecture du chapitre 1 du manifeste :
- Quelle définition pour les classes au regard de la société actuelle ?
- Peut-on parler d’échec pour la classe exploitée dans un contexte de fétichisme avancé ?
- Où et comment construire la conflictualité de classe ? Dans la seule perspective communiste ?
Nous vous proposons de venir prochainement travailler ces questions avec nous. Pour tout renseignement sur les dates de rencontre envoyez un mail à contact-biblio[at]millebabords.org !
Pour retrouver une synthèse de plusieurs heures d’échanges lors du premier atelier :
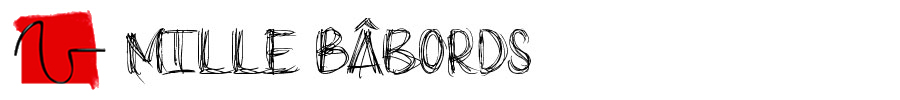
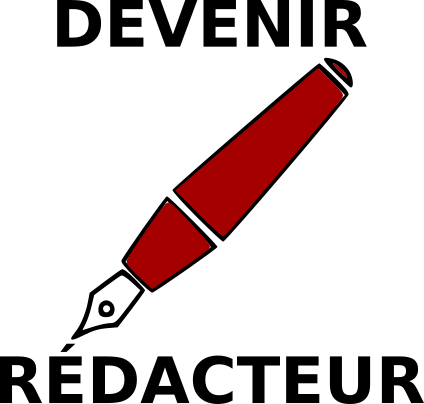
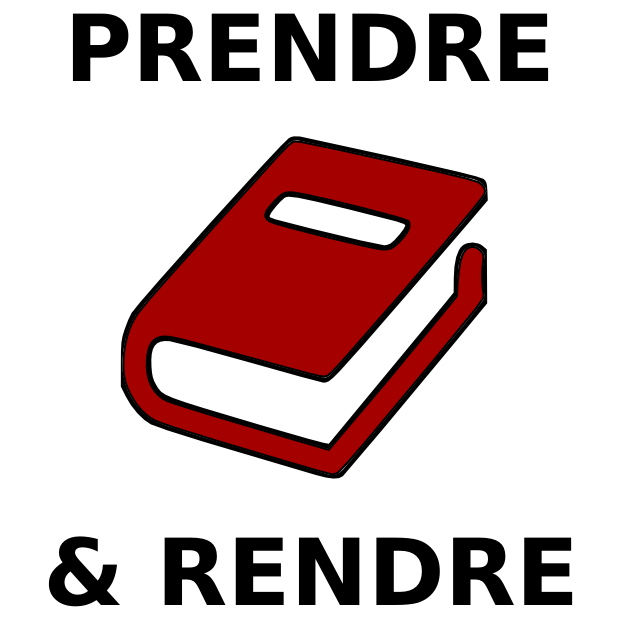
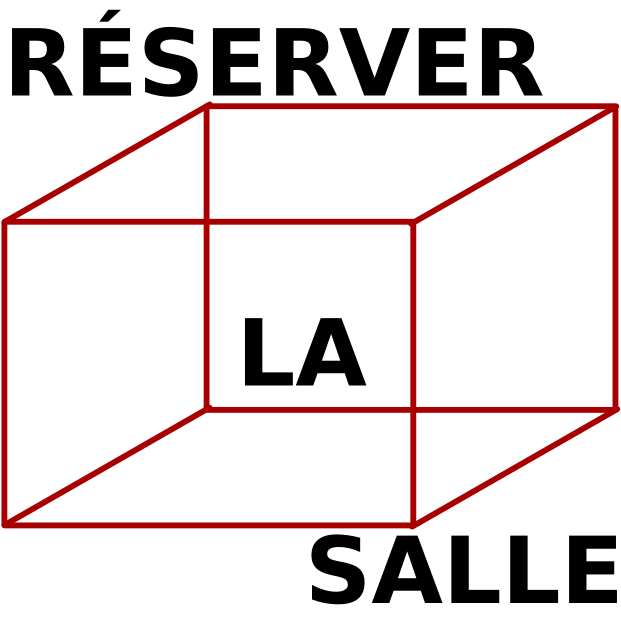






Vos commentaires
# Le 10 mai 2016 à 10:21, par Michel Martin En réponse à : Invitation au deuxième atelier autour du « Manifeste du parti communiste »
Vous trouverez de nombreuses pistes critiques dans cet article de l’érudit Jean Zin : L’erreur de Marx :
http://jeanzin.fr/2016/05/08/l-erreur-de-marx/
# Le 12 mai 2016 à 16:15, par Di-Léta Patrice En réponse à : Invitation au deuxième atelier autour du « Manifeste du parti communiste »
Allez vous faire foutre avec votre parti de merde et votre syndicat collabo CGT qui nous a gazé dans la manif de ce matin en compagnie de la BAC. vous n’êtes que des ordures
Patrice Di-Léta
# Le 13 mai 2016 à 08:30 En réponse à : Invitation au deuxième atelier autour du « Manifeste du parti communiste »
heu j’ai pas très bien compris si tu t’es trompé d’article ??.. ou quoi ?
Ou si quand tu vois manifeste du parti communiste tu penses PCF ce qui n’a rien n’a voir. On peut être communiste sans être staliniens sans être encarté.. En fait nous on propose justement de réfléchir à partir du texte de Marx et Engels à ce que c’est d’être communiste aujourd’hui sans se laisser berner par les discours réformistes et sécuritaires des partis et syndicats collabo comme tu dis.
Car comme toi certains d’entre nous se sont fait gazé...
Jérémy
# Le 18 mai 2016 à 20:14, par sylvie En réponse à : Invitation au deuxième atelier autour du « Manifeste du parti communiste »
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article et compte rendu , je vous remercie de mettre en valeur le temps de réflexion et de formation dans des périodes où on zappe toujours.
La connaissance de la société de l’histoire est nécessaire et c’est avec plaisir que je viendrai à votre atelier si je suis disponible et sinon je lirai le résumé de vos travaux et je me permettrai éventuellement de faire quelques remarques.
J’apprécie le fait de pouvoir parler et discuter individus à individus en essayant de sortir du classement en fonction de l’idée de ce que d’autres peuvent avoir . ça réchauffe le cœur et l’espoir .
Il ne sert à rien de s’exciter .
J’attends votre convocation avec interet
# Le 22 mai 2016 à 10:07, par jeremy En réponse à : Invitation au deuxième atelier autour du « Manifeste du parti communiste »
Bonjour Sylvie
N’hésite pas à envoyer un mail à contact-biblio [at] millebabords.org pour qu’on t’envoie la date et l’heure de l’atelier.
A bientôt.
Jérémy