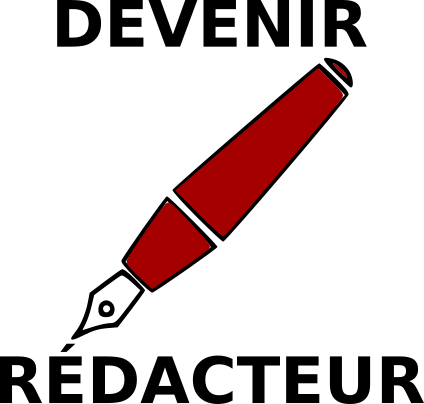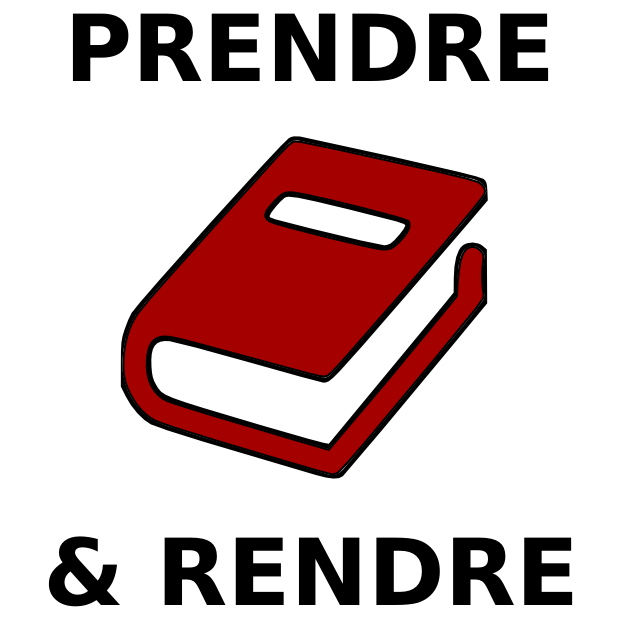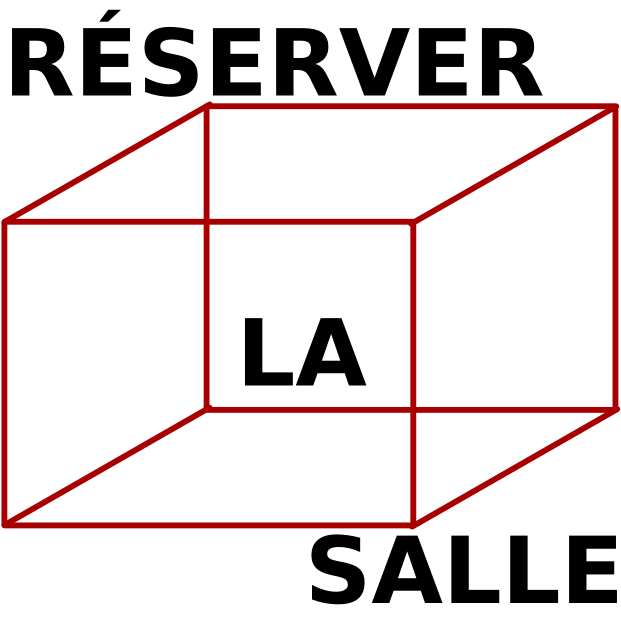Le 27 novembre 2007 Pierre Douillard-Lefèvre, alors lycéen, perd l’usage d’un œil, blessé par un tir de LBD au cours d’une manifestation. Depuis il ne cesse de militer contre les violences policières et la militarisation de la Police. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage.
L’Émancipation : Tu viens de publier aux éditions Grevis Nous sommes en Guerre. En 2009 Mathieu Rigouste publiait L’ennemi intérieur. Le rapprochement entre les deux titres vient à l’esprit, mais comment se situe ton travail par rapport à celui de Mathieu Rigouste ?
Pierre Douillard-Lefèvre : Mathieu Rigouste est à la fois un chercheur rigoureux et militant engagé contre le racisme et la répression de longue date. Il a notamment abordé la question de l’endocolonialisme – le colonialisme de l’intérieur, c’est à dire le réemploi du répertoire répressif utilisé dans les territoires soumis à l’Empire contre des populations vivant dans les quartiers périphériques, les banlieues. Ces travaux sont incontournables pour comprendre la généalogie de la police française et l’héritage colonial du maintien de l’ordre. Nos recherches se complètent : mon travail est d’abord une radiographie sociale, politique et historique de la police, et une réflexion sur la militarisation accélérée du maintien de l’ordre depuis les années 1990. Le texte n’est pas universitaire, il est destiné à toutes et tous, y compris celles et ceux qui ignorent tout du sujet. Nous sommes en guerre propose une analyse de la brutalisation de la société qui se joue actuellement dans les discours comme dans les pratiques. J’écris en tant que personne mutilée par la police, et le texte se base sur les témoignages et les histoires des “gueules cassées” du maintien de l’ordre de ces dernières années. Enfin, je propose une série de pistes pour résister à l’autoritarisme. Car les constats ne suffisent pas, il faut armer les imaginaires et faire bouger les lignes concrètement.
L’Émancipation : En 2016, la première édition de ton essai L’arme à l’œil était publiée. Ton texte avait été écrit entre la mort de Rémi Fraisse, en octobre 2014, et les attentats du 13 novembre 2015. Qu’est-ce qui a motivé cette seconde publication cinq ans plus tard ?
P. D.-L. : D’abord, le constat, mois après mois, année après année, que le diagnostic posé après la mort de Rémi Fraisse était déjà dépassé. Que les prévisions les plus terrifiantes que nous posions, au début des années 2010, étaient malheureusement insuffisantes, tant l’obscurité sécuritaire avance. Aussi, le livre évoque évidemment le traitement du mouvement des Gilets Jaunes – un nouveau curseur a été franchi, avec l’utilisation de l’armée, l’envoi de blindés, l’emploi industriel d’armes de guerre, la création de nouvelles unités de choc. La séquence autoritaire de la pandémie, et ses expérimentations biopolitiques sans précédent, ainsi que les attaques de Free Party ouvrent encore des étapes supplémentaires, qui s’installent comme une nouvelle normalité. Mais l’ouvrage n’est pas seulement une mise à jour, c’est un nouveau texte. J’ai essayé d’explorer la dimension psychologique et intime des mutilations causées par la police, et de la terreur organisée qui en découle. Qu’est-ce que signifie le fait de perdre un œil ou une main, qui sont des outils intimes, qui constituent notre puissance d’agir, de sentir, d’être compris, une “puissance d’exister” que Spinoza décrit comme la source du bonheur. Comment ces mutilations, ces images de violences policières s’impriment-elles dans les mentalités collectives ? Comment cela influe-t-il sur notre rapport à la rue ? Comment le pouvoir veut-il insuffler non seulement la peur, mais la tristesse dans nos corps ?
L’Émancipation : Dans ton rapide historique de la violence d’État, tu insistes sur la mort de Rémi Fraisse. En quoi ce dramatique événement marque-t-il un tournant ?
P. D.-L. : En 2014, la mort de Rémi Fraisse est un tournant car c’est la première fois que l’État met à mort une personne dans le cadre d’une manifestation depuis Malik Oussekine en 1986. Mais contrairement à 1986, ce décès n’entraîne aucun scandale politique : la gauche est mutique, les autorités parviennent à imposer leur récit, à justifier ce drame. Pire les rares manifestations organisées par la jeunesse sont réprimées avec une brutalité extrême. Il n’y aura aucune sanction politique, alors que la mort de Malik Oussekine avait provoqué la démission du ministre Devaquet. Bernard Cazeneuve, ira jusqu’à déclarer, bien plus tard : “ce ne sont pas les attentats qui m’ont fait gagner le respect de mes hommes, mais bien Sivens”. À partir du mandat Hollande, le pouvoir sait qu’il peut à nouveau tuer dans le cadre de mouvements sociaux sans grandes conséquences. Et cela aura un impact très net dès la mobilisation contre la Loi Travail en 2016, lors des interventions sur les ZAD, et encore davantage face aux Gilets Jaunes. Avec Rémi Fraisse, c’est une nouvelle période qui s’ouvre : le seuil d’acceptabilité de la violence d’État augmente drastiquement.
L’Émancipation : Un de tes chapitres s’intitule « l’hégémonie sécuritaire ». Qu’entends-tu par là ? Est-ce à dire que le discours et la politique sécuritaires ne sont nulle part critiqués et remis en cause ?
P. D.-L. : Depuis une vingtaine d’années, les médias des milliardaires saturent le “débat public” d’un lexique sécuritaire et anxiogène emprunté aux idéologues d’extrême droite. Et ces éléments de langage – on pense aux termes “ensauvagement”, “séparatisme”, ou quelques années auparavant “racaille” – sont repris par la classe politique. À présent, des néo-fascistes animent littéralement les plateaux de télévision et le “soft power” de la police occupe l’espace sans contre-discours : le film BAC Nord valorise des policiers violents et corrompus, les reportages et séries qui glorifient les forces de l’ordre sont diffusées quotidiennement. Lorsqu’une affaire de violence policière entre miraculeusement sous les projecteurs des médias dominants, c’est pour être instantanément légitimée par les journalistes aux ordres et leurs collègues des syndicats de police, habitués des plateaux télé. De même, la sémantique du pouvoir euphémise la violence d’État. Le qualificatif de Lanceur de Balles de Défense pour une arme à feu tirant des balles en caoutchouc, évidemment offensive, en est une incarnation. Quant à la gauche – à l’exception de Mélenchon – elle manifeste désormais derrière le syndicat d’extrême droite policier Alliance. Tout est à reconstruire dans le combat culturel face à l’hégémonie sécuritaire, médiatique et politique.
L’Émancipation : Au-delà des questions, importantes et nécessaires d’analyse, quel regard portes-tu sur les mobilisations actuelles, en France contre les violences policières, sur la place que tient cette question dans les débats publics ?
P. D.-L. : Alors que la question des violences d’État n’intéressait il y a cinq ans que des cercles restreints sensibles à ces questions ou directement concernés, la surenchère répressive frappe désormais des pans entiers de la population, des infirmières aux pompiers, des Gilets Jaunes aux enseignant·es. Tout ce qui bouge est soumis par la force. La répression est donc devenue un enjeu transversal des luttes en cours, en France mais aussi dans le monde. Il en va de la possibilité même de désirer un autre monde, de faire la fête, de vivre. Au Chili, une protestation révolutionnaire a embrasé le pays suite à la répression militarisée d’un gouvernement nostalgique de Pinochet. Aux USA, pays qu’on croyait figé par des années de néolibéralisme et de carcéralisation, une onde insurrectionnelle a traversé les métropoles suite au crime raciste de trop. Ce type de soulèvement sera probablement de plus en plus fréquent partout, et les moyens des gouvernants pour y répondre de plus en plus sophistiqués.
Le comité Adama a réussi à organiser sans soutien institutionnel des manifestations massives contre les violences policières. Des collectifs de blessé·es s’organisent. Les slogans et des pratiques d’auto-défense contre la répression se sont imposés comme une grammaire de base des manifestations.
Désarmer la police matériellement, symboliquement et politiquement est l’un des enjeux cruciaux de notre époque. Il s’agit du dernier rempart d’un régime en guerre sociale, qui ne connaît qu’une seule réponse aux crises écologiques, sanitaires ou économiques : la grenade et le 49.3. Le syndicalisme peut et doit s’emparer de cette question.
Propos recueillis par Raymond Jousmet (17)
Pierre Douillard-Lefèvre, Nous sommes en guerre. Terreur d’État et militarisation de la Police, éditions Grevis, Caen, août 2021, 244 p., 12 €.