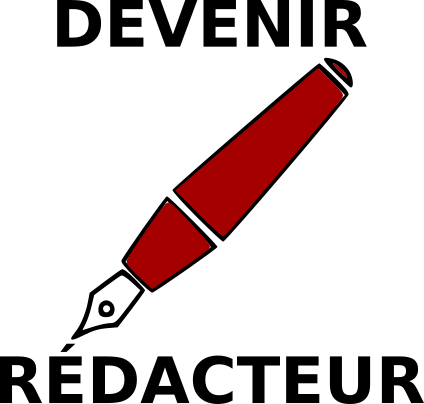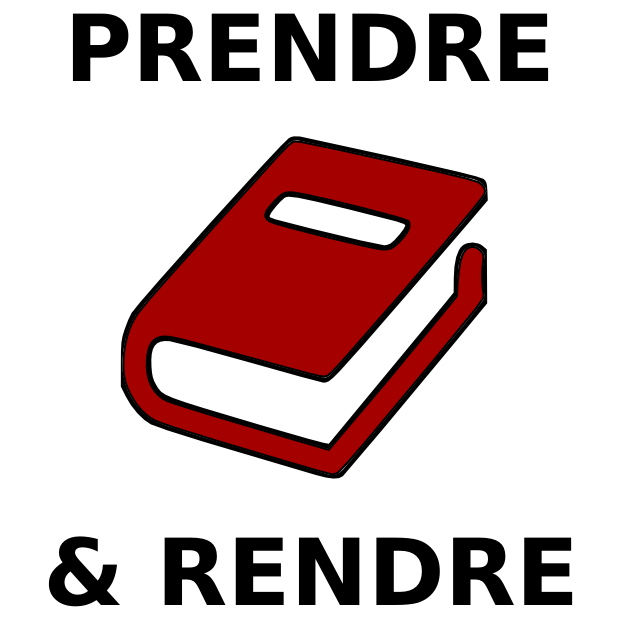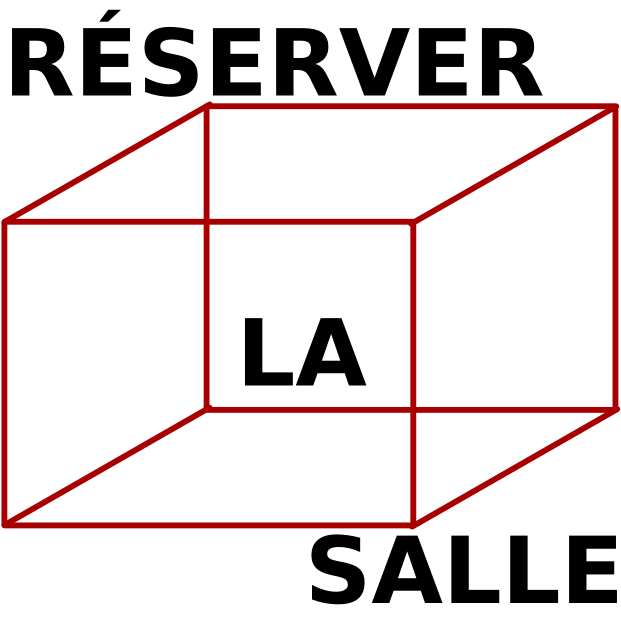« La chute du régime soviétique amènerait infailliblement celle de l’économie planifiée et, dès lors, la liquidation de la propriété étatisée. Le lien obligé entre les trusts et entre les usines au sein des trusts se romprait. Les entreprises les plus favorisées seraient livrées à elles-mêmes. Elles pourraient devenir des sociétés par actions ou adopter toute autre forme transitoire de propriété telles que la participation des ouvriers aux bénéfices. Les kolkhozes se désagrègeraient en même temps et plus facilement. La chute de la dictature bureaucratique actuelle sans son remplacement par un nouveau pouvoir socialiste annoncerait ainsi le retour au système capitaliste avec une baisse catastrophique de l’économie et de la culture. »
(Trotski, La révolution trahie, éd. Grasset 1936, p.283 – traduction Victor Serge).
Ukraine 2022
L’invasion de l’Ukraine par la Russie n’est pas une guerre mondiale, mais c’est une guerre au niveau mondial.
Dans la crise, la restructuration est en panne
Chaque phase du mode de production capitaliste inclut sa mise en forme militaire, le rapport d’exploitation comme lutte des classes est tout autant économique que politique et militaire. Dans la subsomption réelle du travail sous le capital, toutes les guerres opposent non seulement deux ennemis poursuivant des buts antagoniques, mais surtout deux ennemis constitués et construits par la polarisation d’une même contradiction, chacun en représentant un pôle et chacun ayant en lui-même l’existence et la nécessité de l’autre.
Actuellement, depuis la crise de 2008, celle du mode de production tel que restructuré dans les années 1970-1980, la contradiction à résoudre mondialement est celle de la déconnexion entre la valorisation du capital et la reproduction de la force de travail qui était le principe même de la mondialisation de l’accumulation. Il s’agit de réarticuler mondialement l’accumulation du capital et la reproduction de la force de travail globale. Il n’y aura pas de retour en arrière vers des formes d’accumulation nationale ou même de blocs. Dans l’affrontement entre les Etats-Unis, l’Union européenne, la Chine et la Russie, l’enjeu est de savoir quel bloc, au travers des rivalités et des alliances entre ces quatre puissances, pourra imposer un modèle hiérarchisé mais mondialement vivable pour les « vaincus ».
Le capital ne produit jamais par lui-même de solutions à ses contradictions, ni dans le seul affrontement concurrentiel entre puissances. Au fondement il y a toujours l’exploitation qui fait que cet affrontement ne prend un sens que de par la confrontation avec le prolétariat. C’est la lutte de classe vaincue et les modalités et « inventions sociales » nécessaires pour la vaincre qui dessinent les caractéristiques d’une restructuration. La subsomption réelle est toujours en devenir . Mais, actuellement, ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l’Europe ne représentent une restructuration à venir, le jeu, jusqu’à la guerre entre ces puissances, n’est que l’existence manifeste de la contradiction à résoudre et la contradiction les traverse, reproduisant ses termes en chacune d’elles. Pour toutes, la contradiction est sur la table comme nature de l’Etat et relation entre la valorisation et la reproduction de la force de travail à l’échelle mondiale. Mais la restructuration est en panne.
Si la question est aujourd’hui si violemment posée, c’est que nous sommes parvenus à la limite de tous les « Quoi qu’il en coute » et de toutes les « largesses » des Banques centrales. Dans la crise de 2008, la déconnexion de dynamique de la mondialisation est devenue son entrave, les sections I et II de la reproduction ne s’articulent plus, la crise de suraccumulation est devenue identique à la crise de sous-consommation, l’équilibre de sous-investissement qui avait maintenu le taux de profit s’effondre dans la gabegie monétaire et l’inflation renforçant la déconnexion. Si nous considérons la déconnexion comme l’essence et la dynamique de la mondialisation de ces trente dernières années c’est alors un monde qui est entré en crise et doit se renouveler. Ce monde était celui de la mondialisation américaine.
La crise de la mondialisation américaine
Ce monde, de par la nature du capital restructuré comme fluidité de la reproduction conforme à l’extraction de plus-value sous son mode relatif, était nécessairement globalisation. Cela s’est confirmé en 1990 avec l’effondrement de l’URSS et du bloc de l’Est. La dénationalisation des Etats centraux et la fin de l’internationalisation, c’est-à-dire les relations entre « systèmes nationaux intégrés », furent également la fin de l’identité ouvrière dont l’URSS était étatiquement et géopolitiquement la représentation : c’est-à-dire la cristallisation d’une structure mondiale de la lutte des classes (quoi que nous pouvons en penser).
En séparant la valorisation et la circulation du capital de la reproduction de la force de travail, la mondialisation a brisé les aires de reproduction cohérente dans des délimitations nationales et régionales. Cette rupture a créé un désordre mondial qu’il a fallu réguler en continu par la violence qui assimilait les opérations militaires à des opérations de police. A partir de la disparition de l’URSS, la régulation américaine du désordre a été sa gestion permanente, indifférente à une mise en forme stable du social. Les Etats-Unis ne cherchaient pas à conquérir le monde, mais à réguler le désordre au travers d’un autre système que celui de la concurrence entre Etats. Ce qui s’est souvent traduit par des massacres ciblés comme actes régulateurs avec la fin de la distinction entre guerre et paix, distinction supposant une gestion locale de la « paix sociale ». C’était la « guerre globale contre le terrorisme » : globale et, par nature, interminable.
« Idéalement » les Etats ne devaient plus être que de simples gouverneurs de provinces. Les chefs de guerre autonomes locaux étaient autorisés à se livrer à quelques guerres locales de conquêtes, de reconquêtes ou de balkanisation (ex-Yougoslavie, Caucase, Proche et Moyen-Orient – Israël compris -, Colombie, Amérique centrale, Mexique, Indonésie) avec, occasionnellement une alliance avec toutes sortes de réseaux mafieux, la seule branche mondiale du capital qui manie à la fois le capital financier et la violence locale permanente.
« Idéalement », la violence devait être la continuation de l’économie par d’autres moyens, sans médiations politiques si ce n’est divers degrés d’interventions « coup de poing », de « missions pacificatrices forcées », missions policières, missions humanitaires (favorisant l’enracinement d’une économie de marché). Dans tous les cas, pas de négociations pour établir « une vie de vaincu vivable ». Localement, pouvaient se constituer des sous-systèmes conflictuels complexes (adversaires multiples) qui ne nécessitent pas l’intervention du « leader ».
« Idéalement », il s’agissait d’affirmer a-priori le globalisme des intérêts américains en déconstruisant les souverainetés nationales et les logiques de voisinage territorial, de recomposer les éléments productifs, nationaux, politiques, religieux ou idéologiques en branches fonctionnelles transnationales sur lesquelles s’exercent le « leadership naturel » des Etats-Unis, cela s’appliquait également à l’Union européenne. Pour cela, il s’agissait d’éliminer les Etats ou mouvements sociaux, guérillas hostiles ou bloquant le marché, le flux des marchandises, de capitaux, la « libération » de la main-d’œuvre. D’un côté, la mondialisation économique et militaire, régulée par les Etats-Unis à partir de la fin des années 1980, était « balkanisation » par destruction de toutes les souverainetés ou régulations nationales et, de l’autre, une forme de « débalkanisation », de réunification de ce monde par la construction d’espaces économiques unifiés selon des logiques non-souveraines. La mondialisation américaine avait combiné deux stratégies : « l’élargissement clintonien » et la « mise en ghettos civilisationnels » de la droite républicaine.
Pour les Etats-Unis, il s’agissait en outre de sortir des alliances à territorialité définie, ce fut le moment de « l’obsolescence de L’OTAN » et du partenership avec la Russie. L’Otan devenait une nouvelle alliance offensive contre des probabilités d’insécurités, sans zone prédéterminée. Il ne s’agissait pas d’une alliance des Etats-Unis avec l’ « Etat russe souverain », ce sont la Russie et ses abords eux-mêmes qui étaient devenus une « frontière de l’élargissement » avec le sens américain de « frontière ». Dans les termes de l’accord : « l’Otan aide militairement la démocratisation et l’extension de l’économie capitaliste libérale en Russie et à sa périphérie ».
Jusqu’à ce que « l’idéal » s’effondre en Irak et en Afghanistan dans l’incontournable nécessité de l’engagement au sol suivi d’occupations. Dans les pays arabes du pourtour méditerranéen, les révoltes prolétariennes et interclassistes ont signifié la faillite d’une classe capitaliste construite comme une oligarchie clientéliste se confondant avec les appareils répressifs de l’Etat métamorphosant en activités produisant de la rente toute production ou service pouvant entrer dans le flux de la valorisation mondiale du capital. Dans des zones entières comme l’Asie centrale, l’Amérique centrale, ou en Afrique, bourgeoisie, bureaucratie, mafias, police et armée se découpaient des monopoles, gérant les investissements étrangers et les activités pouvant s’articuler avec la valorisation mondiale et créant un constant décalage entre la masse de main-d’œuvre libérée disponible et son absorption comme force de travail.
Un mode d’exploitation de la force de travail à l’échelle mondiale, de mise en valeur du capital, est à bout de souffle et s’effondre dans son exacerbation.
L’identité, dans la crise actuelle, entre crise de suraccumulation et de sous-consommation signifie que la déconnexion entre valorisation du capital et reproduction de la force de travail est devenue un problème. Dans cette identité de la crise, la déconnexion qui était fonctionnelle à une phase du mode de production devient contradictoire à sa propre poursuite. Cela tant au niveau de l’architecture mondiale de la réalisation faisant des Etats-Unis le consommateur en dernier ressort, qu’au niveau, tout aussi important et peut-être plus pour la suite, du développement « national » des « capitalismes émergents ».
La relation entre économie et violence avait été simplifiée par la création des Etats-nation du XVIIème au XIXème s. et ensuite par la bipolarité Est / Ouest, durant la première phase de la subsomption réelle. La gestion américaine du désordre de la globalisation consistant à déconstruire les souverainetés nationales et les logiques de voisinage, a engendré une situation proliférante, incontrôlable, entropique.
Toute la géographie de la reproduction mondiale du capital et son zonage en abyme se délite. Ce qui faisait système ne le fait plus : austérité, baisse du salaire au-dessous de la valeur de la force de travail n’alimentent plus les assignations sur une valorisation future du capital financiarisé qui s’alimente lui-même à la « planche à billets ». On ne reviendra pas en arrière, mais la mondialisation peut prendre un autre tour indéfinissable actuellement et qui ne pourrait être qu’une fonction de nouvelles modalités de la valorisation c’est-à-dire du rapport d’exploitation.
Cette déconnexion était un système mondial. Dans l’effondrement de ce système (une situation chaotique où le chaos n’est plus régulé) la nécessité d’une reconfiguration du cycle mondial du capital supplantant la globalisation actuelle se fait jour. Une renationalisation des économies dépassant / conservant la globalisation, une définanciarisation du capital productif, de nouvelles modalités d’intégration de la reproduction de la force de travail dans le cycle propre du capital ne sont pour l’heure que des interrogations et des hypothèses.
Les restructurations du mode de production capitaliste ne suivent jamais un plan, mais se construisent dans les affrontements internes de la classe capitaliste mondiale et par-dessus tout dans l’affrontement avec le prolétariat. La fraction de la classe capitaliste pouvant s’imposer aux autres et créer une hiérarchie vivable pour l’ensemble de la classe mondiale est celle qui résout et reconfigure le rapport d’exploitation. Les luttes internes à la classe capitaliste nationalement et mondialement, jusqu’à la guerre qui n’en n’est que la poursuite, n’ont de sens que de trouver la meilleure solution de renouvellement de l’exploitation pour l’ensemble du capital.
Poutine n’est pas seul
« Si une nation fait preuve durant des siècles de sa volonté d’exister et de se constituer en entité étatique, toutes les tentatives visant à étouffer d’une manière ou d’une autre un tel développement ne pourront qu’introduire une dimension chaotique dans le processus d’ensemble de l’histoire universelle. » (M.Khvylovy, cité par Zbigniew Kowalewski, L’Ukraine, réveil d’un peuple, reprise d’une mémoire, Revue Hérodote, Les Marches de la Russie, 1989)
Crise de la mondialisation américaine : cette crise se fixe au niveau mondial sur deux kystes principaux : la Russie et la Chine et, sur un troisième, au niveau régional : l’Iran. Il faut remarquer que dans ces trois cas, l’Etat domine l’économie et n’a pas accédé à l’existence d’Etat séparé. En Russie, l’Etat n’est pas l’Etat de la classe capitaliste, son conseil d’administration général, mais c’est la classe capitaliste (les oligarques) qui est la classe capitaliste de l’Etat. La bureaucratie soviétique n’a pas encore achevé, même après l’effondrement de l’URSS, sa longue marche qui la mène à être une classe capitaliste ordinaire débarrassée de ses origines révolutionnaires. En ce qui concerne l’Union européenne, pour les Etats-Unis et la Russie, il s’agit seulement d’en entretenir les divisions elle n’est plus un enjeu central ou un rival potentiel même si elle joue un rôle important dans la guerre en Ukraine. Cela d’abord par la continuité territoriale qu’elle offre à l’Ukraine avec le transit de l’aide militaire, mais aussi de par les dissensions politiques internes entre Etats et à l’intérieur des Etats, que la guerre a soudain mises en évidence en ce qui concerne la relation à la Russie. La perte de centralité géopolitique tient dans le moment présent à son incapacité à être une puissance unique, mais la question géopolitique relève de ce qu’elle ne représente aucun terme de la contradiction à surmonter. Ni grande puissance souveraine, ni fer de lance de la mondialisation, ni l’une ni l’autre car l’U.E est demeurée à mi-chemin dans la restructuration de l’exploitation initiée dans les années 1970, malgré tous les efforts des Sarkozy, Hollande, Macron, Schröder, Major, Johnson (sans remonter à Thatcher …).
Mais si cette crise se cristallise dans l’affrontement de l’ « Occident » avec ces deux kystes, c’est d’abord parce que cette mondialisation est devenue contre-productive pour elle-même : ses propres limites et contradictions sont face à elle dans son rapport à ce qui, dans la crise, émerge et se constitue comme son Autre. L’ « Occident » et la Russie n’avaient aucune essence intérieure les amenant à se définir comme pôle d’une même contradiction de la mondialisation telle qu’existante, tout au plus certaines prédispositions relevant de leur position hiérarchique dans le système, c’est la relation entre les termes de la contradiction qui graduellement produit sa cristallisation et confère à chaque terme une existence nationale par laquelle la contradiction devient géopolitique.
Dans l’affrontement Etats-Unis (Occident) / Russie mais aussi Iran, Turquie, etc. ; Chine, encore à un autre niveau, se jouent les solutions possibles à la reconfiguration mondiale de l’exploitation. Aucun Etat (aucun protagoniste) ne représente un seul terme mais en chacun un terme joue le rôle de dominante de la relation.
La crise actuelle a révélé l’identité absolue entre la suraccumulation du capital et la sous-consommation ouvrière comme processus général des crises de ce mode de production. La pauvreté est devenue un problème. Si cette crise a pu revêtir la forme de cette identité et la révéler, c’est que la reproduction de la force de travail avait été l’objet, comme nous l’avons dit, d’une double déconnexion. D’une part déconnexion entre la valorisation du capital et la reproduction de la force de travail, d’autre part, déconnexion entre la consommation ouvrière et le salaire comme revenu.
Les questions sont maintenant sur la table : la nature de l’Etat ; la relation entre valorisation du capital et reproduction de la force de travail ; les modes de mobilisation de cette force de travail par le capital ; les modalités du rapport salarial dans les relations entre emploi / chômage / précarité ; les relations entre salaire / revenu / crédit. La baisse du taux de profit est toujours conjoncturelle, circonstanciée, déterminée, tant historiquement que localement.
A un tout autre niveau d’échelle et de conflictualité que la guerre en cours en Ukraine avec l’affrontement direct et global entre les termes en jeu dans la faillite de la mondialisation, en Grèce, après les émeutes de 2008, la lutte des classes mettait déjà à jour, dans les modalités spécifiques à la Grèce, les contradictions et impasses du mode de valorisation et d’accumulation du capital qui venait d’entrer en crise.
Les termes des contradictions que l’on pouvait, en Grèce, caricaturer d’un côté comme la préservation du système financier et, de l’autre, comme la reproduction de la force de travail par le capital même, n’étaient que des moments morts, chaque terme n’avait qu’à reprocher à l’autre d’être ce qu’il était. Chacun restait enfermé dans les termes mêmes de la crise et répétait sans fin son rôle particulier. La relation de Syriza aux institutions européennes avait cependant formalisé les contradictions spécifiques de la crise actuelle. Au nom du mode de production capitaliste, Tsipras avait dit à Draghi que ça ne pouvait plus marcher. C’est en ce sens et en ce sens seulement que l’affrontement de six mois entre la « gauche radicale populiste » et les sages et vénérables institutions cravatées de Bruxelles, Francfort et Washington était un affrontement réel. Les contradictions étaient là, exprimées, les termes polarisés, mais sans une confrontation massive avec le prolétariat ils sont sans vie, condamnés à se caricaturer eux-mêmes. Les termes n’étaient reflétés que dans un seul de ses pôles, le capital, et ne manifestaient que l’apparition du problème.
De même, la guerre en Ukraine signifie que les questions sont toujours là mais qu’elles ont changé d’échelle, que les métastases sont mondiales et que, pour l’heure, aucune solution capitaliste ne peut unifier la résolution aux problèmes posés. L’histoire est faite de moments, de situations, d’événements qui synthétisent des contradictions qui jusque-là menaient leur vie propre. Les contradictions ne perdent pas leur spécificité mais elles se rencontrent, s’interpénètrent. L’invasion russe en Ukraine est cette sorte d’événements. Le principe est unique, c’est la crise de la mondialisation comme fondamentalement crise de la déconnexion, mais les manifestations sont multiples chacune dans leur ordre, leurs caractéristiques et dimensions propres. Tout se coagule : lutte des classes, crise politique de la politique, affrontements géopolitiques.
Ce qui est en jeu depuis 2008, c’est une reconfiguration de la mondialisation passant par les Etats et leur organisation nationale d’existence et d’influence. Nous vivons un « moment national » nécessaire, ce n’est pas la « solution », c’est un moment de la crise et seulement une indication de la perspective. Il faudra en passer « momentanément ( ?) » par le renforcement des Etats ou des blocs étatiques, d’où pour la Russie l’importance de l’Ukraine sans qui elle n’est pas un Etat économiquement, politiquement, idéologiquement. Sans l’Ukraine la Russie n’existe pas en tant qu’Etat et n’a jamais existé . Pour peser et jouer son rôle dans la reconfiguration de la mondialisation dont elle représente maintenant un des pôles de blocage aussi bien géopolitiquement que structurellement (conceptuellement), la Russie doit échapper à la malédiction de l’Etat rentier tout en préservant l’essentiel de son approvisionnement en devises et l’alimentation de son budget. Equation difficile, si ce n’est impossible à résoudre si ce n’est en pesant de tout son poids militaire (mais comme disait Napoléon : « On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s’y asseoir dessus »).
Il faut longuement citer Thomas Gomart (directeur de l’Institut français des relations internationales – IFRI -) qui trace un panorama pertinent du grand jeu mondial actuel que la violence accélère.
« C’est une crise pivot pour le système international car elle percute l’équilibre des forces à l’échelle non seulement de l’Europe, mais aussi de l’Eurasie qui va de Brest à Vladivostok. Pour la Russie, l’Ukraine est un théâtre parmi d’autres. Le cycle des interventions occidentales s’est achevé à Kaboul en août 2021 avec la déroute américaine. Au Conseil de sécurité, l’action de la Russie n’est condamnée ni par la Chine, ni par l’Inde, ni par les Emirats arabes unis. Notons au passage que ces deux pays sont les "partenaires stratégiques" de la France dans la région Indo-Pacifique. Plus profondément, le rapprochement entre la Chine et la Russie ne peut que s’accélérer à mesure de la mise en œuvre des sanctions occidentales à l’encontre de Moscou. En voulant annexer l’Ukraine, la Russie a un besoin de plus en plus évident de la Chine, comme alternative économique, financière et technologique. La nouvelle phase est ouverte par une guerre d’invasion européenne, tristement classique, mais annonce sans doute des coalitions géoéconomiques en concurrence, ainsi qu’une réorganisation mondiale des flux maritimes, financiers et des données.
« Il y a une accélération de la lutte pour la suprématie mondiale entre les Etats-Unis et la Chine. Grâce à la Russie, cette dernière peut obliger Washington à avoir deux fronts ouverts : mer de Chine et mer Noire-mer Baltique. (…) A l’époque de la guerre froide, les économies du bloc socialiste et des pays capitalistes n’avaient que peu de relations. Aujourd’hui, elles sont intensément connectées en premier lieu avec la Chine mais aussi avec la Russie. D’où l’importance du contrôle des bordures maritimes de cet ensemble continental. La plus grande tension s’exerce à la jointure entre l’Europe et la zone entre la mer Baltique et la mer Noire (pays baltes, Moldavie, Ukraine, Géorgie) limitrophe de la Russie. Coté Pacifique, ce sont la mer de Chine, Taïwan, les Corées, le Japon qui sont la zone de friction. (…) L’enjeu, c’est la maîtrise de l’appareil productif mondial dans un contexte d’accentuation des contraintes environnementales et d’accélération de la mise en données du monde. » (Le Monde daté du 3 mars 2022).
L’analyse est exacte mais sans principes. Ce qui « percute l’équilibre des forces » ce sont les termes du blocage de l’accumulation à l’échelle mondiale. Tout est dit dans ces quelques lignes sauf la contradiction de la mondialisation comme totalité qui fait que la chose existe et particularise nationalement ses termes. Les termes de l’affrontement ne sont pas sui generis, c’est par la nature de la totalité que les termes sont particularisés. A l’intérieur de la crise de la mondialisation américaine, la réalité westphalienne des relations entre Etat revient, mais seulement comme moment de la crise interne de la mondialisation. Contrairement aux confrontations westphaliennes, c’est maintenant la totalité qui est première et se polarise nationalement tout en traversant chacun de ses pôles. Tout est redéfini : « l’illibéralisme » de la Hongrie de Orban et de la Pologne a reçu son absolution, il n’y a plus d’oligarques en Ukraine, les milices « fascistes » de Maïdan en 2014 se sont muées en glorieuses auto-organisations défensives patriotiques et le bouffon télévisuel en icône de la démocratie, même Israël, l’Etat de la colonisation sans complexe et de l’apartheid institutionnel, celui qui cumule le plus de condamnations onusiennes est promu au rang de « médiateur ».
Sans que le résultat soit prédéterminé, ce qui apparaît comme certain c’est que tout Etat, en tant que représentant général de sa classe capitaliste, qui veut jouer un rôle dans la reconfiguration à venir de la mondialisation, doit se constituer en grande puissance souveraine sur un espace national à la reproduction relativement cohérente, même si la reconfiguration de la mondialisation ne pourra pas être le retour de l’internationalisation mais un mix encore indéterminable qui devra reconnecter, pas forcément nationalement, la valorisation du capital et la reproduction de la force de travail. Depuis 2004 et l’élargissement de l’Otan aux frontières de la Russie (qui suit l’intervention unilatérale des Etats-Unis en Irak), puis 2008 avec l’annexion d’une partie de la Géorgie, la Russie joue ainsi sa place dans cette reconfiguration. Pour reprendre la terminologie de Clausewitz, ce jeu est fait d’engagements multiples . Que ce soit en Syrie, en Lybie, dans de nombreux pays sahéliens, dans la confrontation avec l’Otan à ses frontières (nous ne chercherons pas à savoir qui a commencé à ne pas tenir ses engagements), que ce soit avec l’annexion de la Crimée, l’intervention policière en Biélorussie, puis militaire au Kazakhstan, la reconnaissance des républiques séparatistes de l’Est ukrainien, le maintien d’une guerre larvée dans l’ensemble du Donbass et maintenant l’invasion de l’Ukraine, dans les engagements multiples, l’objectif final est un objectif politique. Cet objectif est lié à une telle quantité de conditions et de considérations que l’objectif ne peut plus être atteint grâce à un seul acte de grande envergure, mais seulement par un grand nombre d’actes plus ou moins important qui constituent un tout. Chacun de ces engagements particuliers est une partie d’un ensemble et comporte un objectif spécial qui le rattache à cet ensemble. Les engagements particuliers ne sont connaissables qu’à partir des causes communes dont ils surgissent.
L’invasion de l’Ukraine n’est qu’un engagement particulier, mais qui représente, pour continuer à parler comme Clausewitz : le « point culminant de l’offensive ». Mais « l’offensive » est un affaiblissement continu de l’adversaire au fur et à mesure qu’il progresse, chaque avance l’éloigne de ses bases, la « forme défensive de la guerre » est par elle-même plus forte que la « forme offensive » : « La défensive est la forme la plus forte de la conduite de la guerre » (Clausewitz, op.cit., p.400-401). L’invasion de l’Ukraine est ce « point culminant », au premier abord, sur le terrain militaire, avec le piétinement de l’armée russe, mais avant tout et surtout par rapport au but politique. « Point culminant de l’offensive » au travers des « engagements multiples » dans la recherche du but politique : être un terme face à l’Occident de la cristallisation des pôles de la contradiction dans laquelle s’est enlisée la mondialisation et par là jouer dans le grand jeu de sa reconfiguration. De quelque façon que ce soit la Russie sera perdante ; elle ne vassalisera qu’un territoire détruit et vidé d’un quart de sa population.
L’Occident a parié sur la stratégie non du recul tactique (Koutousov face à Napoléon ; Mac Arthur face aux Russes puis aux Chinois en Corée ; de nombreux exemples montrent que cette stratégie n’a pas forcément besoin de la profondeur de l’espace russe) mais du « recul politique » : laissez faire. Avec les déclarations préalablement apaisantes de Biden, Macron, du secrétaire général de l’Otan, l’Occident « a attiré » (guillemets, car ce ne fut pas bien difficile : quand on veut faire tomber quelqu’un, il faut le pousser du côté où déjà il penche) la Russie dans un piège non pas « mortel » (surtout pas) mais anémiant, dévitalisant . Dans tous les Parlements on ovationne debout Zelinsky en visioconférence, on copie même ses sweat kaki à capuche, mais il sait qu’il n’est qu’un pion et il est très rare qu’un pion arrive à reine avant qu’un fou ou une tour ne l’avalent, parfois un cheval en embuscade. De façon unanime, avant d’applaudir sa « résistance » (maintenue avec soins à l’intérieur de certaines limites ), tous les dirigeants occidentaux ont fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle accepte les accords de Minsk (2014) qui prévoyaient une révision de la constitution et la représentation des régions sécessionnistes. L’Occident vise l’instauration d’une sorte de « pat » épuisant pour la Russie et à la durée incertaine, les Ukrainiens, quant à eux et elles, devenant une sorte de somme de dommages collatéraux. La réalisation de l’objectif, au départ « limité » (l’Ukraine), n’a maintenant, pour la Russie, aucune chance de « réussite » sans toucher aux Etats Baltes et/ou à la Pologne. Plus l’ennemi s’avance plus il perd ses bases, plus son but politique doit s’élargir jusqu’à l’amener à des positions qui n’étaient pas les siennes et qu’il ne peut soutenir et assumer. La Russie ne peut plus qu’espérer et attendre la bouée chinoise mais, comme dans toute alliance, celui qui la domine adore ses comparses surtout lorsqu’ils sont affaiblis (la Chine avait de très bonnes relations avec l’Ukraine, Le Monde du 1/3/22).
On connait la fameuse formule de Clausewitz : « La guerre c’est la politique poursuivie par d’autres moyens », cette formule n’est pas exactement celle du texte : « On sait évidemment que seuls les rapports politiques entre gouvernements et nations engendrent la guerre (Clausewitz demeure dans une conception Westphalienne de la guerre bien que, au passage, il signale quelque part qu’on ne peut réussir et maintenir l’occupation d’une nation que si la puissance occupante a un écho dans les conflits internes à la nation occupée, nda), mais on se figure généralement que ces rapports cessent avec la guerre et qu’une situation toute différente, soumise à ses propres lois et à elles seules s’établit alors. Nous affirmons au contraire : la guerre n’est rien d’autre que la continuation des relations politiques, avec l’appoint d’autres moyens. Nous disons que de nouveaux moyens s’y ajoutent, pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ces relations politiques, qu’elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quelque que soient les moyens dont elles se servent, et que les fils principaux qui courent à travers les événements de guerre et auxquels elles se rattachent ne sont que des linéaments d’une politique qui se poursuit à travers la guerre jusqu’à la paix. » (Clausewitz, op.cit., p.703). La logique interne de la politique pour Clausewitz (1780-1831) c’est le dépassement, la résorption, des conflits tels qu’engendrés par les rapports sociaux de la « société civile », la politique résout une conflictualité dont elle est toujours tributaire. Il est à tous égards un contemporain de Hegel même si sa dialectique entre le « concept pur de la guerre » et la « guerre réelle » (les deux parties de De la Guerre) n’a rien à voir avec l’autoréalisation hégélienne du concept mais se réfère plutôt, avec Machiavel, à la recherche circonstancielle de la réalisation d’une nécessité dans les aléas des conjonctures.
La guerre représente le moment suprême des conflits, leur paroxysme, sans toutefois être d’une autre nature qu’eux : moment décisif de la totalité des conflits sociaux, politiques, économiques, culturels, idéologiques, y compris en étant une réécriture de la lutte des classes dont elle provient, la guerre les rassemble dans « l’élément de rupture » (Clausewitz) de la violence organisée.
Les choses seraient très simples si les conflits et les guerres exprimaient directement les contradictions en jeu dans l’accumulation du capital et dans le mode de production en général. Mais tout cela n’existe qu’au travers de toutes les médiations de la reproduction du capital dont ses structures nationales et leur histoire. Les Etats existent comme nécessaires dans le mode de production capitaliste dans la genèse duquel ils se sont constitués (XVIIème et XVIIIème siècles jusqu’à ce que l’Angleterre synthétise tous les éléments de la genèse du capital comme mode de production – voir Marx, Le Capital, éd.Sociales, t.3, p.193). Les Etats, en tant que tels, poursuivent leurs buts propres et cette poursuite appartient entièrement à la reproduction et aux restructurations du mode de production capitaliste qui n’est pas une entité se reproduisant sans toutes ses déterminations qui ne sont pas des autodéterminations du concept mais qui font que les choses existent en réalité.
On peut toujours dire, et ce n’est pas faux, que les prolétaires n’ont pas à choisir leurs exploiteurs et, de toute façon, ils n’en ont pas le choix. Mais, comme n’importe qui, ils vivent, existent, et sont produits dans ce mode de production qui les définit, et ils pensent, agissent selon l’ensemble des rapports sociaux qui les définissent. Il se peut que, de par leur situation particulière dans ces rapports sociaux, ils se trouvent engagés dans une conjoncture qui les amènent à les abolir et qu’eux seuls soient dans cette situation. Mais, actuellement, si la « restructuration » ne peut passer que par la lutte des classes, le capital, dans la contradiction telle qu’elle se présente, a déjà comme préempté sous la forme nation (souveraineté, populisme, citoyenneté), la « politique » du prolétariat. Les dés sont pipés et les boules farcies.
La crise de la mondialisation se mue partout (centre et périphérie) en crise politique (on ne peut pas laisser cela de côté en disant ce qui compte c’est les intérêts économiques car ces derniers ont une « forme »). Dans le capital restructuré, à la base de cette crise politique, il y a la disparition de l’identité ouvrière qui a totalement déstabilisé l’ensemble du fonctionnement politique de l’Etat démocratique consubstantiel à la reconnaissance d’un clivage social réel et à sa pacification. Actuellement, la lutte des classes (englobant les surnuméraires centraux et périphériques) est marquée par le partage entre nation et globalisation sous la forme d’un clivage socio-politique dont le thème des inégalités et de la légitimité de l’Etat est devenu le cœur. La crise de la mondialisation passe, pour l’instant, par les mouvements populaires plus ou moins nationalistes sur les thèmes de la répartition du revenu, de la souveraineté nationale, de la famille, des valeurs, de la citoyenneté.
En ce qui concerne plus précisément l’Ukraine, ceux qui considèrent le nationalisme comme simplement un dévoiement ou une manipulation de la classe ouvrière ne considèrent pas celle-ci comme une classe de ce mode de production mais comme étant par essence conforme, même avec des « occultations » contingentes, à son « devoir-être ». « Devoir-être » dont ils sont, c’est leur raison d’être, les représentants permanents, invariants mais toujours frustrés jusqu’à la prochaine.
La Russie s’est trouvée à représenter idéologiquement, politiquement, culturellement et, dans l’affirmation de sa confrontation avec l’Occident, le pôle de l’exigence de souveraineté nationale face à la mondialisation occidentale, jusqu’à prévoir et anticiper une fragile réorganisation de ses productions, de ses réserves de change, de son système de paiements de façon indépendante. Ce qui lui vaut de cristalliser des amitiés multiples et diverses dans le monde entier. Poutine n’est pas seul, il représente de façon de plus en plus unilatérale un pôle de la contradiction à surmonter. Le 28 janvier, à Madrid, les partis souverainistes et d’extrême droite se réunissent, il y a là Marine Le Pen, mais aussi Victor Orban, le Premier ministre Tchèque et le Premier ministre polonais qui est le seul explicitement critique vis-à-vis de la Russie. On connaît toutes les câlineries des Chevènement, Mélenchon, Salvini, Bepe Grillo, Schröder, Zemmour, Le Pen (qui n’a pas fini de rembourser l’emprunt russe), Vox en Espagne, l’AFD en Allemagne etc., etc. vis-à-vis de Poutine, mais il faut y ajouter, aux Etats-Unis mêmes, celles de Trump encore récemment et d’un présentateur vedette de Fox News. Momentanément, nous ne profiterons plus des magnifiques expositions de la Fondation Louis Vuitton dont Bernard Arnault, grâce à ses investissements oligarchiques et ses amitiés sur fond de Château Yquem, nous régalait à partir des réserves des collectionneurs russes. Mais, foin de Château Yquem, Macron nous a prévenu que pour la « défense de nos valeurs » il allait falloir se serrer la ceinture et faire de la trottinette.
R.S
23 mars 2022
Proposé par Philippe
la source